Elsa Bachelard
Jean-Charles Hameau
Philippe Piguet
Anna Olszewska
Philippe Piguet
Pauline Lisowski
Claudine Roméo
Claudine Roméo
Elsa Bachelard
Jean-Charles Hameau
Philippe Piguet
Anna Olszewska
Philippe Piguet
Pauline Lisowski
Claudine Roméo
Claudine Roméo
Jean-Charles Hameau (directeur du Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Les failles qui parlent, la céramique d’Anaïs Lelièvre” (extraits), Revue de la céramique et du verre, n°266, janvier-février 2026, p. 86.

Entretien avec Elsa Bachelard (conservatrice au Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Altus-Fluit”, catalogue de l’exposition Les énergies de la terre, Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 2025-2026 - éditions Silvana, Milan, 2025.
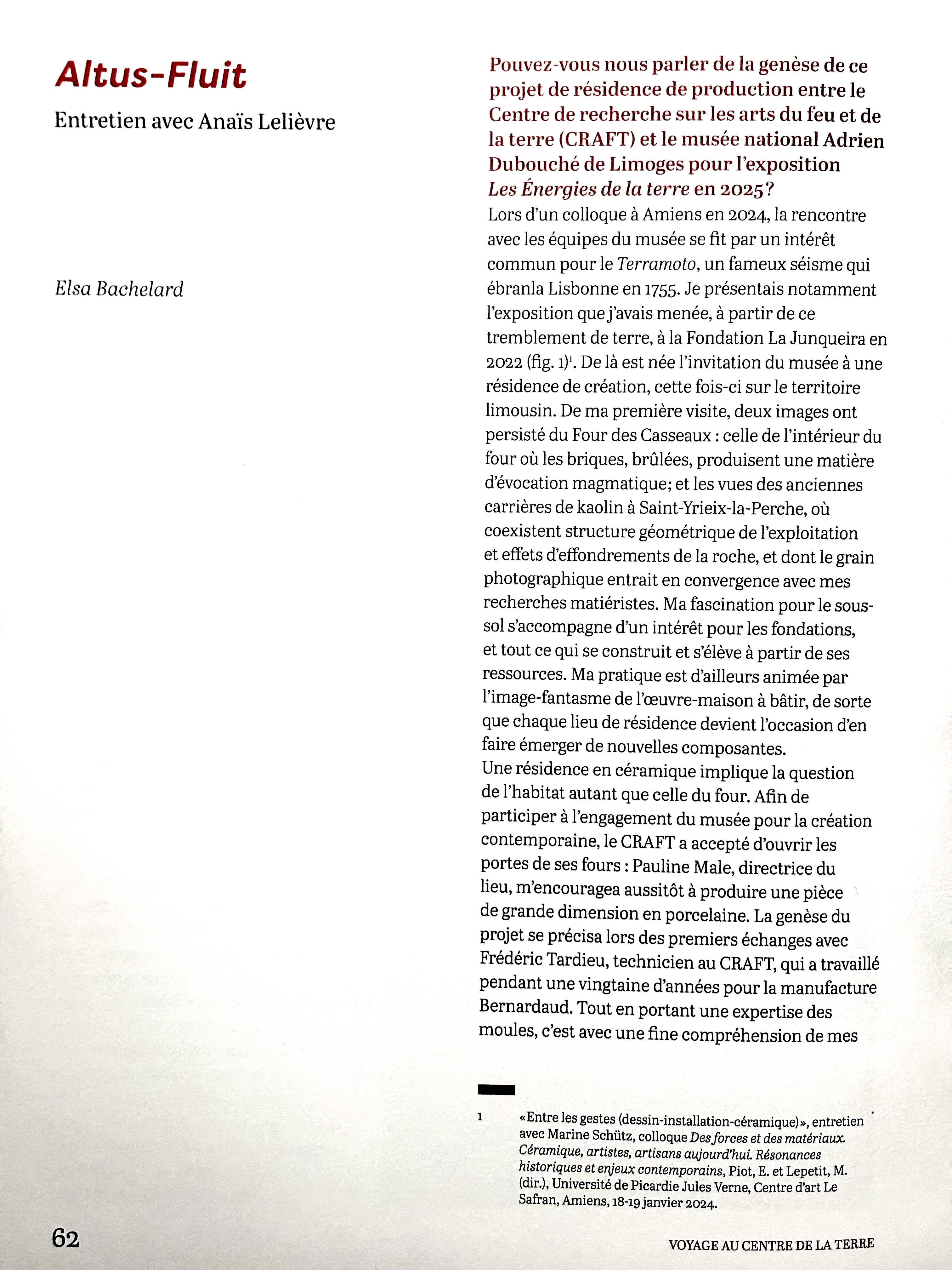




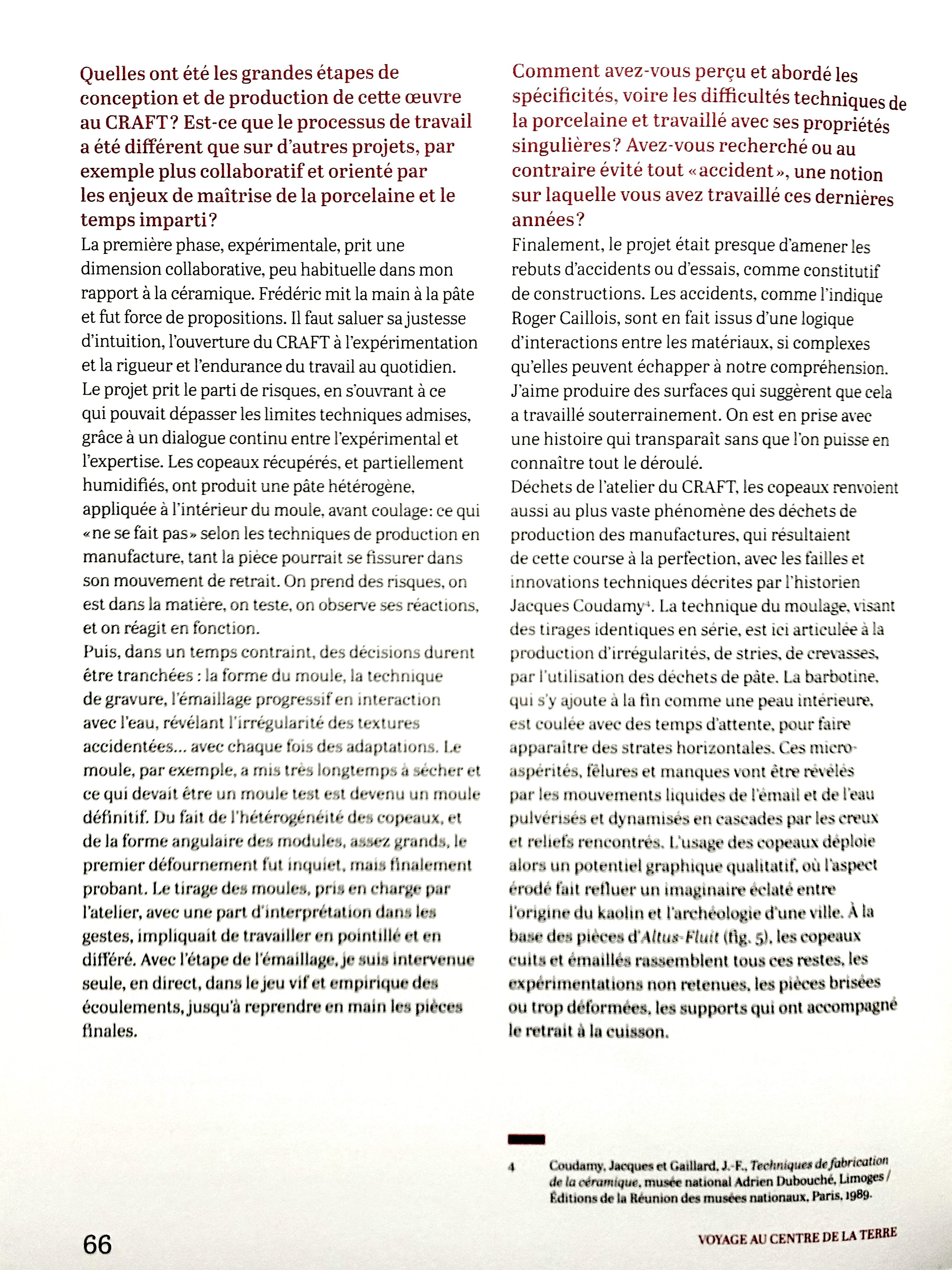


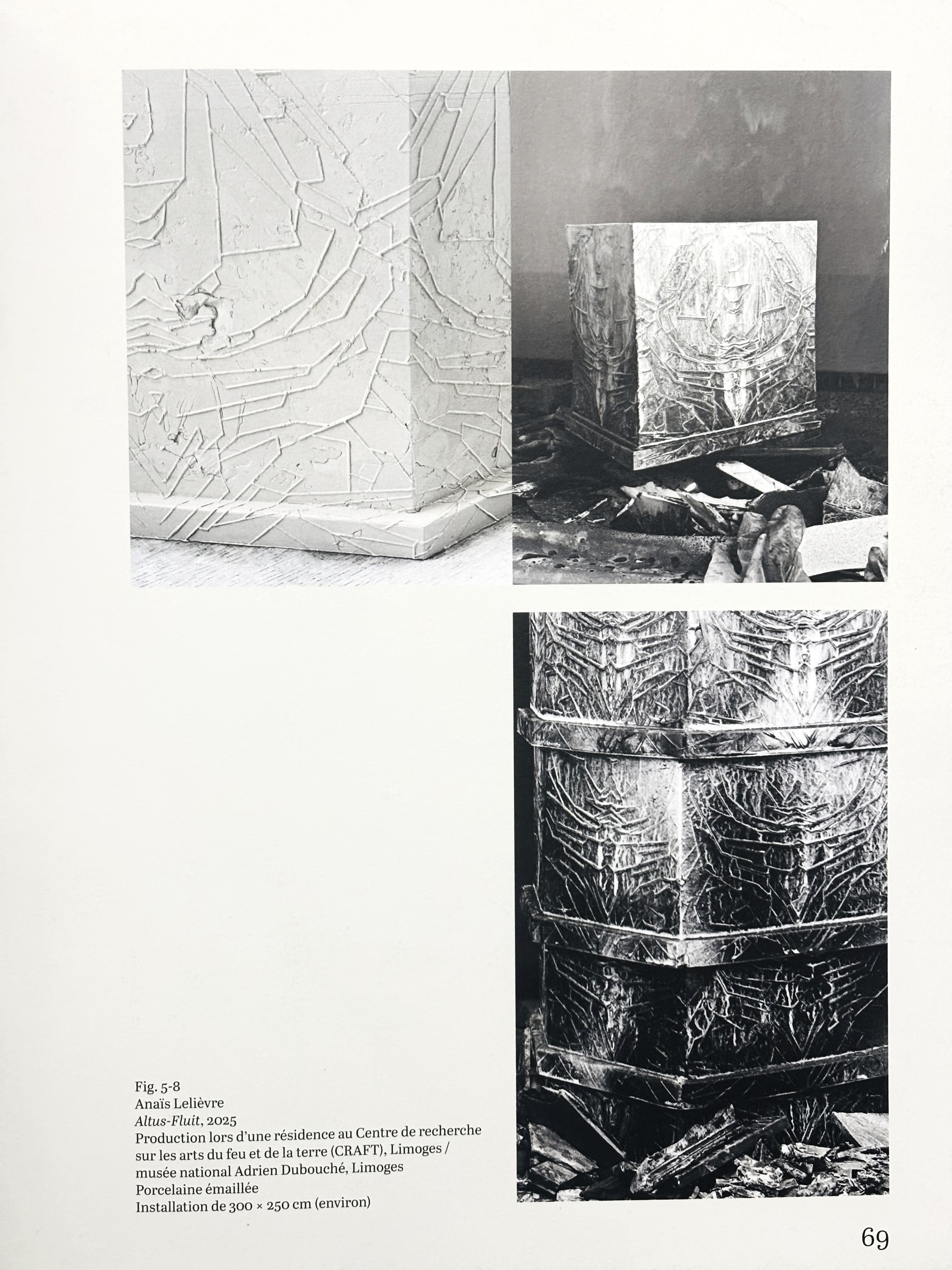
Jean-Charles Hameau (directeur du Musée national Adrien Dubouché, Limoges), “Les failles qui parlent, la céramique d’Anaïs Lelièvre”, catalogue Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024. Exposition Anaïs Lelièvre, Fluctuat, Musée départemental de la Céramique, Lezoux, 2024.
Anaïs Lelièvre se laisse traverser par le paysage et par ce qui émane de la matière minérale. Elle se rend disponible aux signes qui révèlent, comme elle le dit, qu’« en dessous ça travaille ». Sa sensibilité à la nature, et particulièrement aux espaces hostiles produits par les convulsions telluriques, s’aiguise à l’occasion de nombreux voyages notamment en Islande où elle se rend en 2015 et en 2019 : les contrastes entre la neige et la noirceur basaltique de cette île qui s’apparente à une immense pierre de lave font alors naître chez elle une sensation de perte de repère ; ils nourrissent depuis ses dessins et ses installations. Au-delà de cet effet d’optique saisissant, la puissance du sous-sol rendue manifeste à la surface de la croûte terrestre oriente le regard de l’artiste vers le minéral qu’elle expérimente à travers la céramique, après cette première résidence en Islande. Son besoin d’entrer physiquement en contact avec l’histoire géologique la guide ainsi vers de nombreux sites spectaculaires tels que le massif du Vercors, les grottes de Thaïs (Drôme) et de Choranche (Isère), les carrières de Roure et de Pouzzolanes des Dômes (Puy-de-Dôme), la pointe de Séhar (Côtes-d’Armor), le glacier d’Aletsch (Valais, Suisse) ou encore le désert d’Al-Ula (Arabie saoudite). En 2022, une résidence à La Junqueira (Lisbonne) fut par ailleurs l’occasion pour Anaïs Lelièvre de développer un travail autour de Terramoto, un des plus forts séismes enregistrés en Europe qui bouleversa le rapport philosophique et esthétique à la nature dans la pensée occidentale après avoir ravagé la capitale portugaise en 1755.
La faille de Limagne
La résidence réalisée par Anaïs Lelièvre fin 2023 au musée de la Céramique de Lezoux procède elle aussi de sa passion pour les sites géologiques exceptionnels, en l’occurrence la chaîne des Puys-faille de Limagne inscrite en 2018 sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l’Unesco en tant que « haut lieu tectonique » [1]. Situé au nord du Massif central, ce territoire a la particularité de permettre d’observer dans un périmètre relativement restreint toutes les étapes de la formation d’un rift. La fissure qui ouvrit la croûte continentale il y a 35 millions d’années se lit lorsque, ayant traversé la chaîne des Puys, on amorce une descente abrupte vers une plaine encore chargée des sédiments qui s’y déposèrent au fil du temps et qui rappellent la présence de l’eau qui jadis y ruissela. Par ailleurs, les nombreux volcans signalent l’émergence du magma profond et le soulèvement généralisé de la surface qui suivit l’ouverture de la faille [2]. Le paysage auvergnat est ainsi en lui-même une sorte de modèle réduit particulièrement lisible, permettant de comprendre, à l’échelle d’une région, un phénomène planétaire. Aussi, brisure et liquéfaction dessinèrent l’axe qui orienta toute la recherche contextuelle et plastique de cette résidence. De retour à l’atelier, la céramique offre une autre voie d’accès, en accéléré, à la connaissance d’un territoire, et c’est précisément sur cette ligne de crête, entre exploration et expérimentation, que la démarche d’Anaïs Lelièvre prend tout son sens. La proximité qu’elle identifie et qu’elle affectionne entre le travail de la nature et celui du céramiste correspond d’ailleurs à la métaphore filée par le géographe, écrivain, anarchiste et écologiste Élisée Reclus dans son livre Histoire d’une montagne : « Pris en son ensemble, le mont est un immense laboratoire naturel, où toutes les forces physiques et chimiques sont à l’œuvre, se servant, pour accomplir leur travail, de cet agent souverain que l’homme n’a pas à sa disposition, le temps [3]. »
Mettre à l’épreuve des fragments de paysage
Loin de s’en tenir à une contemplation de la nature, fût-elle inspirante, Anaïs Lelièvre accorde dans son travail une grande importance aux échanges avec les scientifiques et à la compréhension des transformations tant à l’échelle microscopique que macroscopique. Sa résidence à Lezoux fut ainsi émaillée d’échanges avec le géologue Charley Merciecca ainsi qu’avec les chercheurs de l’Observatoire de Lyon (où elle est en résidence cette même année) autour des particularités des minéraux qui caractérisent le Massif central et la plaine Limagne. De même, l’histoire archéologique de Lezoux, marquée par la production massive de céramique sigillée à l’époque gallo-romaine, fut l’objet d’échanges stimulants avec les équipes du musée notamment Alain Maillot (responsable des collections et des résidences) et Yvon Lecuyer, ainsi qu’avec l’archéologue Philippe Bet qui l’invita à prendre part à un symposium de céramologie antique [4].
Ce goût d’Anaïs Lelièvre pour les rencontres entre art et science n’est pas sans rapport avec son intérêt et sa pratique de la céramique, discipline dans laquelle recherche formelle et expérience des phénomènes physico-chimiques sont indissociables. En découvrant la chaîne des Puys-faille de Limagne, elle a ainsi collecté des minéraux qui ont pu ensuite faire l’objet, une fois en atelier, de tests de cuissons, avec variations de dosages ou combinaisons de matériaux. Ce travail de recette et d’échantillonnage, assez classique en apparence, ne procède chez elle ni d’une recherche de maîtrise (d’une teinte, d’une texture, ou d’une brillance) ni du plaisir pur de l’accident, mais plutôt du désir de mettre à l’épreuve des fragments de paysage et de rejouer la gigantomachie minérale du sous-sol. Sa série intitulée Oikos-fluit est ainsi née de multiples cuissons de terres locales (roche sédimentaire marno-argileuse) et de pierres de lave, simplement posées sur des plaques de grès, sans aucun adjuvant. Les résultats obtenus donnent à voir des écoulements qui font autant écho à la lave en fusion jaillissant des volcans d’Auvergne, qu’à l’eau qui occupait la faille de Limagne il y a plus de 30 millions d’années. Les deux types de minéraux qui caractérisent ainsi cette partie du Massif central se rejoignent et fusionnent au sein d’une œuvre qui relativise, à l’échelle de la planète, les séparations et classements opérés par la science moderne. Cette manière qu’a Anaïs Lelièvre de porter sur le minéral un regard libéré des idées reçues (inertie, passivité, immuabilité) fait écho au travail du philosophe François Dagognet qui chercha à « relever le caillou ou le galet de la défaveur qui le frappe » dans la pensée occidentale : « Nous sommes bien en présence d’un remue-ménage, qui brasse et annule les distinctions. Le changement – le passage du sédimentaire au compressé – peut encore venir de l’entrée d’une montée magmatique dans les roches encaissées ; mais la seule proximité du feu (le métamorphisme non pas d’inclusion mais de contact) nous vaut une sorte de cuisson géante et à nouveau l’intersection ou, du moins, la superposition des processus formateurs. Se mêlent la surface et la profondeur, la descente et la montée, l’eau et le feu. Nous évoluons dans le monde du brouillé. C’est pourquoi la pierre, qu’on prenait comme symbole de l’immobilité structurale, de la dureté et de la stabilité, se définit plutôt comme le friable et le mouvant (premier reproche qui lui est adressé) ; elle n’échappe pas au tourbillonnaire ; du fait même, elle semble ne relever que d’une phénoménalité erratique (se fermeraient devant elle les portes de l’ontologie) [5]. »
L’intérêt de l’artiste pour les brèches, les failles, les cassures, autant de motifs qui marquent à la fois son vocabulaire plastique et ses recherches théoriques, peut là encore être mis en relation avec une curiosité d’inspiration scientifique consistant à profiter d’une ouverture accidentelle pour voir l’intérieur habituellement dissimulé et en comprendre les évolutions. Cet appétit d’exploration, Anaïs Lelièvre ne cherche pas à le restituer fidèlement ou via des pièces illustratives, ce qu’elle cherche à transmettre c’est moins une forme figée que l’énergie ou la sensation de flux perceptible dans les chaos minéraux, pour peu qu’on se donne la peine, à l’instar d’Élisée Reclus, de les observer attentivement : « Soumises à de lentes pressions séculaires, la roche, l’argile, les couches de grès, les veines de métal, tout se plisse comme le ferait une étoffe, et les plis qui naissent ainsi forment les monts et les vallées. […] Sans cesse les roches de la Terre se trouvent soumises à ces impulsions latérales qui les ploient et les reploient diversement, et les assises sont dans une fluctuation continuelle [6]. »
Ces effets de plissés, de craquelures, de pics et de dépressions rythment ses céramiques depuis les premières sculptures de la série Gloc, débutée en 2016, jusqu’aux grandes pièces réalisées à Lezoux, en passant par la série Poros-Oikos qui porte dans son titre et dans la couleur noir mat du grès qu’elle utilise le souvenir de la pierre de lave rugueuse et abrasive qui l’inspire tant. Et Oikos-littera-fluit figure des cassures d’où émerge un écoulement évoquant l’origine de roches et argiles avec lesquelles les hommes construisirent localement leurs demeures.
« De quoi les murs sont-ils faits ? »
De la série Terramoto aux grandes sculptures réalisées à Lezoux, en passant par les « immeubles » de Fondements, de nombreuses céramiques d’Anaïs Lelièvre présentent la forme d’une architecture, d’une maison, ou plutôt d’une idée de maison, réduite à son plus simple appareil : des murs formant un parallélépipède, un toit, qui pourrait tout autant schématiser une montagne. Aucun détail ne saurait identifier ou contextualiser ces constructions abstraites et presque génériques. Ce sentiment est renforcé par l’impression de se trouver face à un carottage géologique, une ponction d’un volume de matière enlevée à l’emporte-pièce par un moule métallique imprimant à l’argile ce profil à cinq côtés. Dans Oikos-littera-fluit, unifiés par la couleur homogène du grès noir, les bords formés par le contact avec le moule rendent lisible le motif. Pour Oikos-fluit, les angles aigus s’inscrivent davantage dans le vocabulaire de l’architecture gothique, les flèches des cathédrales, les pinacles ; ils évoquent de plus une dynamique de percée, de direction ou d’attaque autant qu’une frontalité qui fait bouclier, protection, contenance. Les œuvres de la série Poros-Oikos, transpercées de milliers de trous piqués à la pointe sèche, présentent une résille minérale qui semble accidentée, tranchante, poreuse. Cette profusion de textures associée à la teinte sombre du grès noir peut là encore évoquer les dentelles de pierre de l’architecture gothique flamboyante qu’elle a notamment côtoyées dans le cloître de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors avec son installation Pinnaculum (2019). Ce style lié théologiquement et physiquement à la présence de la lumière dans l’édifice est toutefois envisagé par Anaïs Lelièvre à une autre échelle : son regard se pose moins sur la virtuosité des remplages, des rosaces ou des baies, que sur les pierres qui les composent et dont elle montre la rugosité, les jeux de plein et de vide, les traces infimes de leur genèse, bref l’impermanence qui se dissimule derrière une apparente immuabilité. Le souvenir de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, dont la silhouette sombre en pierre de Volvic domine la ville de Clermont-Ferrand, est d’ailleurs bien présent à l’esprit d’Anaïs Lelièvre. Elle adapte ainsi à son langage plastique une analogie entre les concrétions de lave et l’architecture médiévale qui nourrit l’imaginaire littéraire du xixe siècle, à commencer par Jules Verne dans son célèbre Voyage au centre de la Terre : « La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale. Parfois une succession d’arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d’une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l’ogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes [7]. »
Les « parois » des constructions d’Anaïs Lelièvre sont loin d’être parfaitement lisses : elles présentent des déformations, des fissures, semblent se désagréger partiellement à la manière de murs en pisé tels que ceux visibles dans les rues de Lezoux, et qui, sans entretien régulier, se craquèlent et s’effritent sous l’action des intempéries. Anaïs Lelièvre s’y arrête d’ailleurs régulièrement et y observe les allers-retours entre construction et ruine, la rencontre éphémère de l’histoire géologique avec l’histoire architecturale. Si ces murs émeuvent et inspirent l’artiste, c’est que la matière sédimentaire qui les compose est un héritage de l’histoire géologique de ce territoire. « De quoi les murs sont-ils faits ? », la question qui intéresse l’artiste se pose également à la vue du musée de la Céramique de Lezoux, installé dans l’ancienne fabrique de grès et faïences Bompard réalisée en moellons et briques (bâtiment, fours, cheminées) et dont l’existence, toute comme celle des ateliers romains de sigillée, est liée notamment à la présence massive d’argiles dans le bassin sédimentaire de Limagne.
Sur les sculptures de la série Oikos-littera-fluit, les surfaces à la fois géométriques et imparfaites côtoient une face animée de formes plus chaotiques modelées à la main par l’artiste et dont la profondeur est rendue imperceptible par la glaçure qui les recouvre : un fourmillement de coulures noires et blanches entremêlées, un réseau très dense de veines minérales. Les effets d’ombre et de lumière qui habituellement aident notre œil à comprendre le volume d’une forme sont ici contredits, perturbés par le surplus de détails, d’irrégularités et l’imbrication des contrastes. La forme liquide de l’émail, semblable à une coulée de lave qui dévore le paysage et le désorganise, s’oppose ainsi à l’aspect bâti des murs droits, au caractère aérien des toits pentus.
Au creux de l’énigme
Chargée de sous-sol, nourrie d’architecture, la céramique d’Anaïs Lelièvre n’en délaisse pas moins les arts graphiques : si le dessin est dans une certaine mesure un héritage familial (par son père et ses arrière-grands-parents), Anaïs Lelièvre cherche constamment à faire exister cette pratique au-delà de la feuille et à l’emmener vers d’autres territoires. L’application d’un émail blanc sur un émail noir, le tout posé sur un grès noir, lui permet de transposer et de faire évoluer dans l’argile les effets de contrastes forts de l’encre sur le papier qui constellent son univers. Le rôle de l’encre, qu’elle a déjà habilement mêlée à l’argile dans les œuvres produites à l’occasion de sa résidence à Lisbonne, est régulièrement joué par l’émail ou par une couche de porcelaine. Les coulures et les bulles forment des réseaux denses de veines et offrent au regard d’innombrables variations d’intensité chromatique. Le caractère aléatoire de la cuisson est bien présent et l’artiste lui délègue une partie du dessin, mais il demeure dirigé, orienté sur des zones précises des sculptures. Ainsi orchestré, le chaos formel s’apparente à une signature autogénérée propre à chaque pièce, à un code qui se déploie en trois dimensions avec d’autant plus de force.
Du dessin à l’écriture, il n’y a qu’un pas qu’Anaïs Lelièvre franchit régulièrement avec l’énigme comme fil rouge. Estampés sur des feuillets de porcelaine de la série Archives (Lettres A), les caractères d’imprimerie conservés à la Maison Lamourelle (Carcassonne) sont muets. Dans une profusion désordonnée, ces lettres figées par le feu évoquent la destruction des archives de la cité occitane lors des secousses révolutionnaires. Sur les pièces réalisées à Lezoux, des symboles inscrits en creux dans la matière identifient les œuvres de cette série et leur confèrent le statut de signes fragmentaires. Attiré par la matière, le regard d’Anaïs Lelièvre l’est tout autant par les mystérieux textes religieux en gallo-latin qui ornent certaines céramiques sigillées conservées à Lezoux et même par les inscriptions techniques (numéros d’inventaire, dates de fouille, etc.) reportées sur les tessons par les archéologues. En plus de sa propre histoire, la terre est revêtue de strates culturelles complexes. L’énigme du déchiffrage stimulant l’imaginaire, comment ne pas songer aux héros de Voyage au centre de la Terre bouleversés par la découverte du nom de leur prédécesseur « Arne Saknussemm » inscrit en caractères runiques sur les parois de lave du volcan islandais Sneffels [8] ? Faut-il plutôt y voir un écho aux marques et initiales laissées par les artisans sur les milliers de pierres taillées qui composent une cathédrale ? Ou par analogie avec le monde organique, à un génome mystérieux du « règne minéral » ? Qu’on les envisage sous l’angle de la trace ou du programme, les inscriptions gravées par Anaïs Lelièvre sur ses œuvres donnent à penser la pierre hors de la permanence anhistorique dans laquelle elle est souvent cantonnée, et à la percevoir au sein du cycle vertigineux de la matière.
Dans Oikos-littera-fluit, l’Histoire se construit par la brisure. Elle persiste, fragmentaire, à travers ses parts d’inconnus qui motivent l’archéologie et sa propre production textuelle. Ces céramiques sont d’ailleurs présentées sur des supports-tables, les hissant, du sol vers le niveau de l’étude, par une mise au regard qui tend à rappeler comment l’archéologue Philippe Bet a pu, en ce même lieu d’exposition, disperser de multiples tessons sur des tables pour tenter de les recomposer, toujours partiellement. La matière y est signe autant qu’énigme. Et le visiteur est invité à circuler à l’intérieur de ce paysage langagier, entre ces supports aux panneaux blancs telles des feuillets d’écriture.
Les céramiques d’Anaïs Lelièvre invitent ainsi à se pencher à l’aveugle sur le langage oublié de la matière. Ses œuvres donnent à voir le chaos minéral, non comme un support inerte, froid et étranger mais bien comme un livre qui parle à la sensibilité. Indéchiffrable par la raison comme peut l’être un manuscrit ancien écrit dans un idiome inconnu, son sens nous échappe mais pas la conscience de se trouver face à une masse pesante, chargée d’énergies, lourde des catastrophes passées et à venir, riche de potentiel créatif et de mouvement.
Notes
[1] Voir la description sur le site de l’Unesco : whc.unesco.org/fr/list/1434, consulté le 26/06/2024.
[2] Schémas de l’évolution géologique sur le site : chainedespuys-failledelimagne.com/le-bien/la-faille-de-limagne, consulté le 26/06/2024.
[3] Élisée Reclus, Histoire d’une montagne, histoire d’un ruisseau (1868-1869), Montreuil, Libertalia, 2023, p. 69.
[4] VIIIe symposium interuniversitaire de céramiques antiques, organisé du 28 octobre au 5 novembre 2023 par la Maison des sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand.
[5] François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’Abject. Une philosophie écologique, Le Plessis-Robinson, Les empêcheurs de penser en rond, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 1997, p. 164-165.
[6] Élisée Reclus, op. cit., p. 54.
[7] Jules Verne, Voyage au centre de la Terre (Paris, J. Hetzel Éditeur, 1864), Paris, Hachette, 2005, p. 178.
[8] Ibid., p. 154.
Ursula Panhans-Bühler, “Anaïs Lelièvre : Mémoire du corps et espaces caverneux”, version amplifiée (décembre 2024), exposition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.
Le travail artistique d’Anais Lelièvre (1982 aux Lilas ; vit et travaille à Paris, France) explore la relation entre la mémoire du corps et les espaces géologiques, “ici et ailleurs”. A KAI 10, elle a présenté l‘installation RÉTINE, montée pour la première fois en 2021 au Château de Rentilly. Cette installation fut mise en regard avec une céramique de la série Oikos-Poros (“Maison-Porosité”), créée en 2020 après une deuxième résidence en Islande : l‘habitation y apparaît comme un espace délimité et creusé, troué, à la fois fragilisé et ouvert à la circulation. Ses installations sont toujours basées sur un seul dessin à l’encre, en noir et blanc. Celui-ci est scanné numériquement pour être reproduit sans limite, à des échelles de plus en plus grandes et de plus en plus petites, le motif original révelant ses détails ou se dissolvant complètement. Dans le cas de l’espace immersif - presque caverneux - de RÉTINE, le dessin reproduit est imprimé sur des plaques de PVC, que l‘artiste taille en angles aigus et à partir desquelles elle construit une sorte de corps, à la fois cristallin, sculptural et architectural, qui semble émerger d’un sol accessible au visiteur. Ce réseau ou tissu graphique, qui génère une grande complexité de plans, se transforme ainsi à nos yeux en excroissances interreliées et chaotiques, voire mouvantes.
Dans un commentaire poétique de RÉTINE, l’artiste écrit : “Par petites touches, fluctuantes, le dessin d’une vue microscopique de rétine est numériquement multiplié et agrandi jusqu’à devenir un environnement immersif. Faisant jeu de cette réversibilité, ce dessin-matrice des bâtonnets et cônes rétiniens (capteurs de lumière) génère une spatialité étrange, qui semble emprunter dans le même temps ses principes de reproduction, de croissance et de verticalité à celle de pousses végétales. […] Dans cet espace hybride, perdre tous repères visuels et conceptuels”.
Une idée étonnante que de refléter un minuscule détail de la rétine de l’œil, enregistré au microscope électronique, dans une si grande installation, un espace pénétrable ! En règle générale, l’artiste se focalise sur des phénomènes géologiques qu’elle rencontre et développe artistiquement lors de résidences dans de nombreux pays : comme les strates de roches friables de schiste dans les montagnes suisses ou les pierres de lave poreuses autour des volcans islandais. Dans le cas de RÉTINE, le sujet est cependant la fragile paroi interne de notre œil, intégrée dans la cavité osseuse du crâne - une camera obscura naturelle, capable de refléter en nous le monde entier, vibrant de photons. Mais dans sa multiplication, le caractère reconnaissable de l’enregistrement photographique se perd, et une proximité avec les grottes géologiques réapparaît autrement.
L’idée de RÉTINE s’est enrichie de plusieurs impressions lorsqu’Anais Lelièvre a répondu à une invitation à participer à l’exposition Paysages rêvés, paysages réels au Château de Rentilly. Il s’agissait de la première exposition du musée Gatien-Bonnet après que sa collection néo-impressionniste ait déménagé en 2021 dans le château restauré. Dans ce même lieu, habitait au XIXe siècle un éminent savant, Adolphe Thuret, qui s’est plongé très tôt dans le monde étrangement fascinant et microscopique des algues en biologie marine, dont il a découvert la vie instinctive ; des expériences qu’il a immortalisées dans ses dessins. Anaïs Lelièvre a reconnu dans les recherches de Thuret une affinité qui a contribué à l’émergence de son projet RÉTINE. A cela s’ajoute une expérience pointilliste de la nature, peut-être déclenchée par son admiration pour la collection néo-impressionniste du musée Gatien-Bonnet, et qui l’a saisie dans la forêt du domaine de Rentilly : lors de sa promenade dans la lumière ponctuée des multiples ombres des feuillages et agitée en tous sens, elle y ressentit une perte de repères visuels et spatiaux.
Nous pouvons aussi ajouter un aspect spécifique au présent du lieu, qui n’a échappé à aucun visiteur du parc : la nouvelle peau de miroir qui enveloppe le château historique depuis 2014 réagit à chaque mouvement des promeneurs par une réfraction troublante du parc reflété, car la structure des parois irrégulières des miroirs suit le relief de l’ancienne architecture. L’installation d’Anaïs Lelièvre repose en revanche sur un retournement ‘rétinien’ ingénieux vers l’intérieur. Et c’est ainsi qu’en tant que visiteur de la première mise en scène de sa cavité rétinienne en 2021-2022, nous pouvions y voir un contrepoint haptique fluide à l’espace miroir optique du château, et en même temps un contrepoint spatio-temporel, car RÉTINE relie des dimensions proches et des dimensions éloignées de l’histoire de la Terre, tandis que la peau-miroir du château nous relie au parc actuel du château.
Mais même sans référence spécifique au lieu, comme ce fut le cas de sa réadaptation à KAI 10 en 2023, RÉTINE conserve une immense complexité. L’installation concentre des questions clés du travail artistique d’Anaïs Lelièvre. Les corps animaux - incluant aussi les nôtres - sont des espaces d’origine, de résonance et de mémoire, intégrant des expériences psychiques qui dépassent en même temps l’histoire de notre genre spécifiquement organique. Les cavernes imaginaires de l’artiste tissent et enchevêtrent des moments inorganiques-architecturaux et organiques-plastiques. Il en va de même du parcours à travers l’espace de RÉTINE. Dans ses perspectives déroutantes, il se resserre et se densifie jusqu’à ce que des symétries fugaces nous fixent de manière hypnotique, comme s’il s’agissait de fantômes reflétés qui - tel que nous le fantasmons - nous traversent la moelle et les jambes et nous exposent à un choc, joyeusement productif, à l’instar de chaque tremblement atavique de la croûte terrestre auquel nous avons survécu.
La porcelaine de la série Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre était également basée sur un seul dessin multiplié. Le modèle était cette fois-ci la surface rugueuse et poreuse d’un fragment de lave, dont elle interprétat les ondes ou anneaux de résonance de sa porosité comme un enchevêtrement du mouvement de l’espace et du temps, basé sur les particularités de chaque plissement. Dans l’installation RÉTINE, le visiteur en mouvement active un processus similaire. Les plis cristallins qui se superposent, semblent s‘ouvrir et se fermer, comme s’ils étaient déclenchés par leur propre contre-mouvement dans l’espace et le temps, tandis que l’on pénètre soi-même dans ce tissu labyrinthique et proliférant et que l’on se sent aspiré en lui. Dans chaque pliage se trouve un processus spatio-temporel, présent dans sa matérialité réelle et activé par la transformation temporaire de sa forme, telle qu’elle est perçue dans la marche. Le labyrinthe de pliages d’Anaïs Lelièvre va bien au-delà d’un jeu interactif inoffensif entre les spectateurs et le lieu. Certes, c’est nous qui mettons ce processus en marche. Mais en même temps, ce dernier nous entraîne avec une irritante autonomie dans un fascinant jeu de confusion. Il en résulte une immersion paradoxale. Alors que la confiance en une vue d’ensemble ou en un contrôle de notre espace et de notre temps nous accompagne normalement, nous perdons toute sécurité dans le tourbillon hypnotique de cet espace factice. Sa situation de seuil suspend notre ordre habituel de l’espace et du temps. Le proche et le lointain confondus nous plongent dans des tensions contradictoires et nous perdons nous-mêmes notre orientation dans un étrange “univers en trompe-l’œil” (Yona Friedman). Nous voulons souligner cette opposition entre une architecture plissée cristalline et un tissu rétinien dynamique et proliférant par deux questions pièges astucieuses de l’artiste franco-algérien Maurice Benayoun : “Dieu est-il plat ? Le diable est-il plié ?” – un argument pour l’enchevêtrement, déjà présent dans chaque processus de pliage spatio-temporel, constituant également la tension productive du travail artistique d’Anaïs Lelièvre. Car dans le domaine artistique, un “ou bien ou bien” est plutôt un point de départ, mais jamais ne prétend à une solution.
Entretien avec Rodolphe Cassou et Maider Darricau, revue Urbanisme, n° 437, mai-juin 2024, p. 88-90.


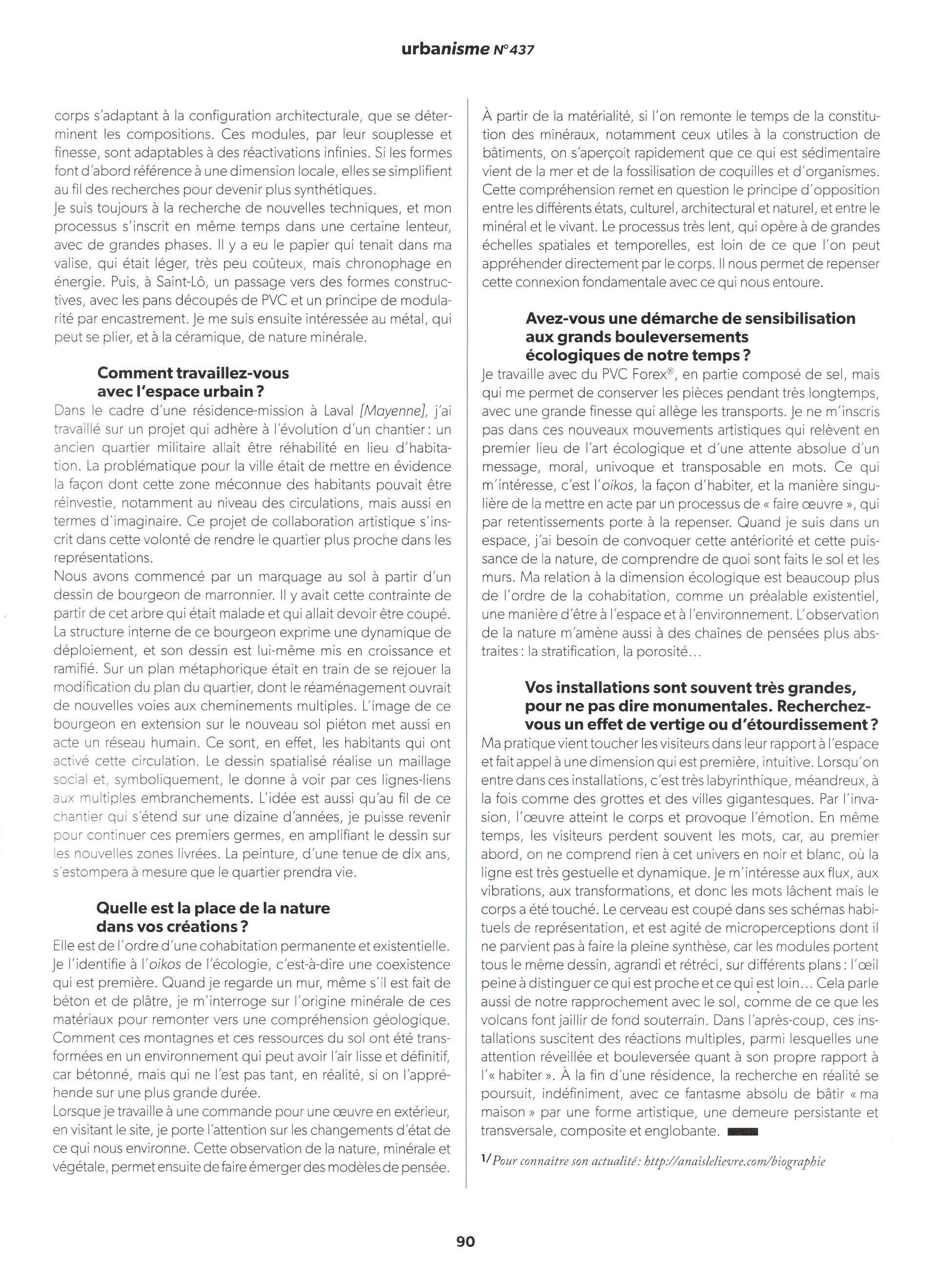
Comment avez-vous démarré votre pratique ?
Plus qu’un commencement, celle-ci s’est déployée depuis les premiers gestes du dessin. J’ai commencé par une double formation universitaire en arts plastiques et en sciences de l’art, qui s’est poursuivie en école de beaux-arts. En parallèle, j’ai démarré une thèse doctorale sur « L’art d’habiter par la création numérique » qui se fondait sur une pratique d’installations procédant par extension d’images digitales. Je fus assez vite attirée par les espaces extérieurs. Peu à peu, le processus de création est devenu intrinsèquement lié au déplacement en résidence, avec ce besoin d’être réimpulsée par la rencontre avec le contexte et avec l’ailleurs. Ce rapport existentiel à la découverte, à l’inhabituel devient, en effet, le lieu d’un inconfort stimulant : il me fait réouvrir les yeux et réagir en fonction, pour créer en quelque sorte un nouvel espace d’« habitation ». Toute l’ambiguïté de l’expression de « résidence » de création se trouve dans le fait que l’on évoque la maison, la demeure, dans un endroit où nous n’avons aucun rapport au « chez soi », puisqu’au contraire l’on s’y déplace vers un inconnu. C’est une pratique qui est devenue structurelle dans le développement de mon mode de vie autant que dans la forme même de création. Les installations se réagencent à mesure de leurs circulations, ce qui génère de nouvelles configurations que je n’aurai pu anticiper. C’est important pour moi d’être sur site, car contrairement à une documentation livresque – même si elle m’accompagne aussi –, c’est d’abord une relation empirique à l’espace, que je découvre principalement par la marche.
Qu’apporte la résidence à votre travail ?
Ma première résidence a eu lieu en Islande. Ces paysages noirs de lave et blancs de neige ont profondément changé ma pratique. Pendant longtemps j’ai été très casanière, et j’ai vécu cette résidence comme une première porte vers l’ailleurs. Cette métaphore de la porte, du mur et du sol, est constante quand je décris mon travail, comme si l’ensemble devenait une manière de construire ma « maison » – à force de ne plus en avoir ou d’en avoir de multiples. Toutefois, une recherche de continuité se trame progressivement. Cette lave explorée en Islande, je l’ai retrouvée sous d’autres formes, au Dourven [Côtes-d’Armor, ndlr], à Lisbonne ou actuellement autour de Lezoux [Puy-de-Dôme]. Au-delà du local, je travaille des problématiques qui peuvent être transversales, aux niveaux géologique, mais aussi urbain et humain, de l’ordre de l’inconscient, de l’imaginaire et de la mémoire des lieux.
Quand est né votre intérêt pour l’architecture ?
Lorsque j’étais en résidence à Juazeiro au Brésil, en me promenant dans les rues, j’ai constaté que ma marche était complètement désorientée par des tas de matériaux de construction, récurrents sur les trottoirs. Ce qui peut sembler accidentel va m’apparaître comme un indice d’un phénomène plus structurel. Au Brésil, il s’agit de ces nombreux chantiers de construction interrompus voire arrêtés. Mon approche procède d’abord d’une sensation physique dans l’espace, aiguisée par une désorientation.
En marchant, je m’intéresse aux sols et aux matériaux. Je prends le temps d’observer de près les fentes, superpositions, textures et fragilités des murs. À Lezoux par exemple, on voit de nombreux murs en pisé avec des réemplois de briques ; tout en apprenant, par son histoire de la céramique, que cette ville est bâtie sur de l’argile, du fait de la faille de Limagne, liée aux mouvements tectoniques. Les murs dévoilent des strates plurielles, où les restes anciens sont associés à des parties nouvelles, qui tentent de les faire persister. Partir ainsi de ce que l’on voit des matériaux environnants et de leur altération, pour remonter à une compréhension de processus géologiques à grande échelle.
La série Stratum s’est amorcée lors d’une résidence en Suisse : en me promenant autour de la ville de Sion, je découvre un mur qui s’effrite. Cette pierre de schiste argileux que je récupère marque un effritement de la représentation archétypale du mur comme étant un élément solide et stable. De cette pierre, un dessin fut tracé, puis multiplié numériquement par agrandissement et rétrécissement, et imprimé sur du papier, jusqu’à recouvrir une salle entière. Celle-ci était dans le même temps déstructurée par plans, avec des matériaux récupérés sur place, comme d’anciens volets ou portes. C’était là une manière de ne faire que transformer ce qui était déjà existant ; avec aussi en arrière-plan, un intérêt alors d’actualité à Sion pour les risques sismiques, dus au mouvement d’autres strates, à une échelle tectonique. Un an plus tard, en résidence à Saint-Lô [Manche], j’ai appris que la ville était bâtie sur une colline de schiste, matériau utilisé pour la construction et que l’on aperçoit encore après la reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Cette exploration du schiste à travers deux sites m’engagea à développer le principe de stratification comme une modalité spatiale et temporelle d’installation.
Quelle est votre relation aux matériaux ?
La première installation en Suisse était composée de feuillets de papier, évoquant à la fois le mouvement, l’informe et une matérialité minérale. De 2018 à 2021, la série Stratum s’est augmentée de lieu en lieu, à chaque nouvelle résidence de création. Des modules supplémentaires ont été conçus en référence à des éléments locaux, liés à des questions de dégradation des matériaux, de ressources constructives, de transformation du bâti. Un grand rassemblement prit place à Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] par l’agencement provisoire de tous ces modules, comme une micro-ville. Sur le plan de salle, chacun des Stratum numérotés renvoie à son contexte de référence. Le mode d’assemblage n’est pas planifié. C’est dans l’expérience de l’avancement, à partir du corps s’adaptant à la configuration architecturale, que se déterminent les compositions. Ces modules, par leur souplesse et finesse, sont adaptables à des réactivations infinies. Si les formes font d’abord référence à une dimension locale, elles se simplifient au fil des recherches pour devenir plus synthétiques.
Je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques, et mon processus s’inscrit en même temps dans une certaine lenteur, avec de grandes phases. Il y a eu le papier qui tenait dans ma valise, qui était léger, très peu coûteux, mais chronophage en énergie. Autant que possible j’enlevais à la fin toutes les feuilles pour les conserver. Puis, à Saint-Lô, un passage vers des formes constructives, avec les pans découpés de PVC et un principe de modularité par encastrement. Je me suis ensuite intéressée au métal, qui peut se plier, et à la céramique, de nature minérale.
Comment travaillez-vous avec l’espace urbain ?
Dans le cadre d’une résidence-mission à Laval [Mayenne], j’ai travaillé sur un projet qui adhère à l’évolution d’un chantier : un ancien quartier militaire allait être réhabilité en lieu d’habitation. La problématique pour la ville était de mettre en évidence la façon dont cette zone méconnue des habitants, pouvait être réinvestie, notamment au niveau des circulations, mais aussi en termes d’imaginaire. Ce projet de collaboration artistique s’inscrit dans cette volonté de rendre le quartier plus proche dans les représentations.
Nous avons commencé par un marquage au sol à partir d’un dessin de bourgeon de marronnier. Il y avait cette contrainte de partir de cet arbre qui était malade et qui allait devoir être coupé. La structure interne de ce bourgeon exprime une dynamique de déploiement, et son dessin fut lui-même mis en croissance et ramifié. Sur un plan métaphorique était en train de se rejouer la modification du plan du quartier, dont le réaménagement ouvrait de nouvelles voies aux cheminements multiples. L’image de ce bourgeon en extension sur le nouveau sol piéton met aussi en acte un réseau humain. Ce sont, en effet, les habitants qui ont activé cette circulation. Le dessin spatialisé réalise un maillage social et, symboliquement, le donne à voir par ces lignes-liens aux multiples embranchements. L’idée est aussi qu’au fil de ce chantier qui s’étend d’une dizaine d’années, je puisse revenir pour continuer ces premiers germes, en amplifiant le dessin sur les nouvelles zones livrées. La peinture, d’une tenue de dix ans, s’estompera à mesure que le quartier prendra vie.
Quelle est la place de la nature dans vos créations ?
Elle est de l’ordre d’une cohabitation permanente et existentielle. Je l’identifie à l’oikos de l’écologie, c’est-à-dire une coexistence qui est première. Quand je regarde un mur, même s’il est fait de béton et de plâtre, je m’interroge sur l’origine minérale de ces matériaux pour remonter vers une compréhension géologique. Comment ces montagnes et ces ressources du sol ont été transformées en un environnement qui peut avoir l’air lisse et définitif car bétonné, mais qui ne l’est pas tant, en réalité, si on l’appréhende sur une plus grande durée.
Lorsque je travaille à une commande pour une œuvre en extérieur, en visitant le site, je porte l’attention sur les changements d’état de ce qui nous environne. Cette observation de la nature, minérale et végétale, permet ensuite de faire émerger des modèles de pensée. À partir de la matérialité, si l’on remonte le temps de la constitution des minéraux, notamment ceux utiles à la construction de bâtiments, on s’aperçoit rapidement que ce qui est sédimentaire vient de la mer et de fossilisation de coquilles et d’organismes. Cette compréhension remet en question le principe d’opposition entre les différents états, culturel, architectural et naturel, et entre le minéral et le vivant. Le processus très lent qui opère à de grandes échelles spatiales et temporelles, est loin de ce que l’on peut l’appréhender directement par le corps. Il nous permet de repenser cette connexion fondamentale avec ce qui nous entoure.
Avez-vous une démarche de sensibilisation aux grands bouleversements écologiques de notre temps ?
Je travaille avec du PVC forex, en partie composé de sel, mais qui me permet de conserver les pièces pendant très longtemps avec une grande finesse qui allège les transports. Je ne m’inscris pas dans ces nouveaux mouvements artistiques qui relèvent en premier lieu de l’art écologique et d’une attente absolue d’un message, moral, univoque et transposable en mots. Ce qui m’intéresse, c’est l’oikos, la façon d’habiter, et la manière singulière de la mettre en acte par un processus de « faire œuvre », qui par retentissements porte à la repenser. Quand je suis dans un espace, j’ai besoin de convoquer cette antériorité et cette puissance de la nature, de comprendre de quoi sont faits le sol et les murs. Ma relation à la dimension écologique est beaucoup plus de l’ordre de la cohabitation, comme un préalable existentiel, une manière d’être à l’espace et à l’environnement. L’observation de la nature m’amène aussi à des chaînes de pensées plus abstraites : la stratification, la porosité…
Vos installations sont souvent très grandes, pour ne pas dire monumentales. Recherchez-vous un effet de vertige ou d’étourdissement ?
Ma pratique vient toucher les visiteurs dans leur rapport à l’espace et fait appel à une dimension qui est première, intuitive. Lorsqu’on entre dans ces installations, c’est très labyrinthique, méandreux, à la fois comme des grottes et des villes gigantesques. Par l’invasion, l’œuvre atteint le corps et provoque l’émotion. En même temps, les visiteurs perdent souvent les mots car, au premier abord, on ne comprend rien à cet univers en noir et blanc, où la ligne est très gestuelle et dynamique. Je m’intéresse aux flux, aux vibrations, aux transformations, et donc les mots lâchent mais le corps a été touché. Le cerveau est coupé dans ses schémas habituels de représentation, et est agité de microperceptions dont il ne parvient pas à faire la pleine synthèse, car les modules portent tous le même dessin, agrandi et rétréci, sur différents plans : l’œil peine à distinguer ce qui est proche et ce qui est loin… Cela parle aussi de notre rapprochement avec le sol, comme de ce que les volcans font jaillir de fond souterrain. Dans l’après-coup, ces installations suscitent des réactions multiples, parmi lesquelles une attention réveillée et bouleversée quant à son propre rapport à l’« habiter ». À la fin d’une résidence, la recherche en réalité se poursuit, indéfiniment, avec ce fantasme absolu de bâtir « ma maison » par une forme artistique, une demeure persistante et transversale, composite et englobante.
Ursula Panhans-Bühler and Ludwig Seyfarth, exhibition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.
Anaïs Lelièvre (1982 in Lilas; lives and works in Paris, France), proceeding from drawings she makes while traversing landscapes, explores the conscious and unconscious perception, and experience of real, illusionary or virtual spaces. At KAI 10, she is showing her spatially expansive installation Rétine, first mounted in 2021 at Château Rentilly near Paris, complemented by a ceramic work from her series Oikos-Poros (Porous House, 2020) – each dwelling consisting of a delimited hollow space, perforated by cave openings.
Lelièvre’s installations are always based on a single drawing. A scan of this source is then reproduced seemingly endlessly in ever larger and smaller scales, causing the original motif to become distorted or dissolve. The resulting images are printed on PVC sheets which in turn constitute the modules for installations evoking both organic and architectural associations. The drawing thus functions as a dynamic texture that extends across the individual elements and spatial distances.
In a poetic commentary on Rétine, the artist writes: « The drawing of a microscopic image of the retina, based on short, fluctuating strokes, is digitally multiplied and enlarged until it evolves into an immersive environment. Playing with this reversibility, the matrix drawing of retinal rods and cones (recipients of light) generates a strange spatiality, which seems at the same time to borrow its principles of reproduction, growth and verticality from plant shoots. […] In this hybrid space we lose all our visual and conceptual bearings. »
The idea for Rétine arose from Anaïs Lelièvre’s invitation to participate in the exhibition Paysages rêvés, paysages réels (Dreamed Landscapes, Real Landscapes) by the Musée Gatien-Bonnet. The show was conceived in the context of the museum’s Neo-Impressionist collection, which has been housed in the Château de Rentilly since 2021.
The scholar Gustave Adolphe Thuret who lived here in the 19th century already then had taken microscopic photographs for his marine biological algae research. During her explorations of the castle grounds of Rentilly, Anaïs Lelièvre was overcome by a kind of Neo-Impressionist experience: while walking in the whirring reflected light under the trees, she felt a loss of visual and spatial orientation, not least owing to the mirror hull that since 2014 envelopes the old castle building and reacts to every movement of passers-by with confusing refractions of the mirrored park. Anaïs Lelièvre’s installation thus becomes an ingenious “retinal inversion” and a haptic-fluid antipode to the optical mirrored space surrounding the castle.
Like many other installations created by the artist, Rétine combines and intertwines inorganic-architectural and organic-sculptural elements. Immersed in an accelerated perspective that renders the space increasingly narrow and dense, the fleeting symmetries, as if reflections of phantoms, at a certain point appear to hypnotically fixate on us – hopefully causing a sensation that shakes us to the core, exposing us to a pleasurably productive shock, similar to surviving an atavistic earthquake of the earth’s crust.
Ursula Panhans-Bühler and Ludwig Seyfarth, exhibition, Phantoms and other illusions, Kai 10, Arthena foundation, Dusseldorf, Germany, 2023.
Anaïs Lelièvre (1982 in Lilas; lebt und arbeitet in Paris, Frankreich) geht der bewussten und unbewussten Wahrnehmung und Erfahrung realer, illusionärer oder virtueller Räume nach, ausgehend von Zeichnungen, die sie beim Durchqueren von Landschaften macht. In KAI 10 zeigt sie ihre raumfüllende Installation Rétine, erstmals aufgebaut 2021 im Château Rentilly nahe Paris, ergänzt durch eine Keramik aus ihrer Serie Oikos-Poros („Haus, porös“, 2020) – jede Behausung ein begrenzter Hohlraum, und perforiert von Höhlenöffnungen.
Ihren Installationen legt sie stets eine einzige Zeichnung zugrunde. Als Scan wird diese schier unendlich vervielfältigt in immer größeren und kleineren Skalierungen, wobei das originale Motiv sich auflöst oder verfremdet. Gedruckt werden sie auf PVC-Platten, die die Module bilden, aus denen die sowohl organische als auch architektonische Assoziationen weckenden Installationen aufgebaut sind. Die Zeichnung wird zu einer dynamischen, sich über die Einzelelemente und räumliche Distanzen hinweg ziehenden Textur.
In einem poetischen Kommentar zu Rétine schreibt die Künstlerin: „Die Zeichnung einer mikroskopischen Netzhautansicht, bestehend aus kleinen, fluktuierenden Tupfern, wird digital vervielfältigt und vergrößert, bis sie zu einer immersiven Umgebung wird. Im Spiel mit dieser Umkehrbarkeit erzeugt die Matrix-Zeichnung der Stäbchen und Zäpfchen der Netzhaut (Empfänger des Lichts) eine seltsame Räumlichkeit, deren Prinzipien von Reproduktion, Wachstum und Vertikalität, Pflanzentrieben entlehnt zu sein scheinen. […] In diesem hybriden Raum verlieren wir alle visuelle und konzeptuelle Orientierung.“
Die Idee zu Rétine entstand, als Anaïs Lelièvre vom Musée Gatien-Bonnet eingeladen wurde, an der Ausstellung „Paysages rêvés, paysages réels“ („Geträumte Landschaften, reale Landschaften“) teilzunehmen. Diese fand im Kontext der Neoimpressionisten-Sammlung des Museums statt, das seine Räume seit 2021 im Château de Rentilly hat.
Hier wohnte im 19.Jahrhundert ein Gelehrter, Gustave Adolphe Thuret, der früh schon mikroskopische Aufnahmen für seine meeresbiologischen Algenforschungen anfertigte. Eine Art neo-impressionistisches Erlebnis überfiel Anaïs Lelièvre im Schlosspark von Rentilly, als sie auf Spaziergängen im schwirrend reflektierten Licht unter Bäumen einen visuellen und räumlichen Orientierungsverlust verspürte, auch durch die Spiegelhaut, die seit 2014 das alte Schlossgebäude umhüllt und auf jede Bewegung von Spaziergängerinnen mit einer verwirrenden Brechung des gespiegelten Parks reagiert. Anaïs Lelièvres Installation wird so zur ingeniös ‚retinalen’ Umstülpung und einem haptisch fluiden Gegenpol zum optischen Spiegelraum des Schlosses.
Wie viele andere Installationen der Künstlerin verwebt und verstrickt Rétine* anorganisch-architektonische und organisch-plastische Momente. In beschleunigter Perspektive wird es enger und dichter, bis uns flüchtige Symmetrien hypnotisch fixieren als wären es gespiegelte Phantome, die uns hoffentlich durch Mark und Bein fahrend einem lustvoll produktiven Schock aussetzen, wie jedes überstandene atavistische Erbeben der Erdkruste.
Elora Weill-Engerer, catalogue de l’exposition, Anaïs Lelièvre, Chantier / Castel (idéel), Centre d’Art Le Garage, Amboise, 2023.
Deuxième publication : Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.
Le travail artistique est une autorisation pour l’artiste à s’absenter hors du temps, hors de soi : exil (ex solum : « hors du sol »). Mais ce même travail construit aussi un espace familier où se loger : « ça m’habite ». L’énergie investie dans la transformation de la matière crée un lien émotionnel où l’appartenance est mutuelle entre le contenant et le contenu. L’artiste vit dans l’œuvre autant que l’œuvre vit dans l’artiste. Cette attention au rapport entre l’imagination et la vie réelle d’un lieu habité parcourt la pratique d’Anaïs Lelièvre. Chantier / Castel (idéel) prend pour point de départ l’image à la fois archétypale et fragmentaire que l’esprit garde d’un lieu. À la différence de l’idéal, qui désigne une perfection que nous cherchons à appliquer effectivement au monde, l’idéel se rapporte à l’idée qui n’existe que dans l’idée. Chaque occupant d’Amboise y est allé de sa propre image idéale du château, résultat de ses actions sur l’espace et de sa production de significations, mais plus encore peut-être de ses projets idéels inaboutis. Il en va d’un lieu qui correspond davantage à son image qu’à sa matérialité concrète.
Dans La réalité figurative (Denoël/Gonthier, 1965, p. 272), Pierre Francastel écrit que la société dirigeante du Quattrocento vit dans un monde « à construire », où la réalité procède toujours de l’utopie. Elle confie donc aux artistes le soin d’anticiper sur les architectes. Loin d’entrer dans une analyse comparative de l’architecture réelle et de l’architecture figurée, l’auteur aborde la dimension foncièrement sociale des « projets » des artistes. Il conclue en effet le chapitre en question par : « Les objets imaginaires et les styles sont informés plus rapidement que les moeurs » (1965 : p. 281). La vision empirique de l’espace influe dès lors sur notre manière de l’habiter et il y a une nécessité à convoquer les prodromes de la construction (c’est-à-dire les signes avant-coureurs) pour comprendre ces rapports : le chantier dit quelque chose du lieu. Pinacles, fondements, piliers, flèches, murailles, ruines : Anaïs Lelièvre articule toutes les phases de l’histoire du bâti avec son iconographie mentale. Une tension se crée entre le chantier (la matière, les accidents) et l’idéalisation (le moule, la forme).
En confrontant le lieu à sa ruine et à ses fondations, l’artiste suit une logique anachronique. À la suite de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, Georges Didi-Huberman (Devant le temps, Minuit, 2000) voit dans l’anachronisme une richesse heuristique pour l’historien. L’image anachronique se déploie en trois volets : les survivances, le symptôme et la prophétie. En ce sens, le lieu n’est ni une étape ni un reflet de l’histoire mais est au contraire traversée par un temps non-linéaire, temps du bégaiement sisyphéen et du revers qui substitue la ténacité et la surprise des images à leur déterminisme. Précisément, cet anachronisme se loge dans l’interstice, le creux, l’espace ténu qui acquièrent chez Anaïs Lelièvre une importance d’ordre sémiologique. Ce sont ces formes mouvantes qui permettent d’habiter l’œuvre ou le lieu dans une temporalité énergique. En résulte une écriture de l’espace sur fond d’énigme et de blancs actifs. L’architecture décentralisée, capable de s’autodéterminer et de convoquer une intelligence collective par son déploiement en réseau appelle une forme d’exégèse : derrière les murs, les dieux lares doutent. De la multiplication et de la complexité des liens naît un hypertexte, c’est-à-dire un système de renvois et d’échos qui s’organisent de manière rhizomatique en une base documentaire processuelle. Ce qui meut ces pièces relève d’un principe archivistique. Or l’archive, pour Jacques Derrida (Mal d’Archive, Galilée, 1995, p.2) n’est jamais un retour à l’origine, une anamnèse ; elle avale, recrache, régule et rassemble les données. Dans son exhaustivité, elle met toujours en exergue la lacune.
Stéphanie Le Follic-Hadida (historienne, critique, commissaire d’exposition, vice-présidente de l’Académie internationale de la Céramique), exposition, Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, commissariat Carine Roma, Espace Jacques Villeglé, Saint-Gratien, 2023.
Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.
Sensible à l’espace et aux formes d’installation, Anaïs Lelièvre s’est donné pour principe de rechercher la contextualisation du travail, ce qui l’a conduite à des résidences internationales et au nomadisme qui l’accompagne. En 2010, déjà, elle écrivait « l’art d’habiter en voyageur » visant à questionner la manière dont le paysage traversé peut être lieu d’accueil pour l’art contemporain et vecteur de création. Après treize années d’exercice et plus d’une quinzaine de résidences, Anaïs Lelièvre est passée d’une exploration graphique de la spatialité à caractère immersif à un apprivoisement autodidacte et libre des matières et des règles céramiques, et à leur mise en espace. Deux résidences ont joué un rôle déterminant dans ce passage : Gardur, en Islande, durant les hivers 2015 puis 2019 ; et la Fondation La Junqueira, au Portugal, en 2022. Deux lieux dont les paysages – qu’ils fussent naturels ou urbanisés – témoignent, dans leur chair d’argile et de pierre, d’un tumulte tellurique profond, volcanique pour le premier, sismique pour le second. Le détonateur de cette approche s’apparente au syndrome de Stendhal. Face au grandiose des paysages islandais, Anaïs Lelièvre s’est sentie vaciller. Troublée par cette nature fortement contrastée (eau/roche, pierre de lave et neige, noir/blanc), elle entreprit d’interroger le paradoxe existant entre la frénésie constructive de l’homme qui ne cesse d’édifier, d’ériger, de faire acte de civilisation (par l’écriture notamment) et l’imprévisibilité de ces grands mouvements géologiques où tout n’est qu’effondrements, délitements et transmutations. Ce qui est catastrophe humaine pour certains est régénérescence salutaire pour d’autres. Anaïs Lelièvre ne prend pas parti. Au cœur de cette dichotomie, l’artiste rejoue les processus géologiques dans l’atelier en employant de l’argile, des émaux, de l’eau, de l’encre et le feu. À la façon des démiurges que sont un peu les céramistes, elle réintroduit la main dans la genèse des états et des formes.
La céramique était alors une discipline nouvelle pour elle. Elle l’aborde sans préambule éducatif, sans une once d’académisme, simplement portée par l’idée sensible, l’expérience du corps dans le paysage, la nécessité contextuelle, et le plaisir du voir et du toucher. Elle l’amène sur des chemins nouveaux et éminemment expérimentaux, à rebours des usages et comparables aux audaces transatlantiques qui ont porté le renouveau de la céramique dans les années 1960. À titre d’exemple, la porcelaine utilisée pour les quelque 250 Fondements exposés s’avère roulée dans un carcan de plaques métalliques et non coulée comme on aurait pu s’y attendre. Au détour d’un problème de four qui se refuse obstinément à cuire à haute température en stagnant à 1 100 degrés, elle obtient une porcelaine idéalement sous-cuite, étonnamment hydrophile, qui accepte de se laisser pénétrer en profondeur par d’abondants bains d’eau et d’encre de Chine, dont elle ne conserve après égouttage et séchage que les traces. Ailleurs, pour les Gloc, Oikos-Poros, comme pour les pièces murales intitulées Terramoto (tremblement de terre), le geste, répété, libéré, violent du stylet qui vient percuter l’argile en profondeur, là où le papier ne le permet pas, dénote une aptitude saisissante à comprendre les ressources et les réactions de la matière et à s’en saisir pour l’amener plus loin. Les séries Caryopse 3 (2021) et Oikos-Poros (2020) s’approprient la technique bien connue du transfert d’image, mais d’une façon très résolue qui en renouvèle le vocable.
Dans l’enceinte d’une exposition (comme la première dédiée uniquement à son travail de céramique, Littera/Terra, à l’espace Jacques-Villeglé de Saint-Gratien en 2023), l’espace devient l’enjeu de rencontres entre des volumes au sol et au mur. L’ensemble agencé présente des états figés des phénomènes extrêmes que sont les éruptions, les érosions, les glissements de terrain, les séismes ou les submersions, et une archéologie de la culture, via l’écriture dont Anaïs Lelièvre conserve l’absolue présence au cours de ce passage effectué du papier vers la céramique. Pétrie des propos de Leroi-Gourhan sur la gestualité de l’écriture et sur la capacité de cette dernière à ouvrir des espaces de pensée fertiles, Anaïs Lelièvre s’invente une « écriture de la catastrophe », non lisible et infiltrée dans ses pièces de façons multiples. Parlons de l’encre de Chine, d’abord, qui ruissèle abondamment sur nombre de ses pièces (Fondements, Terramoto, Archives…). Avec Lettres noires, ce sont des signes en grès chamotté noir qui s’alignent au mur ; avec la série Archives (Lettres A), elle procède par l’estampage de plaques de porcelaine blanche à l’aide de caractères typographiques d’imprimerie sauvés de la disparition. Les Fondements, eux-mêmes, exposés alignés, selon des rythmes variables, peuvent aussi faire allusion au morse. L’écrit, lui aussi au stade d’état et non de narration, est omniprésent. On pense à Roger Caillois et Henri Michaux.
Résidence après résidence, le chemin arpenté par Anaïs Lelièvre semble être celui d’une solitude durablement éprouvée dans le temps (temps géologiques et temps de la naissance de l’écriture) et dans l’espace, ouvert à la circulation des visiteurs. Là, où il est habituellement convenu de saluer les vertus d’une argile qui relie les hommes et les cultures, c’est à sa capacité immémoriale et chaotique, aux forces sourdes du changement qu’il est ici rendu hommage. Anaïs Lelièvre arpente le monde en quête d’un territoire à habiter. Poros-Oikos, Oikos-Poros, Terramoto 2 et 3, Caryopse, Fondements… prennent tous les contours d’une maison aux murs droits et au toit pointu. Symbolisée, de la même manière qu’une brique portée au-dessus de sa tête incarne à elle seule le foyer dans la procession qui a lieu chaque année à Manaus, au Brésil. De plain-pied dans ce territoire mouvant et en ébullition, simultanément mourant et naissant, le spectateur ne manquera pas de voir sa perception de l’espace bousculée et d’être déstabilisé dans ses certitudes existentielles.
Philippe Piguet, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, L’esprit des lieux, Musée du MASC, Sables d’Olonne, 2022.
Des relations de l’œuvre à l’espace de sa monstration, deux cas de figure sont à considérer. Le premier, qui est le plus ancien, porte sur le moment même de sa création et de son rapport au lieu où elle s’informe. Tel est le cas des peintures rupestres qui épousent le relief des parois sur lesquelles elles sont réalisées ou celui, plus contemporain, d’installations faites spécialement pour le contexte. Le second cas concerne des œuvres modulables, qui préexistent et qui sont en capacité de s’adapter à l’espace où elles sont présentées. Dans l’une comme dans l’autre de ces deux situations, ces œuvres sont pensées par leurs auteurs aux fins de mettre en exergue l’esprit des lieux qui les accueillent.
Non seulement l’art d’Anaïs Lelièvre est requis par cet esprit des lieux mais il procède tout à la fois de ces deux cas de figures. De fait, si l’artiste n’envisage son travail que dans une étroite relation à l’histoire des lieux où elle intervient, recherchant toute documentation qui lui permette de l’appréhender au mieux, elle le nourrit sans cesse du développement des expériences traversées. Sa démarche gagne ainsi la pertinence d’un continuum qui la charge de sens, tout en modulant celui-ci des situations qui lui sont offertes, et les formulations qu’elles trouvent reposent sur un socle conceptuel et formel solidement réfléchi.
Aux Sables d’Olonne, invitée à habiter les espaces de l’abbaye d’Orbestier, d’une part, de la Croisée du MASC, de l’autre, Anaïs Lelièvre a choisi d’intervenir suivant trois modalités distinctes. Ici, elle rejoue les éléments d’une pièce existante – Pinnaculum – et en développe une autre – Caryopse ; là, à partir de la déclinaison d’un module utilisé antérieurement, elle le démultiplie en un dispositif totalement inédit – Silicium 3. Quoiqu’elles soient séparées par l’éloignement des deux lieux d’exposition, ces trois installations se raccordent, sinon s’accordent par leur nature graphique – dessin imprimé pour la première, sculptures filaires pour les deux autres. Cela les rassemble virtuellement dans l’espace et leur confère la force d’une unité.
Créé à Toulouse au Musée des Augustins en 2018, présenté à Cahors à la Cathédrale Saint-Etienne en 2019, rejoué à Thonon-les-Bains à la chapelle de la Visitation en 2021, Pinnaculum est un ensemble de quelques 90 éléments modulables, en forme de volumes aux allures de pinacles, imprimés sur PVC d’un dessin de racines de faux cyprès coupés. Leur arrangement, en extérieur ou en intérieur, suggère comme un paysage d’archi-écritures, éclatées en îlots ou regroupées, qui appelle la déambulation ou la circulation. Aligné dans la nef de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, simplement posé à même sur la terre battue, Pinnaculum trouve là une nouvelle formulation qui souligne la pureté des lignes de la bâtisse. La nudité brute de son appareil de pierres, la sobriété architecturale de ses colonnes et de ses voûtes, l’immaculé de ses vitraux qui ne colore pas les rayons de soleil jouent d’harmonie complémentaire avec les entrelacs graphiques des modules, eux-mêmes disposés en un jeu d’échelles variées.
L’intérêt d’Anaïs Lelièvre pour l’architecture, de quelque nature qu’elle soit - religieuse, civile ou militaire -, relève chez elle d’une propension à prendre en compte les lieux qu’on lui propose pour en exprimer la relation existentielle du corps à l’espace dont ils sont les vecteurs. En ce sens, son art repose sur la nécessité primordiale d’emplir l’espace qu’elle occupe, parfois jusqu’à saturation, dans tous les cas pour inviter le regardeur à l’embrasser à son tour, à le découvrir dans toute son amplitude et dans toutes ses composantes. Cette appropriation des lieux s’accompagne chez elle d’une nécessaire connaissance de leur histoire pour concevoir la façon la plus pertinente d’y intervenir. Ainsi, savoir qu’une forêt se trouvait jadis en lieu et place de l’abbaye d’Orbestier a gouverné le choix tant de Pinnaculum et ses dessins de racines dans la nef que celui de Caryopse dans le chœur.
Constituée de structures filaires métalliques, cette dernière installation s’est tout d’abord donné à voir en un dispositif en façade de planches de bois marouflées de papier peint imprimé d’un dessin de la Vue microscopique de grain de blé. Par la suite, suivant un principe de « work in process » qui est la marque récurrente de sa démarche, l’artiste l’a appuyé en équilibre en un jeu de strates à partir des murs, puis lui a donné forme d’un mur construit/déconstruit en briques émaillées au motif du grain de blé. A l’abbaye d’Orbestier, Anaïs Lelièvre reprend la quatrième version de cette installation – dite Caryopse 4 -, déclinée antérieurement en un ensemble de modules découpés dans le métal à la forme d’épis ou de charpentes, dénués de tout dessin imprimé. Passant ainsi du trait au volume, elle l’instruit à l’ordre d’une structure architecturée nouvelle qui s’érige dans le vide du chœur, ne supportant rien – comme en écho à la voûte effondrée de l’abbaye en 1912. En occupant la place à saturation, elle file à nouveau la métaphore de la forêt, d’une forêt où le regard se perd, jusqu’au risque d’un vacillement. En même temps, entre Pinnaculum et Caryopse 4, quelque chose d’une unité autour du végétal et de la croissance fait écho à l’élancement gothique de la bâtisse. Il y va ainsi d’une dynamique interne propre tant à l’architecture séculaire qu’au travail de l’artiste. Heureuse osmose qui charge l’œuvre de la dualité d’une mesure tout à la fois sensible et cognitive, comme on le retrouve à La Croisée.
Intitulée Silicium 3, l’installation qu’elle y a orchestrée se distingue par un dispositif qui repose sur l’apparente fragilité graphique des 91 sculptures filaires qui y sont rassemblées. Si elles prennent figure à l’origine d’un dessin de géode rapportée du Brésil - lequel a conduit l’artiste au même développement vers la sculpture que Caryopse -, celles-ci font sens par rapport au concept de maison multiple et au nomadisme à l’aune desquels l’art d’Anaïs Lelièvre existe, via la procédure de résidence. Silicium 3 inaugure une forme d’invasion et de basculement qui convoque les mathématiques dans la déclinaison des modules fabriqués, joue de la transparence du fait que ceux-ci sont totalement traversants et s’amuse de l’instable par rapport à une longueur inégale de leurs arêtes. Tout en s’inscrivant dans la logique du travail, l’œuvre prend ainsi en charge la mémoire des lieux, celle des marais-salants et des cristaux de sel qui ont fait jadis l’identité de la ville.
Livrées à la pleine lumière de la Croisée, disposées au sol par groupes de différentes tailles, les modules qui sont peints en noir et en blanc configurent comme un paysage légèrement vacillant, qui balance entre émergence et effondrement. Ici et là, le jeu des ombres portées se mêle au dessin de leurs structures perturbant la perception du regardeur. D’autant plus que le contexte architectural du site offre au regardeur tout un lot de points de vue qui diffèrent selon l’angle sous lequel lui apparaît l’installation au travers des arches du déambulatoire. Il en résulte paradoxalement un tohu-bohu visuel assourdi par le silence du lieu et la déambulation glissée du visiteur au beau milieu de ce chaos savamment ordonné.
La démarche d’Anaïs Lelièvre est riche de toutes sortes de préoccupations, de forme et de fond, qui interrogent la relation du corps à l’espace. Quels que soient les lieux où elle intervient, l’artiste vise à réaliser des œuvres qui opèrent en relais de celle-ci dans l’intelligence d’une histoire, sans narration, et d’un ressenti, libre de toute expression. Dans un partage avec l’autre, pour ce que « c’est le regardeur qui fait l’œuvre », comme le disait Duchamp. Sa démarche relève d’une expérience phénoménologique - tel que l’art minimal en a usé – et de la quête d’un être-là, nourri du vécu d’une mémoire. Elle en appelle à la mise en jeu des rudiments d’un habiter qui lui permet non seulement de saisir la part subtile de l’esprit des lieux où elle s’arrête, mais de l’inscrire au compte d’une réflexion involutive sur la question de l’œuvre et la possibilité de ses métamorphoses.
Marc Pottier, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, T erra mot o, Fondation La Junqueira, Lisbonne, Portugal, 2022.
Deuxième publication : Marc Pottier, « T erra mot o d’Anaïs Lelièvre métaphorise le tremblement de terre de Lisbonne », Singulars, 11 mai 2022. Lien
Troisième publication : Anaïs Lelièvre, Littera/Terra, Arles, éditions Immédiats, 2024.
Connue pour ses installations de dessins immersives nichées dans la mémoire d’un lieu, l’artiste française Anaïs Lelièvre a profité de sa résidence à La Junqueira à Lisbonne pour renouveler son travail en créant des compositions en céramique tout en plongeant dans l’histoire de la capitale portugaise. Les nouvelles œuvres singulièrement expressionnistes de son exposition T erra mot o interprètent en métaphores subtiles l’impact à la fois environnemental et intellectuel du tremblement de terre qui a détruit la ville en 1755. Ce drame a remis en cause – rappelle Alain Corbin dans son « histoire de l’ignorance » – toutes les représentations de l’époque, obligeant les contemporains à repenser notre rapport au monde. Face à cette ignorance de la terre, l’artiste vise un thème qui reste sans doute plus actuel que jamais.
Activer d’autres possibles
Jusqu’à présent, l’artiste est très identifiée pour ses dessins, ou plutôt ses installations et sculptures dessinées, ses explosions d’impressions en noir et blanc, retraçant des fragments de matière minérale ou végétale, pour reconstituer des paysages dynamiques. Ses environnements sont connus pour investir et déborder les architectures des lieux où elle expose. Souvent derrière la composition finale se cache une invraisemblable architecture-support faite d’éléments de récupération en tous genres trouvés localement (planches, mobiliers, encombrants…), créant ainsi une autre œuvre, invisible, un océan de débris, qu’on ne découvre que dans les vidéos documentaires dévoilant la construction de ses projets. Déjà, un chaos prémonitoire de ce que l’artiste nous présente aujourd’hui à Lisbonne pour parler de tremblement de terre mais cette fois-ci avec d’autres matériaux, tels que porcelaine et encre.
« Ainsi ce que je trouve dans un lieu me permet de le transformer. Le même permet de produire du différent ou d’en activer d’autres possibilités. Chaque fois la manière d’agencer ce désordre trouve sens dans la dynamique du dessin et du lieu », confiait-elle. Aujourd’hui la résidence de la Junqueira offre d’autres défis à l’artiste, dont les tracés sismiques n’ont jamais cessé de réactiver dans l’espace un processus créatif qui parle d’émergences. Les deux salles qui lui ont servi à la fois d’atelier et de lieu d’exposition, aux murs ornés sur leur moitié basse d’azulejos – carreaux de céramiques aux dessins répétitifs typiques de la décoration portugaise du XVIIIème siècle –, furent un écrin empreint d’une préciosité complexe à ‘mater’. Cette touche locale est intégrée au principe de la mise en espace de l’exposition. « L’ensemble des pièces est à la fois multiplié et éclaté, morcelé et articulé, tels des fragments se complétant les uns et l’autres, mais avec des lacunes ou ellipses comme une ruine syntaxique ou un labyrinthe langagier ». Jouant sur plusieurs types d’échelles et niveaux de résonance, l’agencement amène presque à faire vaciller voire « tituber » le visiteur à force de changement de points de vue et glissements de points d’attraction. Composée par ponctuations, cette nouvelle présentation sera moins immersive que ses précédentes installations mais réussit toujours à décontenancer.
Terramoto, un tremblement jusqu’à celui des idées
Travaillant aussi par continuité, Anaïs Lelièvre poursuit l’exploration de l’argile amorcée à la suite d’une résidence en Islande, une matière propice pour aborder le mouvement des sols et les « changements d’état ». Titre à la fois littéral et métaphorique, aux résonances historiques et matiéristes, T erra mot o est bien choisi pour parler de ce qui l’a fascinée à Lisbonne, le fameux tremblement de terre de 1755 qui a mis non seulement à bas toute la ville mais fut aussi l’incroyable point de départ d’une révolution morale, philosophique, théologique et scientifique où se sont affrontés optimistes et pessimistes. Ce tournant tellurique s’est inscrit dans le cadre de l’Histoire comme un jalon entre le passé et le futur de l’Europe. Cette rupture dans un monde qu’on pensait stable fut « le signe avant-coureur d’une époque de malheur et d’incertitude qui mettait fin, selon Voltaire et Goethe, à la paix et à l’optimisme contagieux du début du siècle. »[1] Anaïs Lelièvre fut fascinée de redécouvrir la profusion des textes, échanges de lettres, interprétations et disputes de l’époque. C’est de cette perte des repères et du trouble dans la définition de ce qu’on pensait connaître dont parlent métaphoriquement les œuvres de cette exposition. C’est aussi pourquoi le titre de l’exposition s’écrit aussi avec un jeu d’espacements des lettres rappelant ainsi le séisme sous-jacent aux œuvres présentées. « O “terra moto”, comme le processus de mise en “mot” mis à mal, “erra” vient aussi évoquer “errer”, “erratum”, entre cheminement incertain ouvert à la découverte de l’inconnu et erreur, accident d’écriture, “coquille”, faute à corriger… », précise l’artiste.
Noir et blanc, entre écriture et perte des repères
Les céramiques, dessinées par grattage à la pointe sèche, comme des tablettes d’argiles creusées d’inscriptions, et chargées d’encre de chine, évoquent un processus d’écriture, que confirment en écho les mots gravés dans une eau-forte, produite dans le même temps. S’il porte toujours un fond scriptural, le rapport entre noir et blanc qu’Anaïs Lelièvre met en place dans cette exposition T erra mot o est différent de sa pratique habituelle. Il est ici sans opposition de contraste, sans conflit dans l’espace, mais au contraire à la fois dissocié et relativisé. Ses céramiques blanches grattées à la pointe intègrent les ombres dans leur texture complexe, sources de subtiles obscurités. Au contraire, les noirs qu’elle utilise en plongeant certaines pièces dans l’encre apportent du blanc par leur brillance. Cette prise en compte des jeux de lumière relativise ainsi ces deux couleurs. L’artiste lie ces glissements entre noir et blanc aux débats sur l’optimisme et le pessimisme et donc à ce désastre impensable du séisme lisboète qui a obligé de repenser notre rapport au monde à n’en plus savoir ce qui était blanc ou noir.
‘Ground zero’, la perception en déroute
Anaïs Lelièvre a créé un nombre impressionnant de nouvelles pièces en porcelaine, grès et faïence pour cette exposition ; entre-autre, une cinquantaine de colonnes de section pentagonale (en forme de maison), de hauteurs différentes, semblent se dissoudre ou s’arracher dans leur partie supérieure, et pourraient peut-être évoquer les décombres des twin-towers du World Trade Center de New-York en 2001 dont la position est désormais intitulée ‘ground zero’. Mais sans doute fait-elle plutôt référence ici à la résistance des piliers du Couvent des Carmes, l’église gothique de Lisbonne qui s’écroula lors du tremblement de terre de 1755, et ne fut jamais reconstruite. Ces ruines visibles de loin restent comme un des principaux témoins de la catastrophe. Ou pense-t-elle aussi à l’église baroque de São Domingos située dans le centre historique de Lisbonne, à côté de la place du Rossio qui fut deux fois victime de grandes catastrophes. La première lors du tremblement de terre de 1755, et la seconde en 1954, lorsqu’un énorme incendie détruisit l’église, sa décoration de bois sculpté doré et plusieurs peintures. Autre résilience d’une ville aux multiples cicatrices. Les colonnes ou piliers qu’Anaïs Lelièvre présente sont en porcelaines détrempées d’eau et d’encre. Leurs irrégularités, creux ou failles, dus aux accidents de matière lors du moulage ont ainsi fait réagir l’encre pour former des dessins presque géologiques. « Cet ensemble a aussi ses sources dans une carotte (découpe du sol pour l’étude de sa composition et de ses processus de formation), partiellement géométrique, partiellement dégradée, trouvée dans une grotte préhistorique à proximité de la résidence ; ainsi que dans la vue d’avion des agencements urbains de Lisbonne, bâtie dans un environnement montagneux et anciennement volcanique. La disposition de ces pièces pourra aussi être la recherche d’une écriture dans et de l’espace, et les piliers apparaître désormais comme des fragments de lettres, stratifiées et brisées, trouvant leurs fondements dans une expérience déchirante et constitutive de la matérialité. Ces restes de lettres peuvent être réactivés, agencés diversement comme des modules architecturaux syntaxiques, dans ce désir global de recherche de mots et de traduction d’un langage mis à mal par ce qui l’excède. »
Autre sorte de vestige, la première pièce produite, en faïence, d’un blanc cassé, a été in fine trempée dans l’encre noire pure rendant inidentifiable sa matière originelle. On pense à de la cendre, du charbon ou encore de la lave noire, des œuvres que continue d’habiter le souvenir du Terramoto.
Le rapport au temps, gestes d’inscription
Telles des feuilles écrites ou des parties de murs se soulevant, marqués d’histoire, ses bas-reliefs muraux en céramique présentent dans la partie supérieure une série de bâtons de tailles diverses et régulièrement alignés, sorte de mystérieux alphabet d’une langue qui aurait disparu, ou encore d’un codage – tel que le morse ou l’écriture braille – en partie effacé et indéchiffrable. Déclinant toujours une variation de traits mais en tous sens, la partie inférieure des reliefs semblent se dégrader, se désagréger ou redevenir une texture pétrifiée ou mouvante, aux multiples évocations. Anaïs Lelièvre transcrit ici son rapport au temps. Elle cite l’artiste polonais Roman Opalka (1931-2011) qui a, entre-autre, consacré une partie de sa vie à la peinture d’une série de chiffres qui visait l’infini, sa mise en nombres du temps et de la mort. En 1965, Roman Opalka trace, au pinceau et à la peinture blanche sur une toile noire, le chiffre 1. Il amorce alors un décompte qui ne s’arrêtera que le 6 août de l’année 2011, le jour même de sa mort. Ce dernier nombre, 5607249, sera son “infini” fini, le terme de la promenade, et la fin du parcours, donnant ainsi quelque chose de mesurable à la mort. Chez Anaïs Lelièvre ses signes sont-ils des alphabets ou des chiffres ? Commenceraient-ils ou finiraient-ils en 1755 ? Le trouble reste en suspens…
Les traits qui composent la texture de ces céramiques et qui deviennent évocation de texte, sont issus d’un processus d’abstraction à partir de la minutieuse transcription de la matière de pierres trouvées à la grotte de Rio Seco, un lieu mystérieux proche de la résidence d’artistes que peu de lisboètes connaissent, une faille apparente qui n’est en fait pas liée au tremblement de terre mais une carrière dont les extractions de calcaire ont servi à construire notamment le Palais National de Ajuda (dont la réalisation intégrale des plans du palais fut abandonnée au XIXème siècle, et donc avec une aile ouest toujours inachevée). C’est cette béance constructive, ‘bienveillante’, qui a attiré l’attention de l’artiste. L’une des premières céramiques, prolongée par la gravure à l’eau-forte, compose ainsi une forme de demeure trouée en son centre, révélant un fond obscur et matiériste (grès noir) sous les façades blanches (porcelaine). A partir de cette cavité centrale, la gravure, creusée sur une plaque de métal – donc de minéral –, s’est construite « dans l’affirmation d’un processus en cours, entre esquisse, recherche et insistance rythmique de la ligne, entre composition d’écriture (histoire) et délitement des formes. Le haut est la naissance d’une écriture, qui devient architecture, se renversant vers le bas en une zone plus chaotique, où des mots se densifient. Ces mots puisent dans les lectures sur le terramoto, dans une forme d’écriture automatique en résonnance, puisant dans l’imaginaire qu’il déclenche. Certaines notes sont tronquées, lacunaires, raturées, prises dans la matière graphique ; certaines lettres apparaissent inversées (par référence au processus en miroir de la gravure, et d’autres lettres ont été gravées en inversé pour paraître dans le bon sens). C’est la suggestion d’une secousse du langage, et d’une énigme, de sens autres à déchiffrer. La maison du langage. Sa structuration (moulée, normée) et les fragilités de sa matérialité même », précise Anaïs Lelièvre, en parlant en particulier de cette gravure, mais en écho à l’ensemble de ces nouvelles œuvres où chaque strate est la lettre obscure d’une histoire à déchiffrer.
Inspiration minérale, loin/près et grand/petit
Les sculptures-Maisons d’Anaïs Lelièvre émergent ou disparaissent d’une texture d’inspiration minérale : les roches de calcaire et de tuf basaltique, prélevées dans la grotte de Rio Seco, présentent des agglomérats stratifiés de bris de coquilles pour l’un ou de résidus volcaniques pour l’autre. Le séisme, destructeur, est aussi révélateur des strates géologiques à partir desquelles la ville s’est construite. Aussi, ces colonnes ou carottes de porcelaines encrées, peuvent être présentées debout, ou allongées comme l’évocation d’une chute, mais alors ces allégories de la demeure retrouvent un positionnement normal sur le sol. Cette ambigüité s’inscrit dans un contexte de soulèvement, de renversement, celui du séisme qui creuse l’horizontal du sol et met à terre les bâtisses élevées.
Le sol de la seconde salle d’exposition, qui est initialement la pièce d’une maison, est recouvert d’une impression générée à partir de la photographie d’un détail texturé de la première céramique, de petit format. Cette image est numériquement rétrécie et progressivement agrandie, multipliée et agencée en strates. Au-delà d’une image géologique, ce motif renvoie à un temps stratifié, qui vient creuser le sol de la pièce et dérouter la marche des visiteurs. Nous l’avons vu, Anaïs Lelièvre apprécie brouiller les cartes et ce sol est aussi comme une carte urbanistique ou une vue d’avion, qui lui permet de troubler les rapports loin/près et grand/petit.
« Un cri infini qui passait à travers l’univers ». Edvard Munch
Les maisons coulées dans l’encre de chine ont une de leurs façades éventrées. Les béances de ces sculptures, révélant une forme de grande brutalité, ont une fascinante dimension expressionniste. On pense à une bouche et au cri assourdissant de l’artiste norvégien Edvard Munch (1863-1944). Contrairement à l’idée reçue, le cri ne vient pas du personnage mais de la nature. Le personnage central apparaît effrayé et se couvre les oreilles pour estomper ce cri. Le coucher de soleil d’un rouge flamboyant était vraisemblablement provoqué par les cendres émises lors de l’éruption du volcan indonésien Krakatoa dont la violente éruption aurait provoqué des secousses sismiques parcourant le globe avec un bruit puissant et aurait rejeté dans l’atmosphère des millions de particules de cendres volcaniques s’éparpillant notamment jusqu’en Norvège.
Des Terramoto en perspective ? Autant d’irruptions potentielles dans le chapelet des drames qui secouent la planète. Autant de cendres qui viennent couvrir des certitudes et/ou des ignorances toujours remises en cause. Pourrions-nous faire le lien jusqu’à notre civilisation scientiste qui malgré des alertes multiples ne semble toujours pas agir pour anticiper l’urgence climatique ?
Notes
[1] Ana Cristina Araùjo, « La mémoire tragique du désastre de Lisbonne de 1755 », in Régis Bertrand, Anne Carol, Jean-Noël Pelen (dir.), Les narrations de la mort, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2005. https://books.openedition.org/pup/7246
Marc Pottier, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, T erra mot o, Fondation La Junqueira, Lisbonne, Portugal, 2022.
Known for her immersive drawing installations nestled in the memory of a place, the French artist Anaïs Lelièvre benefited from her residency at La Junqueira in Lisbon to renew her work by creating ceramic compositions while immersing herself in the history of the Portuguese capital. The singularly expressionistic new works in her exhibition T erra mot o interpret in subtle metaphors the environmental and intellectual impact of the earthquake that destroyed the city in 1755. This tragedy has called into question - recalls Alain Corbin in his “History of Ignorance” - all the representations in that period, forcing contemporaries to rethink our relationship with the world. In view of this ignorance of the earth, the artist aims at a theme that is undoubtedly more topical than ever.
Activating other possibilities
Until now, the artist is best known for her drawings, or rather her installations and drawn sculptures, her explosions of black and white prints, tracing fragments of mineral or vegetable matter to reconstitute dynamic landscapes. Her environments are known for taking over and overflowing into the architecture of the venues where she exhibits. Often behind the final composition is an improbable support-architecture made of all kinds of salvaged elements found locally (boards, furniture, bulky waste…), thus creating another invisible work, an ocean of debris, which is only discovered in the documentary films revealing the construction of her projects. Already, a premonitory chaos of what the artist presents us today in Lisbon to speak about the earthquake but this time with other materials, such as porcelain and ink.
«So, what I find in a place allows me to transform it. The latter allows to produce different or to activate other possibilities. Each time the way of arranging this disorder finds meaning in the dynamics of the design and the place», she confided. Today the Junqueira Residency offers other challenges to the artist, whose seismic traces have never ceased to reactivate in this space a creative process that speaks of emergences. The two rooms that served as both her studio and exhibition space, with walls decorated on their lower half with azulejos - ceramic tiles with repetitive patterns typical of 18th century Portuguese decoration - were a setting with a complex preciousness to ‘subdue’. This local touch is integrated into the principle of the exhibition’s spatial layout. «The whole of the pieces is both multiplied and fragmented, broken up and articulated, like fragments completing each other, but with gaps or ellipses like a syntactic ruin or a linguistic labyrinth». Playing on several types of scales and levels of resonance, the arrangement almost causes the visitor to wobble or even «stagger» by dint of changing viewpoints and shifting points of attraction. Composed of punctuations, this new presentation will be less immersive than her previous installations but still manages to unnerve.
Terramoto, shaking ideas
In this continuity, Anaïs Lelièvre continues the exploration of clay following a residency in Iceland, a material that is conducive to addressing the movement of soils and «shifting phases». A title that is both literal and metaphorical, with historical and materialist resonances, T erra mot o is well chosen to speak of what fascinated her in Lisbon, the famous earthquake of 1755 that not only brought down the entire city but was also the incredible starting point of a moral, philosophical, theological, and scientific revolution where optimists and pessimists clashed. This telluric turning point was set in history as a milestone between the past and the future of Europe. This break in what was thought to be a stable world was «the warning sign of an age of unhappiness and uncertainty which, according to Voltaire and Goethe, put an end to the contagious peace and optimism of the beginning of the century.»[1] Anaïs Lelièvre was fascinated to rediscover the profusion of texts, exchanges of letters, interpretations, and disputes in that period. It is this loss of reference points and the blurring of the definition of what we thought we knew that the works in this exhibition speak metaphorically of. This is also why the title of the exhibition is written with a play of spaced letters, recalling the earthquake underlying the works presented. «O “terra moto”, as in the process of putting into “word”, “erra” also evokes “wandering”, “erratum”, between an uncertain path open to the discovery of the unknown and error, a writing accident, a “typo”, a mistake to be corrected…», says the artist.
Black and white, between writing and loss of reference points
The ceramics, drawn by drypoint scratching, like clay tablets with inscriptions, and loaded with Indian ink, evoke a writing process, which is echoed by the words engraved in an etching produced at the same time. Although it always has a scriptural background, the relationship between black and white that Anaïs Lelièvre sets up in this exhibition T erra mot o is different from her usual practice. It is here without opposition of contrast, without conflict in space, but on the contrary both dissociated and relativised. Her white, point-scraped ceramics integrate shadows into their complex texture, creating subtle obscurities. On the contrary, the blacks she uses by dipping certain pieces in the ink add brilliance to the white. This interplay of light relativises these two colours. The artist links these shifts between black and white to the debates on optimism and pessimism and thus to the unthinkable disaster of the Lisbon earthquake, which forced us to rethink our relationship with the world to the point where we no longer know what is black or white.
‘Ground zero’, perception in disarray
Anaïs Lelièvre has created an impressive number of new pieces in porcelain, stoneware, and earthenware for this exhibition; among others, some fifty pentagonal (house-shaped) columns of different heights seem to dissolve or break off at the top and could perhaps evoke the rubble of the twin-towers of the World Trade Center in New York in 2001, whose position is now called ‘ground zero’. But she is probably referring here to the strength of the pillars of the Carmo Convent, the gothic church in Lisbon that collapsed in the earthquake of 1755 and was never rebuilt. These ruins, visible from afar, remain as one of the main reminders of the disaster. Or is she also thinking of the Baroque church of São Domingos in the historic centre of Lisbon, next to Rossio Square, which twice fell victim to major disasters. The first was during the earthquake of 1755, and the second in 1954, when a huge fire destroyed the church, its gilded carved wood decoration, and several paintings. Another resilience of a city with many scars. The columns or pillars that Anaïs Lelièvre presents are made of porcelain soaked in water and ink. Their irregularities, hollows or faults, due to material accidents during moulding, have thus made the ink react to form almost geological drawings. «This ensemble also has its sources in a strata sample (a cut-out of the ground for the study of its composition and formation processes), a partially geometric, partially degraded, found in a prehistoric cave near the residency; and in the aerial view of the urban layouts of Lisbon, built in a mountainous and formerly volcanic environment. The arrangement of these pieces could also be the search for a writing in and of the space, and the pillars appear from now on as fragments of letters, stratified and broken, finding their foundations in a tearing and constitutive experience of materiality. These remnants of letters can be reactivated, arranged in various ways like syntactic architectural modules, in this global desire to search for words and to translate a language that has been damaged by what exceeds it.»
Another kind of relic, the first piece produced, made of off-white earthenware, was finally dipped in pure black ink, making its original material unidentifiable. One thinks of ash, coal or black lava, works that are still inhabited by the memory of the Terramoto.
The relationship to time, gestures of inscription
Like written leaves or parts of walls that are raised, marked with history, its ceramic wall bas-reliefs present in the upper part a series of sticks of various sizes and regularly aligned, a sort of mysterious alphabet of a language that would have disappeared, or of a coding - such as morse code or braille - partly erased and indecipherable. The lower part of the reliefs, always with a variation of lines but in all directions, seems to degrade, disintegrate, or become a petrified or moving texture, with multiple evocations. Anaïs Lelièvre transcribes here her relationship to time. She cites the Polish artist Roman Opalka (1931-2011) who, among other things, dedicated part of his life to painting the progression of numbers to infinity and decided to paint time and death in numbers. In 1965, Roman Opalka started painting the number 1 on a black canvas, using white paint. He then began a countdown that would not end until 6 August 2011, the day he died. This last number, 5607249, will be his finite “infinity”, the end of a stroll, and the passing of time, thus giving something measurable to death. Are Anaïs Lelièvre’s signs alphabets or numbers? Would they start or end in 1755? The disorder remains unresolved…
The lines that make up the texture of these ceramics, which become an evocation of text, are the result of a process of abstraction based on the meticulous transcription of the material of stones found in the Rio Seco cave, a mysterious place near the artists’ residency that few Lisboners know, an apparent fault line that is in fact not related to the earthquake but a quarry whose limestone extractions were used to build, among other things, the National Palace of Ajuda (whose full realisation of the palace plans was abandoned in the 19th century, and therefore with a west wing still unfinished). It was this constructive, ‘benevolent’ gap that attracted the artist’s attention. One of the first ceramics, extended by etching, thus composes a form of dwelling with a hole in its centre, revealing an obscure and materialistic background (black stoneware) under the white façades (porcelain). From this central cavity, the engraving, carved on a metal plate - therefore mineral - was constructed «in the affirmation of an ongoing process, between sketch, research, and rhythmic insistence of the line, between composition of writing (history) and disintegration of the forms. The top is the birth of writing, which becomes architecture, turning downwards into a more chaotic area, where words become denser. These words are extracted from the literature on the terramoto, in a form of automatic writing with resonance, drawing on the imaginary that it triggers. Some notes are truncated, incomplete, crossed out, caught in the graphic material; some letters appear inverted (in reference to the mirror process of engraving, and other letters have been engraved in reverse to appear in the right direction). It is the suggestion of shaking the language, of an enigma, and of other meanings to be deciphered. The house of language. Its structuring (moulded, normalised) and the fragility of its very materiality», explains Anaïs Lelièvre, speaking in particular of this engraving, but echoing the whole of these new works where each stratum is the obscure letter of a story to be deciphered.
Mineral inspiration, far/near and large/small
Anaïs Lelièvre’s sculptures-Maisons-emerge or disappear from a mineral-inspired texture: the limestone rock and basalt tuff, collected from the Rio Seco cave, present stratified agglomerates of broken shells for the former or volcanic residues for the latter. The destructive earthquake also reveals the geological strata from which the city was built. Also, these columns or inked porcelain strata samples can be presented standing, or lying down as an evocation of a fall, but then these allegories of the house find a normal position on the floor. This ambiguity is part of a context of uplift, of reversal, that of the earthquake which digs into the horizontal of the ground and brings down the high buildings.
The floor of the second exhibition room, which is initially the room of a house, is covered with a print generated from a photograph of a textured detail of the first, small-scale ceramic. This image is digitally shrunk and gradually enlarged, multiplied, and arranged in layers. Beyond a geological image, this motif refers to a stratified time, which digs into the floor of the room and disturbs the visitors’ walk. As we have seen, Anaïs Lelièvre likes to blur the maps and this floor is also like an urban map or a plane view, which allows her to disturb the relationships between far/near and large/small.
« An infinite scream passing through the universe ». Edvard Munch
The houses covered in India ink have one of their façades torn away. The gaps in these sculptures, revealing a form of great brutality, have a fascinating expressionist dimension. One thinks of a mouth and the deafening scream of the Norwegian artist Edvard Munch (1863-1944). Contrary to popular belief, the cry does not come from the character but from nature. The main character seems frightened and covers his ears to blur the scream. The fiery red sunset was probably caused by the volcanic ash emitted during the violent eruption of the Indonesian volcano Krakatoa which is said to have caused seismic tremors that travelled the globe with a loud noise and released millions of its particles into the atmosphere, scattering as far as Norway.
Terramoto in perspective? So many potential irruptions in the string of dramas shaking the planet. So many ashes covering certainties and/or ignorance that are always being questioned. Could we make the link to our scientistic civilisation which, despite multiple warnings, still does not seem to act to anticipate the climate emergency?
Notes
[1] Ana Cristina Araùjo, “La mémoire tragique du désastre de Lisbonne de 1755”, in Régis Bertrand, Anne Carol, Jean-Noël Pelen (dir.), Les narrations de la mort, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2005. https://books.openedition.org/pup/7246
Marc Pottier, « T erra mot o de Anaïs Lelièvre metaforiza o terremoto de Lisboa », DasArtes, Brésil, 19 de maio de 2022. Lien
Conhecida pelas suas instalações de desenho imersivas aninhadas na memória de um lugar, a artista francesa Anaïs Lelièvre aproveitou a sua residência na La Junqueira, em Lisboa, para renovar o seu trabalho criando composições cerâmicas enquanto mergulha na história da capital portuguesa. As obras singularmente expressionistas de sua exposição T erra mot o, em exibição até 22 de maio, interpretam em metáforas sutis o impacto, tanto ambiental quanto intelectual, do terremoto que destruiu a cidade em 1755. Esse drama questionou – lembra Alain Corbin em sua « História da ignorância » – todas as representações da época, obrigando os contemporâneos a repensar nossa relação com o mundo. Perante este desconhecimento da terra, a artista aponta para um tema que se mantém, sem dúvida, mais atual do que nunca.
Ative outras possibilidades
Até agora, Anaïs Lelièvre tem sido amplamente identificada por seus desenhos, ou melhor, por suas instalações e esculturas desenhadas, suas explosões de gravuras em preto e branco, refazendo fragmentos de matéria mineral ou vegetal, para reconstruir paisagens dinâmicas. Seus ambientes são conhecidos por investir e transbordar as arquiteturas dos locais onde expõe. Muitas vezes por trás da composição final esconde-se uma arquitetura-suporte improvável feita de elementos reciclados de todos os tipos encontrados localmente (placas, móveis…), criando assim outra obra, invisível, um oceano de detritos, que só descobrimos nos vídeos documentais que revelam a construção de seus projetos.
Suas obras já são um caos premonitório do que a artista nos apresenta até 22 de maio em Lisboa para falar de terremotos, mas desta vez com outros materiais, como porcelana e tinta.
Vários tipos de escalas e níveis de ressonância
« O que eu encontro em um lugar me permite transformá-lo. Possibilita produzir algo diferente ou ativar outras questões. Cada vez mais a forma de ordenar esta desordem encontra sentido na dinâmica do desenho e do lugar », confidenciou Anaïs Lelièvre. Hoje a residência Junqueira oferece outros desafios à artista, cujas linhas sísmicas nunca deixaram de reativar no espaço um processo criativo que fala de emergências. As duas salas que lhe serviam de atelier e de espaço expositivo, com paredes adornadas na metade inferior com azulejos – azulejos de cerâmica com desenhos repetitivos típicos da decoração portuguesa do século XVIII –, eram um cenário imbuído de uma complexa preciosidade para ‘mater‘.
Este toque local está integrado no princípio do layout da exposição. « O conjunto de peças é ao mesmo tempo multiplicado e explodido, articulado, como fragmentos que se complementam, mas com lacunas ou elipses como uma ruína sintática ou um labirinto linguístico». Jogando em vários tipos de escalas e níveis de ressonância, o layout quase faz o visitante cambalear ou até “escalonar” com a mudança de pontos de vista e pontos de atração deslizantes. Composta por pontuações, esta nova apresentação será menos imersiva que suas instalações anteriores, mas ainda consegue desconcertar.
Terramoto, um termor à altura das ideias
Anaïs Lelièvre dá continuidade à exploração de argila iniciada após uma residência na Islândia, material propício para abordar o movimento dos solos e as « mudanças de estado ». Um título ao mesmo tempo literal e metafórico, com ressonâncias históricas e materiais, T erra mot o é bem escolhido para falar sobre o que a fascinou em Lisboa, o famoso terremoto de 1755 que não só derrubou toda a cidade como foi o incrível marco inicial de uma revolução moral, filosófica, teológica e científica onde otimistas e pessimistas se chocaram. Esta virada telúrica faz parte da história como um marco entre o passado e o futuro da Europa. Esta ruptura num mundo que se julgava estável foi « o prenúncio de um tempo de infortúnio e incerteza que pôs fim, segundo Voltaire e Goethe, à paz e ao otimismo contagiante do início do século »[1]. Anaïs Lelièvre ficou fascinada por descobrir a profusão de textos, trocas de cartas, interpretações e disputas da época. É sobre essa perda de rumo e a confusão em redefinir o que pensávamos saber que as obras desta exposição falam metaforicamente. É também por isso que o título da exposição também é escrito com espaçamento entre letras, lembrando assim o sismo subjacente às obras apresentadas. « O “t erra mot o”, como o processo de colocar em “palavra” minado, “erra” passa também a evocar “err”, “erratum”, entre o progresso incerto aberto à descoberta do desconhecido e o erro, acidente de escrita, “shell”, falha a corrigir… », especifica o artista.
Preto e branco, entre a escrita e a perda de rumo
As cerâmicas, desenhadas por raspagem com ponta seca, como tabuletas de barro escavadas com inscrições, e cobertas com tinta da china, evocam um processo de escrita, que é ecoado pelas palavras gravadas em água-forte, produzidas ao mesmo tempo. Se ainda tem um fundo escriturístico, a relação entre o preto e o branco que Anaïs Lelièvre estabelece nesta exposição é diferente da sua prática habitual. Está aqui sem oposição de contraste, sem conflito no espaço, mas ao contrário dissociado e relativizado.
Suas cerâmicas brancas raspadas na ponta integram sombras em sua textura complexa, fontes de sutil escuridão. Em contrapartida, os pretos que ela usa ao mergulhar certas peças em tinta trazem o branco pelo seu brilho. Essa consideração do jogo de luz coloca, assim, essas duas cores em perspectiva. A artista liga estes deslocamentos entre preto e branco aos debates sobre otimismo e pessimismo e, portanto, a este impensável desastre do terremoto de Lisboa que nos obrigou a repensar a nossa relação com o mundo e já não saber o que era preto ou branco.
‘Marco zero’, Percepcao em desordem percepção
Anaïs Lelièvre criou para esta exposição um número impressionante de novas peças em porcelana, grés e faiança; entre outras coisas, cerca de cinquenta colunas de secção pentagonal (em forma de casa), de diferentes alturas, parecem dissolver-se ou rasgar-se na sua parte superior, podendo talvez evocar os escombros das torres gêmeas do World Trade Center de Nova York em 2001, cuja posição agora é chamada de ‘marco zero’.
Mas sem dúvida se refere aqui mais à resistência dos pilares do Convento dos Carmelitas, a igreja gótica de Lisboa que desabou no terremoto de 1755, e nunca foi reconstruída. Estas ruínas visíveis de longe permanecem como uma das principais testemunhas do desastre. Ou lembram também na Igreja barroca de São Domingos situada no centro histórico de Lisboa, junto à Praça do Rossio, que foi duas vezes vítima de grandes catástrofes. A primeira durante o terremoto de 1755, e a segunda em 1954, quando um grande incêndio destruiu sua decoração de talha dourada e várias pinturas. Mais uma resiliência de uma cidade com múltiplas cicatrizes.
As colunas ou pilares que Anaïs Lelièvre apresenta são de porcelana embebida em água e tinta. Suas irregularidades, cavidades ou falhas, devido a acidentes de materiais durante a moldagem, faziam com que a tinta reagisse para formar desenhos quase geológicos. « Esse conjunto também tem suas fontes em uma cenoura (corte do solo para estudo de sua composição e seus processos de formação), parcialmente geométrica, parcialmente degradada, encontrada em uma caverna pré-histórica próxima à residência; bem como na vista aérea dos traçados urbanos de Lisboa, construídos num ambiente montanhoso e outrora vulcânico. A disposição dessas peças poderia ser também a busca de uma escrita no e do espaço, e os pilares agora aparecem como fragmentos de letras, em camadas e quebradas, encontrando seus fundamentos em uma experiência dolorosa e constitutiva da materialidade. Esses restos de letras podem ser reativados, dispostos diversamente como módulos arquitetônicos sintáticos, nesse desejo global de buscar palavras e traduzir uma linguagem solapada pelo que a excede ».
Outro tipo de vestígio, a primeira peça produzida em faiança off-white, acabou por ser mergulhada em tinta preta pura, tornando inidentificável o seu material original. Pensamos em cinzas, carvão ou até lava negra, obras que continuam a habitar a memória de Terramoto.
A relação com o tempo, gestos de inscrição
Como folhas escritas ou partes de paredes ascendentes, marcadas pela história, os seus baixos-relevos de parede de cerâmica apresentam na parte superior uma série de varetas de vários tamanhos e regularmente alinhadas, uma espécie de alfabeto misterioso de uma língua que teria desaparecido, ou mesmo de uma codificação – como código Morse ou escrita em Braille – parcialmente apagada e indecifrável. Ainda apresentando uma variação de linhas mas em todas as direções, a parte inferior dos relevos parece deteriorar-se, desintegrar-se ou tornar-se uma textura petrificada ou em movimento, com múltiplas evocações.
Anaïs Lelièvre transcreve aqui sua relação com o tempo. Ela cita o artista polonês Roman Opalka (1931-2011) que, entre outras coisas, dedicou parte de sua vida a pintar uma série de números que visavam o infinito, sua numeração do tempo e dos mortos. Em 1965, Roman Opalka traçou o número 1 com pincel e tinta branca em uma tela preta e iniciou uma contagem regressiva que não pararia até 6 de agosto de 2011, dia de sua morte. Este último número, 5607249, será seu “infinito” finito, o fim da caminhada e o fim da jornada, dando assim algo mensurável à morte. Para Anaïs Lelièvre, seus signos são alfabetos ou números? Começariam ou terminariam em 1755? O problema continua sem solução…
Uma evocação de texto
As linhas que compõem a textura dessas cerâmicas e que se tornam evocações de texto, provêm de um processo de abstração a partir da transcrição minuciosa do material de pedras encontrado na gruta de Rio Seco, local misterioso próximo à residência de artistas que poucos lisboetas conhecem, uma aparente falha que na verdade não está ligada ao sismo mas sim a uma pedreira cujas extrações de calcário serviram para construir o Palácio Nacional da Ajuda em particular (os planos de realização completa do palácio foram abandonados no século XIX, deixando uma ala poente ainda inacabada).
É essa lacuna construtiva e « benevolente » que chamou a atenção da artista. Uma das primeiras cerâmicas, estendida por água-forte, compõe assim uma forma de habitação com um furo no centro, revelando um fundo escuro e material (arenito preto) sob as fachadas brancas (porcelana). A partir desta cavidade central, a gravura, escavada sobre uma placa de metal – portanto de mineral -, foi construída « na afirmação de um processo em curso, entre esboço, pesquisa e insistência rítmica na linha, entre composição de escrita (história) e desintegração das formas. O topo é o nascimento de uma escrita, que se torna arquitetura, deságua em uma zona mais caótica, onde as palavras se tornam mais densas.
Essas palavras se valem das leituras no terremoto, numa forma de escrita automática em ressonância, valendo-se da imaginação que ela desencadeia. Certas notas são truncadas, lacunares, riscadas, presas no material gráfico; algumas letras aparecem invertidas (referindo-se ao processo de gravação em espelho e outras letras foram gravadas invertidas para aparecer da maneira correta). É a sugestão de um choque de linguagem, e de um enigma, de outros significados a serem decifrados. A casa da linguagem. A sua estruturação (moldada, padronizada) e a fragilidade da sua própria materialidade », especifica Anaïs Lelièvre, falando em particular desta gravura, mas em eco a todas estas novas obras onde cada estrato é a letra obscura de uma história a decifrar.
Inspiração mineral, longe/perto e grande/pequeno
As casas-esculturas de Anaïs Lelièvre emergem ou desaparecem de uma textura de inspiração mineral: as rochas calcárias e tufosas basálticas, retiradas da gruta do Rio Seco, apresentam aglomerados estratificados de conchas quebradas para uma ou de resíduos vulcânicos para a outra. O terremoto destrutivo também revela os estratos geológicos a partir dos quais a cidade foi construída. Além disso, essas colunas de porcelana pintada ou cenouras podem ser apresentadas de pé, ou deitadas como a evocação de uma queda, mas essas alegorias (da habitação) encontram uma posição normal no chão. Esta ambiguidade insere-se num contexto de sublevação, de tombamento, o do terramoto que escava a horizontal do terreno e derruba os edifícios altos.
O piso da segunda sala expositiva, que originalmente era a sala de uma casa, é revestido por uma impressão gerada a partir da fotografia de um detalhe texturizado da primeira cerâmica, de pequeno formato. Esta imagem é encolhida digitalmente e ampliada, multiplicada e mergulhada progressivamente. Para além de uma imagem geológica, este motivo remete para um tempo estratificado, que cava no chão da sala e confunde o caminhar dos visitantes. Como vimos, Anaïs Lelièvre gosta de desfocar as cartas e este terreno é também como um mapa urbanístico ou a vista de um avião, que lhe permite perturbar as relações longe/perto e grande/pequeno.
« Um grito infinito que percorreu o universo ». Edvard Munch
As casas em tinta da china têm uma de suas fachadas evisceradas. As lacunas nestas esculturas, revelando uma forma de grande brutalidade, têm uma fascinante dimensão expressionista. Pensa-se numa boca e no grito ensurdecedor do artista norueguês Edvard Munch (1863-1944). Ao contrário da crença popular, o choro não vem do personagem, mas da natureza. O personagem central parece assustado e tapa os ouvidos para abafar esse grito. O pôr-do-sol vermelho ardente foi provavelmente causado pelas cinzas emitidas durante a erupção do vulcão indonésio Krakatoa, cuja violenta erupção teria causado tremores sísmicos que atravessam o globo com um ruído poderoso e teriam lançado na atmosfera milhões de partículas de cinzas vulcânicas espalhadas até a Noruega.
Terramoto em perspectiva?
Tantas irrupções potenciais na série de tragédias que estão sacudindo o planeta. Tantas cinzas que vêm encobrir certezas e/ou ignorâncias que são sempre postas em causa. Poderíamos fazer a ligação com nossa civilização cientificista que, apesar dos múltiplos alertas, ainda parece não estar agindo para antecipar a emergência climática?
Notas
[1] Ana Cristina Araùjo, « La mémoire tragique du désastre de Lisbonne de 1755 », in Régis Bertrand, Anne Carol, Jean-Noël Pelen (dir.), Les narrations de la mort, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2005.
Laurence Schmidlin, « Récits de basalte. Entretien avec Anaïs Lelièvre et Pascal Neveux », catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, une traversée graphique, Une proposition du Frac Picardie, Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines, Arles, Analogues, Semaine 10.22 (n° 453), 2022.
La nouvelle installation d’Anaïs Lelièvre, conçue sur l’invitation de Pascal Neveux, directeur du Frac Picardie à Amiens, fait corps avec l’ancienne casemate du Musée du dessin et de l’estampe originale à Gravelines, plus qu’elle n’y prend place. Elle s’intitule Oikos-Poros, d’après une terminologie empruntée à Benoît Goetz et sa Théorie des maisons. L’habitation, la surprise (2011) signifiant littéralement « habitation-passage », et a pour point de départ un dessin (décembre 2021) inspiré d’une pierre de lave prélevée à Gardur en Islande, où l’artiste a séjourné durant les hivers 2015-2016 et 2019-2020. Sa forme géométrique n’a rien d’un caillou, elle évoque une maison. Elle est en outre délibérément inachevée. À l’instar de précédents projets initiés par l’image-source d’une matière extraite d’un lieu de résidence (fruit, grain de blé, pierre de schiste, etc.), selon une démarche mise au point lors d’un séjour au Brésil en 2017, ce dessin fait office de matrice et de ressource créative : plusieurs étapes numériques de distanciation (multiplication, modification, agrandissement) permettent, d’une part, de découvrir ses potentialités matérielles et les dynamiques intérieures de sa texture, à la manière d’une pierre qui témoigne dans sa composition même des évolutions géologiques à travers le temps, et, d’autre part, de l’adapter au lieu d’intervention. « C’est par le petit que j’atteins le grand », dit Anaïs Lelièvre, en ajoutant que « saisir une pierre, c’est saisir quelque chose du paysage ». L’amplification de l’infiniment petit qui lui aussi contient le lieu, de la trame graphique qui déplace ce lieu et le rapporte à un réel concret et construit, transmet l’énergie vibratoire des traits tracés à l’encre noire selon une rythmique évoquant l’ébullition du magma. La structure poreuse de la pierre – qui résulte du refroidissement rapide de la lave – élargie à l’espace produit des sensations qui contribuent à notre désorientation. À Gravelines, les impressions sur PVC qui recouvrent le sol, le rendent mouvant. Au moyen de ce fragment de basalte, l’artiste renoue avec l’Islande, dont la ville de Faskrudsfjordur est jumelée à Gravelines, et avec ses paysages de noir et de blanc, de basalte et de neige, dans lesquels les sens sont constamment en éveil, un environnement graphique qui nous dépossède de nos certitudes. « Un dessin réalisé à la main ne suffit pas pour parler au corps », explique encore Anaïs Lelièvre, d’où le passage par l’installation qui permet de solliciter physiquement le public, de lui rendre son acuité en le poussant à être alerte. Par ailleurs, en convoquant l’Islande à dessein, l’artiste rejoue ce phénomène de stratification en mêlant plusieurs références contextuelles. Ville portuaire et fortifiée, Gravelines était, jusqu’à l’entre-deux-guerres, le point de départ de pêcheurs dits « à Islande » qui fluctuaient entre deux terres. Le sol de l’installation est un flux qui nous charrie et nous confronte à des modules de différentes tailles que l’on découvre progressivement. Ces panneaux en métal composite, imprimés avec la même structure basaltique à cavités, puis découpés et pliés, sont placés à travers l’espace, seuls ou en groupe, selon différentes configurations. Reprenant la forme en toiture du dessin originel, ils synthétisent le vocabulaire angulaire et modulaire du système de fortifications de Gravelines (solide et protecteur) et celui des maisons de tôle préfabriquées que l’on trouve sur la côte islandaise (précaires). L’éclairage à la lampe-torche, l’avancée lente vers l’inconnu, la découverte fragment après fragment de l’espace et l’impossibilité de l’appréhender d’un seul tenant défient notre perception et nous conduisent à travers les temps, les espaces, les échelles et les récits.
Laurence Schmidlin : La notion de « l’habiter » est importante dans votre travail. Comment prend-elle sens dans cette nouvelle installation ?
Anaïs Lelièvre : La question de l’« habiter » a émergé à mesure que je devenais de plus en plus mobile, voire nomade, du fait d’une pratique contextuelle. Le déplacement incessant d’un lieu à d’autres a remis en question la notion de « chez-soi » comme point de repère stabilisé, et aiguisé la nécessité de construire une autre « maison » sous un autre mode. Aussi, la ville de Gravelines m’est apparue comme l’image d’une dualité, entre ses fortifications préservées et son ouverture vers l’Islande. Cette dualité de la clôture et de l’ouverture a pris une dimension fondamentale pour énoncer une double modalité de rapport à l’espace.
LSCH : Le motif déployé sur le sol et sur les modules est tiré d’un dessin inspiré d’une pierre de lave poreuse qui me semble transmettre cette qualité de perméabilité aux fortifications, de permettre un passage vers l’ailleurs. Est-ce pour cette raison que vous avez recouru à cette pierre et à son motif ?
AL : Le travail à partir de cette pierre s’est amorcé fin 2015, lors d’une première résidence en Islande, vécue telle une première porte ouverte vers l’ailleurs. Ce fragment de lave condensait l’expérience d’une île volcanique, également trouée de toutes parts. Les céramiques de la série GLOC (2016-2019) donnent forme à cette étrange analogie d’échelles géologiques. Puis, dans la durée, un phénomène d’extraction a fait évoluer le travail des pores de la pierre à une modalité de l’espace qui est celle de la porosité. Lorsqu’on descend dans la casemate, on passe par un trou qui ouvre sur un monde clos, c’est-à-dire qu’à travers ces petits pores dessinés sur des parois repliées/dépliées, se rejoue quelque chose de cette dualité que l’on vit à plus grande échelle dans ce lieu, et encore à une autre échelle dans la ville.
Pascal Neveux : Est-ce qu’il n’y a pas aussi une véritable complicité entre habiter un territoire et habiter une histoire, un récit qui est justement sous-jacent à Gravelines et à l’Islande, une forme de mise en écriture d’une histoire passée et disparue qui est transcendée par votre pratique du dessin et qui se donne à voir dans cette installation ?
AL : Puiser dans ces histoires de pêcheurs qui voguaient vers l’inconnu, entre deux maisons (leur maison familiale qui incarne la stabilité à Gravelines, et cette potentielle maison-hospice à Faskrudsfjordur), c’est tenter de se projeter – d’une projection impossible –, dans la manière dont ils pouvaient habiter dans une instabilité, dans un entre-deux lieux. L’installation Oikos-Poros, par ses flux graphiques, prend en charge des strates historiques dont la charge l’excède ; cette recherche et ce dépassement historiques sont ce qui la met en mouvement, les modules-maisons pouvant être réaménagés, redéplacés, repensés indéfiniment, telle une écriture mouvante dans l’espace. « Habiter une histoire » relève aussi d’un dialogue avec le lieu d’exposition, tant ici la casemate, partiellement en ruine, convoque également l’histoire des guerres de territoires, des frontières en évolution.
LSCH : Il y a une dimension narrative dans cette installation, qui me semble nouvelle dans votre travail, notamment en raison de l’obscurité qui évoque l’inquiétude des pêcheurs qui traversaient l’océan en pleine nuit ou encore le tour de garde des fortifications, et ne serait-ce que par l’idée de placer les visiteuses et les visiteurs, qui s’éclairent au moyen d’une lampe-torche, dans le rôle d’exploratrices et d’explorateurs.
AL : La configuration du lieu, s’amorçant par un tunnel souterrain, appelle à une traversée. Cette progression spatiale et l’écho à des fonds historiques ne sont pour autant narration car on ne saurait nommer ce qui s’y joue. Contre toute attente, le descendant d’un pêcheur à Islande me répéta que son père ne lui parlait pas de la pêche à Islande, qu’on n’en parlait pas. L’histoire présente un manque dans son récit, et ce « trou noir » langagier fut un stimulus.
PN : Il y a une double expérience qui se joue aussi avec l’histoire de ce musée installé au cœur des fortifications de la ville. Il y est autant question de protection, d’abris, de replis que d’ouverture sur le monde, sur le lointain. Un ailleurs dont il n’existe plus de témoignages directs, très peu d’archives et une mémoire presque étouffée révélée par des micro-histoires à travers cette installation. Un sentiment d’étrangeté et de mystère nourrit ce lieu et cette installation, qui fait écho aux campagnes de pêche de plusieurs mois, aux sillons des bateaux, aux flux et reflux de ces incessants voyages au long cours entre ce port de pêche de Gravelines et cette terre promise nourricière. Autant de lignes de fuites, qui dessinent une cartographie qui se réinvente au rythme des itinéraires empruntés par les bateaux de pêche et des souvenirs de marins.
AL : L’installation prend en charge non seulement le lieu immédiat de la casemate, mais aussi plusieurs cercles de résonnance, dans une porosité qui s’élabore entre les lieux et les temps.
PN : Et c’est une expérience physique à laquelle se livrent les visiteuses et les visiteurs puisqu’il y a un vrai cheminement entre la ville – on franchit d’un seul coup un pont-levis, les fortifications, et une fois celles-ci franchies, on doit encore circuler jusqu’à la casemate, puis pénétrer dans un couloir jusqu’à l’installation. On est entouré de fortifications, le paysage environnant de la ville disparaît, puis on entre ensuite au cœur de ces fortifications. Cette expérience singulière est celle d’une mise en condition originale de la visiteuse ou du visiteur qui, avec sa lampe torche, va franchir différents seuils lui permettant d’accéder au cœur névralgique de la casemate, pour s’y perdre et s’y promener tout à la fois, dessinant de nouveaux itinéraires dont les traces invisibles viennent se confondre et s’ajouter aux méandres dessinés que vous proposez.
AL : L’expérience de l’installation est en effet beaucoup plus globale, elle inclut le passage par la ville fortifiée à laquelle elle fait référence en réduction, par ces micro-architectures modulaires qui semblent traversées de flux.
LSCH : D’autant plus que l’on accède ensuite à la casemate sans nécessairement avoir connaissance de toutes les références conceptuelles, visuelles et contextuelles derrière cette installation. Il me semble que c’est d’abord l’expérience du lieu – par sa présence, par son corps, par sa perception – et la sensation de flux qui transmettent, sur le plan sensoriel, une partie de ces références.
AL : Cette configuration spatiale inhabituelle modifie la manière dont on se déplace et dont on s’ancre, elle aiguise la façon de poser son pied sur le sol, comme lors de marches éprouvées sur des glaciers et paysages volcaniques. C’est là la première chose qui est en recherche dans les installations, ce vacillement du corps dans l’espace. Lors du montage, quand je déplace les modules, ils sont comme des danseurs, ils ont un rapport au corps très fort. L’espace est généré de cette manière-là, et le positionnement des modules garde trace de ces interactions.
LSCH : Dans les années 1960, moment où le dessin connaît une forte expansion dans l’espace, il est le résultat d’une action et le plus souvent d’un rapport direct avec le corps qui l’exécute et qui le déploie sur une surface. Dans votre cas, le dessin dans sa forme tridimensionnelle ne relève pas d’un tel processus. Ses différents traitements numériques lui confèrent une forme d’artificialité dans sa matérialité, qui plus est par contraste avec la brique de sable de la casemate. Le support est lui aussi lisse alors que vous labourez presque le papier à chaque trait lorsque vous dessinez. Comment comprendre ce recours au numérique ?
AL : Le passage à l’installation par le numérique est à la fois une recherche de distanciation du jet immédiat du dessin qui touche à un ancrage d’expérience, et le déploiement d’une dynamique contenue dans le dessin ; d’où le principe de dessin-matrice qui peut continuer à générer des formes.
PN : Pourrait-on dire que le numérique vous permet d’ouvrir de nouvelles cartographies sans fin, avec un horizon toujours plus lointain, qui permet d’investir et de s’adapter à des espaces très différents ?
AL : Le numérique me permet en effet de déployer un dessin à tel endroit et encore ailleurs, de telle sorte que la ligne devient transversale entre plusieurs lieux.
LSCH : Est-ce que d’une certaine façon le dessin-source, qui est d’abord l’archive d’un matériau, contient des mémoires inconnues – comme ici celle de la relation de la population locale à l’Islande à travers le récit de pêcheurs – auxquelles vous cherchez à accéder par son activation et sa relation à un lieu ?
AL : Cela me fait penser aux premiers découvreurs de cette casemate, semi-effondrée, qui entraient dans une première ouverture ; derrière les ruines, il y avait d’autres choses à découvrir. Le dessin de la pierre de lave a pour origine l’expérience des volcans, et un volcan, c’est un trou, qui en même temps fait signe en étant lié au fond du monde, comme l’explore Jules Verne. Ce dessin, au stylo pointu, est d’abord un rapport à une surface, il cherche à la percuter, à la creuser. Le déploiement en volume est une façon d’aller outre la surface, comme de chercher à passer le seuil des volcans. Les pores de la pierre sont générés par le phénomène d’ébullition de la lave et on n’en a plus qu’une trace sous la forme d’un creux, d’un vide. Le dessin viendrait ainsi en effet creuser une dimension de l’ordre de l’immémoriel.
PN : Il me semble que le dessin vient également s’incruster dans l’espace de la casemate comme la mémoire dessinée de flux vitaux, de coulées de lave, qui témoignent de la construction et de l’élévation des paysages islandais. Ce dessin numérique exponentiel qui se déploie dans toute sa monumentalité horizontale et verticale nous entraine dans des méandres telluriques, des circulations, des flux imaginaires qu’il faut arriver à canaliser et à connecter entre eux dans une activité matricielle qui s’apparente à un organisme vivant.
AL : Afin de maintenir ces flux en acte, et d’inviter à un redéplacement incessant autour de l’exposition, il y eut le désir que l’installation reste évolutive, et de poursuivre la recherche de manière parallèle avec une eau-forte, telle une forme-synthèse, produite au musée de Gravelines ; un livre d’artiste chez Friville éditions, à partir des documents qui ont fondé l’installation ; et une vitrine au Frac Picardie qui en présente les prémices ainsi qu’une mise en regard avec huit dessins de Sol LeWitt (Isometric Figure Drawing, 1983) de la collection du FRAC Picardie.
PN : Ce dispositif instruit des dialogues féconds entre votre démarche et les recherches conceptuelles de Sol LeWitt dont « les figures isométriques – le cube et ses variations, le parallélogramme, la pyramide, etc – sont un défi apparent à la planéité affirmée car à la limite de l’illusionnisme. Or, ainsi qu’il l’exprime lui-même, Sol Lewitt ne fait « que passer de la forme plane à la forme tridimensionnelle aplanie ».
AL : Cette oscillation des plans ouvre à une déclinaison des formes. Et c’est aussi ce qui a lieu entre chaque dessin de cette série, comme entre chaque module diversement placé, qui exprime dans cet espacement, à l’endroit du vide, une mobilité expérimentale, une aventure de l’incertain.
Virginie Caudron, catalogue d’exposition, Anaïs Lelièvre, Oikos-Poros, une traversée graphique, Une proposition du Frac Picardie, Musée du dessin et de l’estampe originale, Gravelines, Arles, Analogues, Semaine 10.22 (n° 453), 2022.
Le Frac Picardie a proposé au musée du Dessin et de l’Estampe Originale d’accueillir une installation d’Anaïs Lelièvre, il nous a semblé pertinent de la mettre en relation avec l’univers foisonnant de Gustave Doré, créateur de mondes.
Comme Doré, Anaïs Lelièvre détient cette capacité à donner corps à des visions intérieures à partir de fragments de la réalité et à nous immerger dans un monde. À partir du microcosme qu’est le dessin d’une pierre de lave ramassée en Islande, elle construit un monde complet.
Un premier dessin devient matrice, celui de la texture de la pierre. Il est multiplié et agrandi, grâce au numérique, puis imprimé sur métal et PVC, pour construire un environnement en volume. Dans une casemate souterraine, le visiteur découvre l’installation graphique, traverse un labyrinthe aux multiples facettes, éprouve les gardes et contre gardes, les orgues basaltiques, les boucliers, les éperons, ou proues de navire. Car l’artiste a puisé ses références dans l’histoire de Gravelines, ville fortifiée ayant vécu l’épopée des grandes pêches à Islande et dans sa propre rencontre avec les paysages islandais.
« Gravelines aurait-elle un rapport avec l’Islande ? », demande Anais Lelièvre, elle-même marquée par le souvenir des paysages islandais. Circonstance heureuse, l’imaginaire collectif gravelinois s’enrichit en effet d’un rapport singulier à ce territoire, grâce au souvenir partiellement enfoui de l’aventure de la grande pêche à Islande.
De 1820 jusqu’à la première guerre mondiale, goélettes et dundées gravelinois partaient, en fin d’hiver, pour six mois de pêche à la morue dans les eaux Islandaises. Après les rudes épreuves de la pêche en haute mer, en mai, une dizaine de navires flamands faisaient halte dans la baie de Faskrudsfjord, couronnée de volcans enneigés. Là, les voiliers étaient consolidés et ravitaillés en eau douce. Les marins se réconfortaient dans le foyer qu’était pour eux la maison de famille fondée par la Société des Œuvres de Mer.
Entretien avec Anna Olszewska (extrait), catalogue Au bord des paysages #5, 2021.
Installation Ammonoidea 1.
Le titre de votre installation Ammonoidea désigne les ammonites, mollusques connus par leur forme fossilisée qui renvoie au temps géologique de la montagne du Pic Saint Loup. Comment cette référence a-t-elle nourri votre projet ?
La rencontre avec un géologue spécialiste du Grand Pic Saint-Loup ouvrit quelques portes temporelles, permettant de traverser les formes minérales actuelles jusqu’aux processus très anciens qui leur donnèrent lieu. Les ammonites décomposées, par leurs particules organiques, contribuèrent à la teinte des marnes noires dans lesquelles la composition de nombreuses coquilles est conservée intacte sous forme d’empreintes transformées en pyrites (espèce minérale). Suivant cette spirale entre décomposition et composition mais à une autre échelle, ces terres noires construisent une épaisseur importante de cette gigantesque montagne autant qu’elles s’effritent en infimes copeaux. Ce principe d’une existence par strates, à la fois constitutives et friables, rappelle également, si l’on se déplace encore à une autre échelle, que le Pic Saint-Loup est issu de dépôts de sédiments, de mouvements de plaques tectoniques, de plissements, soulèvements de plans autant que de leur érosion en surface.
Dans Ammonoidea, le dessin intervient telle une strate supplémentaire qui, tout en obstruant la vue immédiate du Pic, propose d’autres fenêtres, se substituant à celles de la paroi vitrée du bâtiment. Par la porte qui reste activable, cette strate graphique peut réellement être soulevée. Les plans spatio-temporels alors basculent.
Vos dessins rappellent les relevés de structures organiques et minérales comme les cernes d’arbres, l’écorce fossilisée, les veines des concrétions rocheuses, les formes cellulaires. Souvent, le dessin devient sculpture par superpositions, accumulations, transfert sur des volumes. Le processus de sa création semble apparaitre dans l’image qui en résulte. Quel est le point de départ à ce travail ?
Le “dessin-source” ou “dessin-matrice”, d’abord de petit format (21 x 29,7 cm), retrace au stylo à encre noire l’intérieur d’une ammonite pyritisée. Par sa reproduction numérique, il est ensuite progressivement agrandi, suivant le processus fractal de formation d’une coquille, par croissance spiralaire, jusqu’à recouvrir entièrement une façade intérieure de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (celle donnant sur le Pic qui lui a donné son nom). Dans son agrandissement extrême, le dessin semble bâtisseur à grande échelle en même temps qu’il perd de sa netteté, affirme ses irrégularités, semble lui-même s’effriter, se décomposer en particules. Le grain de la ligne devient telle une texture rocheuse, et le tracé une trace évanescente. Le dessin est là gestuel, expressif de son propre processus et évocateur de ceux, géologiques, qu’il cherche à rejoindre sans y parvenir pleinement. Ces tracés sont à la fois un mouvement vers et sa propre rature, manifestant leur genèse et érosion. Comme processus en train de se faire, le dessin ouvre dès lors sa figuration à une multiplicité d’évocations qui s’agglomèrent ou se succèdent en strates mentales.
La verrière de l’Hôtel des Communauté de communes devient le support pour l’ensemble de déclinaisons du dessin. Son architecture délimite le format. Comment ces relations entre le dessin et son lieu d’accueil s’expriment dans Ammonoidea ?
En rejoignant l’architecture, la coquille réactive l’analogie entre l’habitacle humain et animal. Secrétée par l’organisme, une coquille en suit la croissance et s’y adapte, elle en émane et le revêt. Sa composition interne en plusieurs loges qui semblent scindées, composites, participe en réalité d’un processus de croissance. De manière parallèle, le bâtiment investi est celui de la Communauté de Communes, issue d’une dynamique de rassemblement pour former une plus grande entité de territoire. Etrangement, le plan du bâtiment image comme un plissement architectural (tel un début d’enroulement ou de fracture) et révèle sa composition en une succession de pièces comme de “loges” (en référence aux parties internes de la coquille). La façade est elle-même composée de cases délimitées, auxquelles font échos celles, irrégulières, de la coquille dessinée en coupe. Ces coïncidences visuelles, sans fondement rationnel, viennent néanmoins déclencher des interrogations quant au processus d’urbanisation. Ce bâtiment, situé en milieu naturel, semble être à la fois traversé de son environnement par ses grandes baies vitrées et en proposer des vues, encadrer ou contenir le paysage. Depuis l’intérieur de cet espace, à la fois si ouvert visuellement et si clos matériellement, la sensation est trouble, et l’image de la coquille, à la fois protectrice et permettant la sortie, fut une manière de formaliser ma première expérience de ce lieu. La relation au dehors recoupe ici la relation au sublime d’une histoire géologique très ancienne que l’on n’appréhende que de loin, avec une part persistante d’énigme ; ces fenêtres obstruées sont tout autant relation ambigüe aux origines. La forme croissante d’une coquille à partir d’un point central, figure un processus matriciel ou génétique, qui vient s’appliquer à celui du dessin.
Le dessin qui change d’échelle et de support devient, en se multipliant, l’élément d’une installation spatiale permettant aux visiteurs une expérience visuellement immersive. Pensez-vous que cette mise en espace facilite la réception de vos œuvres ?
Le dessin suit trois plans de l’espace du hall d’entrée, pour amorcer une sensation d’englobement, un début d’enroulement, la genèse d’une grande coquille autour de nous. Néanmoins, le dessin reste ici cadré par les bordures de l’architecture, tout en suggérant sa continuité invisible, hors des baies vitrées. L’expérience proposée relève de cette même ambiguïté entre être dedans et dehors, loin et proche.
A la fois le dessin cherche à générer son propre espace, où l’œil pourrait se perdre, et il entre en dialogue avec le lieu qui a généré sa création. L’écran vitré est à la fois matriciel et écart, ce qu’affirme aussi la grille qui structure et découpe la paroi et l’image.
Je ne sais s’il s’agit de faciliter la réception, ou de la troubler. Ce trouble est le cœur de la démarche. Le trouble entre les échelles, le gigantesque et l’infime, l’intérieur et l’extérieur, le lointain et le proche, l’ancien et l’actuel, ne saurait trouver forme dans sa seule figuration, mais requiert de poursuivre son processus par l’expérience, qui ne cesse de le réactiver.
Dans la vue, l’espace semble surgir d’ailleurs, tout affirmant fortement sa présence par une démesure qui dépasse l’échelle du corps.
A l’instar de vos déplacements, vos œuvres portent souvent des idées qui se poursuivront dans d’autres contextes de travail. Cette cartographie d’idées partagées permet-elle de révéler une proximité entre ces lieux et vos choix esthétiques ?
En effet, par-delà ou en-deçà de l’in situ, je m’intéresse aux transversalités entre les expériences vécues en différents lieux. Des sites éloignés peuvent déclencher des problématiques en certains points similaires. D’un espace à un autre, des continuités se construisent entre ce qui semblait séparé, spécifique et réduit au local. Aussi, une même modalité ou relation peut se poursuivre avec chaque fois des déclinaisons, des adaptations, revirements, approfondissements, telle une temporalité qui se stratifie d’espaces pluriels, et tel un mouvement d’avancée spiralaire. Un travail sur la coquille avait déjà été mené au Centre d’Arts de Port-de-Bouc, il s’agissait alors d’un agglomérat de coquilles brisées dans une ville marquée de brisures historiques ; la coquille y était déjà métaphore bachelardienne de l’habitation, mais par cassure plutôt que continuité spiralaire. Cette coquille d’ammonite devient aussi image d’un processus d’évolution, qui fait se joindre habitat et déplacement, identité esthétique d’une ligne qui s’enroule pour se dérouler à travers les espaces traversés, comme à travers la succession de plusieurs loges qui croissent les unes à la suite des autres.
Philippe Piguet, Anaïs Lelièvre, expériences d’espaces, Chapelle de la Visitation, Thonon-les-Bains, Arles, Analogues, Semaine 25.21, 2021.
L’exposition que consacre la Chapelle de la Visitation à Anaïs Lelièvre s’inscrit dans le cadre de la programmation de la saison 2020-2021 placée sous l’intitulé générique Penser le paysage. Si la marche est à la source du travail de l’artiste, son œuvre se nourrit de toutes les « expériences d’espaces » qu’elle fait d’une résidence à l’autre. Les paysages traversés la conduisent à la prise de conscience des changements d’états de la nature et à une réflexion sur la place de notre corps dans l’espace. Ses installations sont comme une invitation à un voyage intérieur, entre architecture et nature, une façon singulière et sensible d’habiter l’espace.
Publié en 1974, l’ouvrage de Georges Perec intitulé Espèces d’espaces, comporte en forme de « Prière d’insérer » un feuillet mobile, ordinairement destiné par l’éditeur à la presse, parfois repris en quatrième de couverture, présentant le texte que le lecteur s’apprête à lire. Comme l’a fait remarquer l’un de ses exégètes, parce qu’elle est volante, cette feuille « peut prendre sa place n’importe où dans le livre. D’emblée, une mise en question de l’espace immuable et intangible, au sein même de l’objet-livre, est soulevée, illustrant le propos que développera Perec dans l’ensemble de son essai. » Non seulement l’exposition d’Anaïs Lelièvre doit son titre à cet auteur mais les premières lignes de ce prière d’insérer ne sont pas sans faire écho à la démarche de l’artiste : « L’espace de notre vie - poursuit l’écrivain - n’est ni construit, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. » A l’instar de cet auteur, Anaïs Lelièvre développe dans son travail toute une réflexion sur l’espace, sur sa nature et la perception qu’on en a. Qu’est-ce que l’espace par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport au monde ? Par où sa démarche se distingue, c’est le mode opératoire qu’elle a mis en œuvre et par lequel elle mène ses propres expériences d’espaces.
Ce qui motive fondamentalement la démarche de l’artiste, c’est cette naturelle disposition chez elle à vouloir sortir de la force de l’habitude - d’un « habiter identifié », comme elle dit -, de sorte à bouleverser et remettre en question tout usage perceptif récurrent. A cette fin, elle pratique volontiers le mode de la résidence d’artiste, lequel l’entraîne à vivre toutes sortes de confrontations géographiques, historiques, humaines et culturelles avec lesquelles elle s’oblige à composer. En quête d’origine, dans un rapport proprement existentiel avec la nature, Anaïs Lelièvre privilégie sites et situations, territoires et paysages primordiaux au cœur desquels elle est assurée de se confronter à la chaîne mémorielle du vivant. En cela, la marche occupe une place de tout premier plan dans le processus même de sa création, l’ayant amenée ici et là, par monts, par vaux et par-delà les frontières, à poser son regard sur les mondes tant minéral que végétal pour tenter d’en appréhender le secret de leur constitution. Nomade, l’artiste n’a de cesse de voyager d’une contrée à l’autre, d’Audierne à Port-de-Bouc, de Gardur en Islande à Sion en Suisse, de la Grèce au Canada, de la Chine au Brésil, etc.
Au gré de ses résidences, Anaïs Lelièvre a développé sa démarche à l’aune d’une réflexion duelle sur la place de notre corps dans l’espace et la prise de conscience des changements d’état de la nature. Des éléments récoltés au fur et à mesure de ses déambulations – pierre de lave, fruit d’atemoia, géode cristalline, cristaux de silice, pierre cargneule… -, elle a réalisé différents dessins, déterminant comme un catalogue de possibles motifs. Certains sont reproduits en nombre via la photocopie, à des échelles allant du macro au micro, et lui servent de matrices graphiques à la mise en forme tantôt d’installations, tantôt de sculptures. Il y va alors de protocoles qui en appellent aussi bien au collage qu’à l’impression selon les situations et l’évolution du travail. Dans tous les cas, Anaïs Lelièvre en fait un usage extrêmement précis, jouant de la qualité plastique des images agrandies ou réduites, composant avec la découpe des linéaments qui les constituent, toujours soucieuse de restituer visuellement la genèse de l’objet dont elle s’est saisi.
A Thonon-les-Bains, l’artiste a conçu son exposition comme un parcours synthétique à la découverte et à la réflexion de son œuvre. Elle a tout d’abord choisi de mettre en jeu les différentes versions d’une installation intitulée Stratum – conçue à l’appui d’un dessin de pierre de schiste argileux ramassée lors de sa résidence à Sion - qu’elle a réalisées au cours de ces dernières années en les rassemblant en un agencement inédit dans la nef de la chapelle. De la sorte, elle en constitue une nouvelle et neuvième formulation invitant les visiteurs à la traverser, pour la vivre du dedans. Les structures en PVC forex sur lesquelles ont été imprimées l’image du dessin de référence se dressent et se déploient ainsi dans l’espace pour configurer un site aux allures du fameux Cabinet logologique de Dubuffet, parcouru d’une écriture méandreuse. Un lieu innommable, tout à la fois organique, architecturé et minéral. Sitôt qu’il y pénètre, un double ressenti envahit dès lors le promeneur : celui d’un débordement physique, tout d’abord ; d’une perte de repères, ensuite. L’expérience est tour à tour spatiale, sensible, mémorielle, voire psychique, pour ce qu’elle nous renvoie à un temps autre, indicible. Quelque chose d’un chavirement possible, sinon d’une déstabilisation du corps est à l’œuvre dans ce type de propositions tel qu’Anaïs Lelièvre les imagine. Elle revendique même à ce propos le fait de créer des « installations instables ».
Paradoxe - pourrait-on penser – à la découverte dans la salle dite des Sœurs de son Pinnaculum, conçu en écho à l’architecture Musée des Augustins de Toulouse et constitué d’un ensemble de 91 modules géométriques. Suggérant un paysage d’archi-écritures, les éléments qui le composent sont également imprimés sur PVC d’un dessin figurant des Racines de faux cyprès coupées. Comme il plaît toujours à l’artiste de décliner son travail, Pinnaculum a connu plusieurs formes de présentation. Dans son exposition thononaise, elle en propose un nouveau regroupement qui instruit un autre mode d’appréhension tant de l’espace de monstration que de l’œuvre elle-même. Comme si, en mettant en exergue son potentiel infini de combinaisons, elle voulait souligner la dynamique vitale intrinsèque à l’œuvre. Une dynamique augmentée, d’une part, par le fait que les lignes du dessin se poursuivent d’un module à l’autre, créant comme un flux en surface ; de l’autre, par le relief même de l’ensemble résultant des différentes dimensions de chaque module.
Comme une remontée dans le temps, la dernière salle de l’exposition rassemble dans des vitrines quelques pièces qui pourraient s’apparenter à des témoins archéologiques. Le choix de pierres et de céramiques que l’on y trouve notamment permet de prendre une autre mesure de la démarche de l’artiste, celle qui la détermine à l’ordre de la main. Allusion y est faite à ces promenades dans la nature d’où elle rapporte ses trésors et dont elle s’applique via le dessin et la photocopie à nous faire découvrir leur genèse, le graphisme de leur structure, non à l’instar d’un scientifique qui en ferait l’inventaire mais à travers son regard d’artiste et par le biais de gestes tels que l’écriture, le recouvrement ou le creusement de la matière.
C’est que celle-ci est la clef de voûte de toute son œuvre et la façon qu’elle a de la mettre en jeu dans son travail devient l’élément fondateur des espaces qu’elle s’invente. Des espaces qui sont à expérimenter pour mieux les habiter. Ce faisant, l’art d’Anaïs Lelièvre est requis par une pensée du paysage qui replace la figure humaine dans son rapport existentiel à la nature en son état premier, dans un en-deçà du langage.
Clément Sauvoy, Aluring, 20 mai 2021.
Exposition collective Bordures / failles, Galerie La Ferronnerie, Paris.
« L’informe, le magma, profus voire insaisissable, ouvre ses flux à l’apparition de formes qui s’architecturent et le contiennent. A l’image de colonnes basaltiques, interrompant l’éruption, et en gardant trace. Ainsi que des cristaux de silice, arrêtes droites et orientées en tous sens, composant le matériau verre et en rappelant la possibilité d’éclatement… » a-t-elle exprimé dernièrement. Avant d’ajouter ceci : « Je puise mon inspiration à l’endroit où les repères vacillent. Dans l’immense et l’infime des sites. Là où le détail, comme signe, ouvre à une relecture du contexte global. Dans les paysages du sublime ou de la déroute. Puis de plus en plus, dans les déplacements qui se jouent entre les lieux, à l’endroit du transit, qui peut être jonction comme perdition, densité ou éclatement. » Avant de poursuivre ainsi : « Ma première résidence de création fut en Islande, en plein hiver. J’ai marché dans un environnement graphique, noir et blanc, de volcan refroidi et de neige se fissurant. J’ai prélevé une pierre, c’est-à-dire un fragment de montagne : à travers les petits trous d’une pierre de lave, la trace de processus géologiques gigantesques. Cette île est elle-même une forme minérale, poreuse de toutes parts, par les béances ouvertes des volcans. » Accompagnant un processus contextuel, ses oeuvres font des visiteurs les protagonistes de leur environnement et fait que la masse l’emporte toujours sur le détail. Elles questionnent la notion de morphogenèse dans une fabrication du rythme structurel du cumul. En effet, la démarche artistique de Anaïs Lelièvre aborde la composition et le délitement sous un syncrétisme dans des anfractuosités où vient s’arrimer le temps. Elle livre des réalités psychiques où les concaténations de situations célèbrent à la fois la pluralité, la ruine et l’aboutissement. Le regardeur appréciera ces travaux saisissants exerçant sur la rétine une irrésistible attraction qui nous dit que du schiste, découvert dans le Valais, a été retrouvé autrement à Saint-Lô, puis plus récemment aux abords de la pointe du Dourven, et générant un processus construit sur la stratification, sur l’effritement matériel via un mode de construction mémorielle. Il appréhendera des installations, d’abord de papier et éphémères, qui se structurent via des modules aux formes tranchées, en PVC forex, en métal, en plexiglass imprimés, pour aller vers la durée et vers le dehors. La prise d’espace devient un jeu aux multiples recombinaisons possibles au fil des nouveaux lieux d’installation. Chaque installation se replie, se préserve, se replie autrement, de manière augmentée ou réduite, intégrant une modalité d’habitation instable, jamais définitive, autant que des possibilités d’intervention à grande échelle, comme actuellement ce qui est en germe dans le quartier Ferrié à Laval. On aime tout particulièrement cette gestuelle qui donne voix au plissement du dessin, à une lente évolution sous-terraine, à l’action ou encore à un proche lointain fait de densité granuleuse, de coupures et de lenteur silencieuse !
Entretien avec Philippe Piguet, « Anaïs Lelièvre, en quête d’espace », Art absolument, n° 94, octobre-novembre 2020.






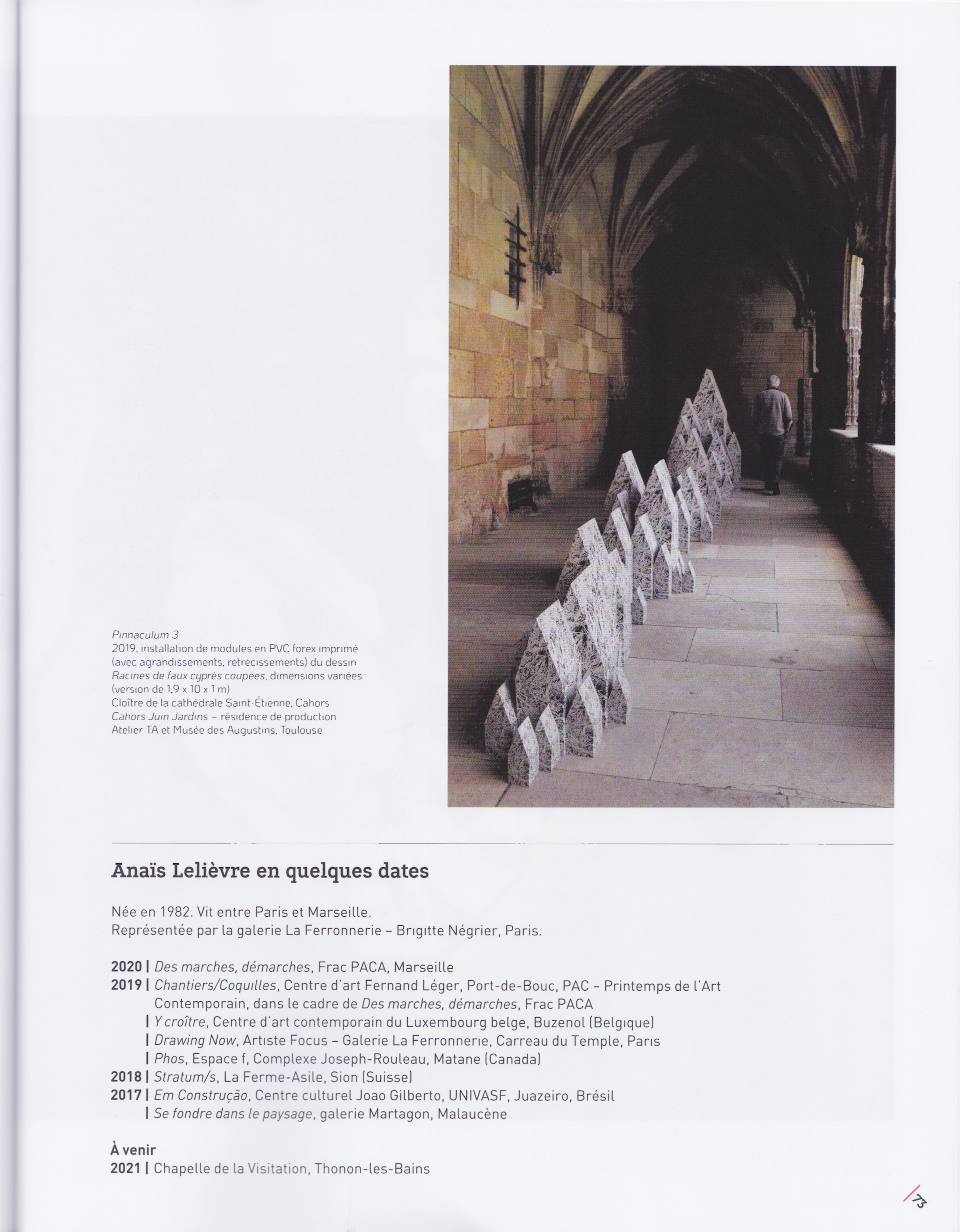
Qualifier la démarche d’Anaïs Lelièvre revient somme toute à s’interroger sur la place de notre corps dans l’espace et à prendre conscience des changements d’états de la nature. Le dessin et le mode de l’installation constituent les deux vecteurs fondamentaux de son travail dans la mise en œuvre d’espaces à habiter qui visent à brouiller tous nos repères. L’artiste instruit ainsi les termes d’un ailleurs inédit, voire innommable, dont l’expérience entraîne le regardeur aux bords d’un vacillement. A la façon quasi rimbaldienne d’une épreuve tout à la fois cognitive et sensible.
A l’origine de vos dernières installations, comme celle que vous avez réalisée au printemps au FRAC PACA, il est question de résidence, de marche et de pierre. Qu’en est-il au juste ?
Lors d’une résidence en Suisse, voilà trois ans, j’ai fait l’expérience pour la première fois de marcher sur des glaciers. J’avais en tête l’image d’étendues de glace, planes et statiques, comme on en a du Pôle Nord. J’ai découvert en fait que ces glaciers étaient en perpétuel mouvement et qu’ils devaient s’adapter aux formes des montagnes entre lesquelles ils s’étendaient. Le sol était complètement crevassé, avec des jaillissements de matière, des failles gigantesques, aussi je me retrouvai dans un espace où le repère du plan horizontal n’avait plus lieu. J’ai rapporté de cette résidence une pierre de schiste, aux strates si friables, et qui est devenue comme un point de référence et d’ancrage. J’en ai fait un dessin destiné à être reproduit en très grande quantité et à différentes échelles pour générer une suite d’installations, invitant les regardeurs eux-mêmes au déplacement et à l’immersion.
D’une résidence à l’autre, vous semblez avoir mis en œuvre une sorte de méthodologie dans votre travail qui vous a conduit chaque fois à développer des formes d’installations qui diffèrent en fonction des lieux où vous intervenez.
Lorsque j’erre aux alentours d’un lieu de résidence, c’est toujours avec le souci d’aller chercher dans l’environnement ce qui va complètement bouleverser mes repères. A mesure que les résidences s’enchaînent, une approche se développe ainsi en pointillé, attentive de plus en plus à ce qui se poursuit dans l’après-coup. Ce qui m’intéresse, c’est comment ces différentes expériences d’espace se traversent, se croisent, s’amplifient, voire se contredisent…
D’où ce caractère de concaténation que présente votre travail…
Il y a en effet un phénomène de stratification d’expériences de lieux qui s’est formalisé dans cette pierre de schiste, laquelle est elle-même composée de strates qui ont été lentement formées par écrasement de la matière. Quelque chose d’une concrétion s’y joue à très grande échelle, tout à la fois spatiale et temporelle.
De quelle manière appréhendez-vous à votre arrivée les lieux où vous allez en résidence ?
L’entrée en matière, c’est-à-dire l’entrée dans un lieu par l’expérience physique, se fait sans préalable. Je ne me documente qu’après avoir vécu, éprouvé l’espace en question et avoir repéré, de manière intuitive, des récurrences, des particularités non prévisibles. Je repère quelque chose de l’ordre de l’infime qui nécessite de passer par un rapport direct pour comprendre l’histoire des formes repérées. Comme lorsque j’observe une pierre pour m’interroger sur les flux et les processus qui la traversent…
Ce faisant, quelle motivation profonde vous gouverne-t-elle ?
C’est une question existentielle de chercher un espace où habiter. Ce qui motive fondamentalement ma démarche, c’est à la fois de sortir de la force de l’habitude - d’un habiter identifié -, pour bouleverser la manière dont je vis, et, à partir de là, recréer un autre lieu qui tienne compte de cette perdition et qui soit en même temps de l’ordre d’un enveloppement…
Il y a là quelque chose d’un paradoxe : vous parlez d’habiter l’espace et vous aspirez à mettre tout en place dans une volonté de perte de repères.
Je crée un habiter qui ne correspond pas à un processus d’architecture, ni de dessins sur plan ; c’est le corps qui place les éléments, souvent à l’aveugle mais aussi dans l’expérience du proche et du lointain. Quand je fais une installation, je ne cesse d’aller dans l’espace et d’en sortir. Je dis que c’est le corps qui place les éléments dans l’espace à partir de l’expérience qu’il a vécu à l’extérieur, mais en même temps je ne fais que suivre la dynamique propre au dessin et à la pierre d’origine, en les déployant à toutes les échelles. Les installations que je réalise sont ainsi tour à tour stratifiées, feuilletées, éclatées ou poreuses…
Comment votre rapport à l’espace a-t-il évolué au fil du temps ?
Pendant toute une période bien antérieure à aujourd’hui, les formes de mon travail étaient très organiques et la seule couleur employée était le rouge. Je porte actuellement une attention beaucoup plus forte à l’architecture et je travaille avec du PVC et du métal, et mon dessin est noir et blanc. L’expérience que je fais du dessin n’est pas celle du projet ou de la projection mais celle de l’errance et de la perdition. C’est aussi une prise de distance par rapport à l’idée d’un incarné qui reste vibrant en dessous et qui fait vibrer ma ligne en surface…
Le noir et blanc, c’est la couleur même de la pensée…
C’est aussi celle de l’écriture et, dans mon travail, les deux sont totalement liées. Auparavant, la pratique de l’écriture et la pratique plastique allaient de l’une à l’autre sous une forme de bascule et d’alternance, l’une nourrissant l’autre. A présent, je cherche une écriture dans la découpe de formes architecturées ; le recours au modulaire me permet de jouer d’agencements très divers. Je m’intéresse notamment à cette conception de l’espace oblique développée par Parent et Virilio : comment le fait d’incliner un plan oblige le corps à d’autres formes de marche, non seulement le corps mais aussi l’esprit. Pour ma part, je n’ai pas l’impression d’être auteur de la manière dont je rentre dans un espace ; j’ai bien plus l’impression de suivre les pentes, les inclinaisons, les fractures, les surgissements que propose l’espace existant.
C’est l’espace qui définit le corps ?
Dans l’expérience que j’en fais, oui. Par exemple, en Suisse, c’est en étant attentive à quelque chose de la fracture dans la petite pierre qui s’effrite et dans ces glaciers qui se crevassent que je suis rentrée dans l’espace par le biais de la faille et de l’effritement.
A l’origine, quelle sorte de culture avez-vous de ce rapport à l’espace qui gouverne si puissamment votre démarche. S’agit-il d’expériences mémorielles ? D’un savoir appris avec le temps ? D’exemples qui vous ont marquée ?
Pendant toute une partie de ma vie, j’ai été très casanière et chaque sortie au dehors était une expérience de l’ordre de l’intense, c’est-à-dire une forme exacerbée de l’attention. Artistiquement parlant, j’ai été très impressionnée il y a de nombreuses années par une exposition de Yayoi Kusama, à la Maison de la culture du Japon, qui se présentait comme un enchaînement de situations nous invitant à des bascules d’un mode d’espace à un autre. J’ai aussi été très marquée par le cabinet logologique de Dubuffet au Centre Pompidou ; le jeu des lignes et des renfoncements, celui des plans et des arêtes construisent dans ce lieu clos un espace d’une incroyable profondeur, curieusement tout en ouvertures.
Pour ce qu’il a posé la question de la phénoménologie de la perception, l’art minimal semble avoir nourri votre démarche. Mais, à la différence des artistes minimaux dont les œuvres en appellent à une esthétique du peu et à un vocabulaire géométrique très rudimentaire, votre travail est en revanche fondé sur l’idée d’invasion. Comment l’expliquez-vous ?
Il y a un paradoxe dans ce que j’apprécie du minimalisme et que Rosalind Krauss a pointé : comment des formes très épurées peuvent-elles générer chez le spectateur des expériences de corps aussi complexes ? Mes installations procèdent quant à elles de la quantité et je cherche, chaque fois, à aller au maximum d’une profusion. Dans les espaces que j’offre à habiter, il est difficile de s’arrêter. Je joue des modulations de la reproduction du dessin, entre agrandissement et rétrécissement, pour les positionner à des endroits qui vont faire vaciller l’attention. Je m’intéresse à des matières qui ont été pliées par le temps géologique, dont les formes closes contiennent quelque chose d’historiquement immense et que je m’applique à déployer jusqu’à l’étourdissement. C’est un processus épuisant et je vacille souvent moi-même à la fin…
Pour en revenir au dessin, il semble que vous en abordiez l’exercice dans la seule relation d’une distanciation objective, quasi scientifique. Vos dessins ont à voir avec l’idée de relevé plus que de tout autre chose…
Ce terme de relevé me convient parce que le rapport que j’ai à l’histoire du dessin est aussi celui de la percussion, de l’incision. Mes céramiques suivent de telles procédures. La dimension graphique y émerge par l’acte d’inscription, de creusement de la matière, renvoyant aux premières tablettes d’argile et à l’activité de comptage. Dans le travail de la céramique, il y a cette tension à nouveau entre inscrire le dessin et la matière qui échappe. Tout se joue toujours chez moi dans cet entre-deux.
Bernard Marcelis, « Anaïs Lelièvre, du dessin évolutif à l’installation immersive ».
Exposition personnelle Stratum 7 : ancrages/traversée, Galerie la Ferronnerie, Paris, soutien du CNAP, 2020.
Trois éléments - ce qui n’est pas rien - frappent d’emblée dès que l’on est confronté au travail d’Anaïs Lelièvre: l’immersion dans l’œuvre, l’utilisation quasi exclusive du noir et blanc, l’évaporation des repères entre dimensions volumétriques et planes.
Ces quelques paramètres constituent en quelque sorte les souvenirs de ma première rencontre avec la démarche de l’artiste, lors du salon Drawing Now en 2019. Les codes du dessin avaient littéralement explosé sous mes yeux, l’œuvre surgissant d’un angle, se développant sur toute la hauteur des murs, rampants et s’étalant sur la moquette du stand. La masse de papier se régénérait par strates faites de plis et de replis, générant des anfractuosités sujettes à de nombreuses interprétations. Mais ce qui se dégageait surtout de ce qu’il convient d’appeler une installation, c’était cette puissance de la forme ainsi créée, cette absorption du dessin par la matière, l’apparition d’une concrétion sculpturale quelque peu hostile, à l’image des parois d’une grotte que l’on se prend à effleurer pour en évaluer la tactilité de la surface rocheuse, mais aussi son effet de trompe-l’œil.
Anaïs Lelièvre en est arrivée au fil des années à élaborer un considérable corpus qu’elle intitule Stratum et qu’elle définit comme « une installation immersive d’impressions numériques sur papier (avec agrandissements et rétrécissements) d’un dessin-matrice ». Elle peut y ajouter également des éléments divers récupérés sur les sites où elle a opéré. Ses installations se déclinent en plusieurs phases successives qui ne cessent d’alimenter ce vaste ensemble, à l’aulne de ses déplacements ou des résidences d’artistes qu’elle apprécie particulièrement. Tout le processus - et c’est bien de cela qu’il s’agit dans sa démarche - trouve son origine dans ce souvent modeste « dessin-matrice » évoquant pour l’artiste le lieu visité ou occupé. Ce dessin initial se voit rapidement dupliqué et multiplié, et perdre son identité première dans une modification du rapport d’échelle et de volume. Petit à petit, il se transforme en une installation adaptée et développée au lieu ou à l’espace qui l’accueille. Selon l’importance de ceux-ci, la dimension labyrinthique de l’œuvre est amplifiée à des degrés divers; au plus ceux-ci sont multiples, au plus le spectateur - qui perçoit implicitement son statut de visiteur muer, au fur et à mesure de sa pérégrination, à celui d’un protagoniste de cet environnement - perd ses repères, le regard noyé par la prolifération des traits qui viennent saturer l’espace.
La grotte évoquée ci-devant pourrait également s’apparenter à une carrière de schiste, cette roche de pierre tendre à la structure feuilletée dont l’exploitation produit des ardoises. Une autre acceptation de ce dernier terme renvoyant bien entendu à un support pour l’écriture et le dessin. Si ce n’est qu’ici, la masse l’emporte sur le détail, la monumentalité sur la singularité. On retrouve cependant cette singularité dans son travail d’extrême précision que constituent les ensembles de céramiques intitulés Fêlures et Oikos-poros.
Alexandre Colliex, « Stratum ».
Exposition personnelle Stratum 7 : ancrages/traversée, Galerie la Ferronnerie, Paris, soutien du CNAP, 2020.
Après même les révolutions de la modernité et la tabula rasa à répétition des avant-gardes, le dessin semble avoir conservé dans l’imaginaire collectif un statut à part. Il serait resté une pratique intime de l’artiste ou bien le laboratoire de sa création. Dans le cours d’une modernité qui a jeté le soupçon sur la main de l’artiste, qui souvent même l’a répudiée comme outil légitime, lui préférant le processus industriel, l’usinage, le dessin est apparu à contre-temps tant il conserve vivante l’indéfectible relation de la main de l’artiste à l’œuvre. Quand l’image même était défiée, le dessin restait le medium de son humble surgissement sur la page.
Naturellement, les pratiques contemporaines du dessin ont mille fois démenti cette vision persistante. Et pourtant, rares sont les artistes qui ont pleinement intégré le dessin à l’installation ou l’ont éprouvé à l’échelle architecturale. Sol LeWitt est notoirement de ceux-là. Et citer son nom au seuil de ce projet dit d’emblée l’ambition, la rigueur et la rareté du travail investi depuis trois ans par Anaïs Lelièvre.
A travers la série Stratum, commencée lors d’une résidence à Sion en Suisse en 2018, et ses diverses déclinaisons comme autant d’explorations menées plus avant dans une voie reconnue propice, Anaïs Lelièvre a bel et bien engagé sa pratique du dessin dans une confrontation avec l’architecture et la pratique de l’installation. L’auguste référence à Sol LeWitt et ses Wall drawings doit s’entendre à cette aune seulement tant les actions et les objectifs poursuivis par Anaïs Lelièvre en diffèrent. Sa méthode est moins mathématique que géologique ; la surface des murs et sol devient le lieu d’émergence de reliefs labyrinthiques ; et le concept de son cheminement engage son corps d’artiste dans l’espace qu’elle a parcouru comme dans celui qu’elle nous donne à explorer.
Le caillou et la caverne
Le travail graphique Stratum développé par Anaïs Lelièvre depuis 2018 est paradoxal. A la fois mimétique et abstrait : il part de l’observation d’une pierre de schiste détachée d’un de ces murs de pierres sèches dont les paysans du Valais ont terrassé leurs coteaux. Reproduit, rétréci et agrandi jusqu’à l’affirmation du trait, le dessin est alors manipulé par Anaïs Lelièvre sous le format d’impressions numériques, qui deviennent la matière première d’installations dans l’espace. Acte de transmutation qui redonne à la pierre dessinée l’utilité d’un matériau de construction. Le caillou est alors étiré aux dimensions d’une caverne et le dessin quitte la feuille pour envahir l’espace.
Superposition de lignes, de points, de grattages, d’impacts et d’écritures, les dessins-sources cherchent, selon les contextes, à restituer le schiste stratifié du territoire sismique des Alpes valaisannes, le marbre pulvérisé de Naxos, ou encore les pierres poreuses d’Islande lors d’une résidence dans cette île volcanique en hiver 2015-2016, ou bien même les gemmes cristallines d’une géode ramenée d’une résidence au Brésil. Au-delà de la collecte du fragment géologique dont le dessin tend à conserver le témoignage en référence au croquis de géologue, le changement d’échelle, l’étirement des lignes suggestives d’une représentation cartographique trahissent l’importance du cheminement dans le paysage.
En passant du dessin à l’installation, l’enjeu pour Anaïs Lelièvre est alors de subvertir l’espace d’exposition. Par la manipulation du dessin, sa prolifération organisée, elle remet en cause l’orthogonalité des plans et nous plonge dans un espace inédit. A la joie enfantine d’explorer une grotte inconnue s’ajoute le plaisir de perdre pied dans un espace que nous ne reconnaissons pas et qui échappe à l’angle droit.
La méthode et le matériau
Cette entreprise de déstabilisation, Anaïs Lelièvre l’avait d’abord engagée par une méthode d’accumulation qui n’était pas sans rappeler le mythique Merzbau hannovrien de Kurt Schwitters. Matériaux « pauvres », objets de récupération, bois, carton et papier constituaient l’armature d’un espace aux angles aigus, relief accidenté hérissé de surplombs et stalactites que le dessin venait couvrir en parachevant l’entreprise de déstabilisation par l’étirement de lignes vives. Ainsi à Naxos, dans sa résidence à la Bazeos Tower, au Centre d’art contemporain du Luxembourg belge et à Sion, la perte de repères, la métamorphose de l’architecture était obtenue par l’agencement oblique d’objets trouvés et par leur camouflage à partir d’un dessin-source déployé. Labeur acharné qui impliquait le corps de l’artiste dans une véritable construction, la charpente de bric et de broc disparaissant sous un travail de dentelière par le collage infiniment délicat des milliers d’impressions du dessin matriciel.
Un nouveau modus operandi s’est mis en place lors d’une résidence fin 2019 à Saint-Lô (ville bâtie de schiste) puis développé lors d’une exposition au FRAC PACA à Marseille et lors des résidences qui ont suivi. A l’empilement de matériaux de récupération, se substituent les formes usinées en PVC sur lesquelles le dessin-source se trouve imprimé. Loin d’être anecdotique, cette remise en cause du processus créatif et la maitrise d’un nouveau medium modifie le sens même de l’œuvre qui affirme sa proximité avec l’espace architectural et théâtral. La multiplication de modules prédéterminés permet désormais d’envisager la création d’un espace largement modulaire et évolutif, par sa manipulation et redéfinition au fil des présentations. L’œuvre finale ressort moins du bricolage que de la mise en scène.
La version présentée à la Galerie La Ferronnerie apporte la synthèse de cette évolution et dans le même temps poursuit l’exploration des effets scéniques permis par ce nouveau matériau, les multiples modules pouvant être diversement reconfigurés par l’artiste. Selon cette même méthode de l’utilisation d’un dessin-source recombiné, une partie de l’espace de la galerie est modifiée afin d’en bouleverser la perception dans une expérience qui a trait au spectaculaire et au jeu sans s’y réduire. Dans l’espace même d’exposition, les modules en PVC de dimensions variables induisent une perte des repères jusqu’à transformer radicalement l’appréhension visuelle et physique du lieu.
La scène et la strate
Mais plus encore que l’affirmation du potentiel scénographique de cette nouvelle pratique, le projet offre la synthèse de la démarche développée par l’artiste depuis deux années à travers la série Stratum. En effet, ce travail est une démarche au sens littéral du terme, stratifiée dans l’espace et le temps. Au commencement est la marche de l’artiste à travers chacun des territoires où elle invitée à intervenir, à créer, à partager avec le public.
Matrice de l’œuvre, le schiste (pierre composée de strates) est un fragment géologique du canton du Valais qu’elle a partiellement parcouru à pied lors de sa résidence. Anaïs Lelièvre trace le portrait même de ce caillou qu’elle extrait et rapporte, et à travers lui le portrait du territoire traversé, tout autant stratifié : couche instable des glaciers arpentés, fragilité des plaques tectoniques avec risque de séisme renouvelé… Et de ce portrait elle érige une grotte intérieure, non moins mystérieuse, et dont chaque ligne semble une courbe de niveau.
Des photographies prises par l’artiste témoignent de cet engagement physique au sein du territoire parcouru à pied. Et si Anaïs Lelièvre ne se réclame pas expressément des pratiques désormais fameuses de Richard Long, son engagement n’est pas sans affinité avec l’artiste anglais faisant œuvre en parcourant le territoire selon les protocoles établis par avance et consignant ses propres déambulations sur la carte comme dans l’espace par le prélèvement de pierres, ou bien au contraire par leur accumulation en cercles, ou bien encore par l’érection d’un cairn discret. De cette affinité, de ces territoires mesurés en heures de marche, des photographies en portent témoignage. Ainsi celle du glacier d’Aletsch, en écho au mur argileux où fut prélevée la roche dont le dessin a capté la structure. Infiniment troublante est la proximité formelle entre le paysage saisi dans son ensemble, entre ce glacier démesuré avec ses lignes, ses arrêtes de glace noircie, ses failles et ses crevasses, et les stries graphiques de la roche dessinée, puis leur traduction à l’échelle de l’installation.
Cet ancrage dans un lieu donné est le secret tectonique au cœur de chaque œuvre d’Anaïs Lelièvre. En parallèle de cette installation-synthèse, l’agencement de petites pièces, imprégnées des diverses résidences, en offre une perception accrue à travers une série de contrepoints et d’échos.
Le principe d’un regard rétrospectif donnant à voir la cohérence d’un cheminement est repris dans l’exposition d’une sélection de reliefs et volumes graphiques de plus petit format, en céramique notamment, réalisés pendant ou après ces résidences. Ce principe vertigineux du jeu sur l’échelle se retrouve dans ces différentes séries dont quelques pièces sont extraites. Leur rassemblement et leur mise en dialogue visent à faire émerger des continuités, des lignes de faille, fractures et persistances, ancrages et traversées.
Entre dessin et sculpture, planéité et échelonnement des plans, les plus récentes céramiques jouent des mêmes ressorts de déstabilisation du regard que l’installation centrale. Le regard cherche en vain à mesurer la profondeur, les reliefs de la pièce dont le graphisme échappe. Déposées sur un unique support, les sculptures semblent telles des fragments de roches détachées de la caverne que le spectateur vient d’explorer. Au mur, les formes pointues des céramiques évoquent celles des modules qui organisent l’installation centrale.
Pauline Lisowski, « Un espace contenant plusieurs expériences de lieux », Le corridor de l’art, octobre 2020.
Exposition personnelle Stratum 7 : ancrages / traversée, Galerie La Ferronnerie, Paris.
Habituée à investir des espaces aux architectures bien différentes et invitée à se mesurer chaque fois au lieu comme un nouveau défi, Anaïs Lelièvre bouscule les perceptions ordinaires des expositions en galerie. Fine observatrice des roches et des minéraux, elle déploie une ligne fluide qui fait écho à ses marches et à la topographie de certains territoires. Son univers est tout autant chaotique qu’organisé et découpé délicatement. On pourrait penser qu’elle prépare d’abord son installation en maquette alors qu’elle vit le lieu, l’expérimente sur place avant de disposer ses panneaux au fur et à mesure de son déplacement. Elle effectue deux voyages, le premier dans un environnement extérieur qu’elle arpente et le second dans l’espace d’exposition que son corps explore et ressent. Son œuvre n’est pas si éloignée de celles des artistes romantiques qui exprimaient la relation de l’homme au paysage. Elle restitue une expérience artistique et existentielle de l’ordre du sublime.
Pour la galerie La Ferronnerie, elle propose une installation dans laquelle elle réunit une diversité de formes qui sont issues de multiples territoires qu’elle a explorés. Lors de sa résidence à Saint-Lô, suite à son exploration de l’histoire de la ville, elle redécouvrit la pierre de schiste – déjà rencontrée en Suisse, s’effritant d’un mur –, mais cette fois-ci sous une forme plus rigide, solide. Cette fascination pour la possibilité constructive de cette roche l’a amenée à passer du papier au PVC. L’œuvre in situ nous rend humble, nous individus qui contemplons et nous laissons attirer par la monumentalité de cette proposition artistique. Cette expérience rejoint celle de la montagne ou d’autres paysages dont l’immensité et les caractéristiques morphologiques nous dépassent.
En parallèle de cette pièce réalisée pour l’espace proche du white cube, elle présente un ensemble de petites sculptures, principalement en céramique. Celles-ci ont pour origine la découverte de pierres durant des résidences dans des contrées lointaines.
Une série de pièces en porcelaine, sur laquelle un dessin de pierre de lave est transféré, a la forme d’une silhouette de maison. La découpe quasi dentelée suggère l’intérieur et les mystères qui résident dans un habitat. Navigant de lieux en lieux pour créer, Anaïs Lelièvre propose avec ses sculptures une réflexion sur les espaces dans lesquels on réside et donne à voir la porosité de l’architecture.
Dans les œuvres de l’artiste, se révèle un aller-retour entre l’élément trouvé de petit format et l’échelle de l’espace à regarder ou à traverser. Ses installations ne sont pas toutes praticables. Certaines sont faites pour être vues et éprouvées. La virtuosité de son travail tient à la fois de sa puissance et de sa légèreté. A partir d’un fragment, elle réalise une œuvre monumentale qui reflète la relation du corps à des sites majestueux et parfois difficiles d’accès.
Ainsi, la galerie de Brigitte Négrier est redessinée et un nouvel espace entre paysage et architecture permet à la fois d’être proche et d’être retenu dans l’envie de pénétrer. Ce franchissement n’impliquerait-il pas une peur et une attirance paradoxale ? Son œuvre contient autant de stratifications que d’ouvertures. Les caractéristiques des pierres prélevées lors de résidences deviennent source de dessins et de formes qui renvoient aux environnements éprouvés. Ses sculptures et installations semblent surgir du sol et évoquent un phénomène naturel, telle l’érosion ou la glaciation. Cette exposition condense différents sites traversés et constitue une synthèse des diverses pierres rencontrées.
Entretien avec Brigitte Négrier.
Exposition personnelle Stratum 7 : ancrages/traversée, Galerie la Ferronnerie, Paris, soutien du CNAP, 2020.
A quelle période, à la suite de quel cheminement, as-tu commencé à produire des œuvres non plus ‘objets’ mais des ensembles occupant l’espace dévolu à l’exposition ? Tout en continuant en parallèle à créer des céramiques…
Ma pratique a toujours été spatialisée. Le flux ou la profusion, qui en est le centre, est une traversée ou une invasion d’espace, un décentrement : à la fois une puissance du vivant à la génération et croissance, et une présence hors de soi et hors de saisie qui ouvre à une expérience de dessaisissement ; tout à la fois une immersion et une mise en crise de la position du corps dans l’espace.
Cette dynamique d’expansion me porte aussi à étendre le cadre du médium (graphique, numérique, sculptural…) vers le dehors : une tendance vers le hors-cadre, la poussée du contenu contre et avec son contenant.
La céramique n’est venue que tardivement, en 2016, dans l’après-coup d’une résidence en Islande et dans la continuité d’autres productions (textiles notamment) agencées ou activées dans l’espace. Les premières céramiques furent conçues avec une spatialisation particulière. Elles restent, pour la plupart, produites dans un rapport au sol ou au mur.
Peux-tu donner l’origine de la volonté d’ancrage des œuvres dans le contexte du lieu d’exposition (pour les résidences) sachant que les nouvelles installations dans des lieux autres d’exposition (FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, galerie la Ferronnerie…) se composent de nouveaux éléments joints à des ensembles créés dans d’autres lieux ?
Ma première résidence, en Islande, en plein hiver, fut une expérience du sublime : des paysages entièrement noirs et blancs, volcans noirs de lave refroidie, recouverts de neige se fracturant en surface et manifestant dans ses traces des processus de formation ou d’érosion. Comme face aux montagnes de favelas du Brésil ou sur les glaciers crevassés de Suisse, ce vif dessaisissement est tel qu’il impulse la nécessité d’un ressaisissement : la prise en main d’une pierre (pierre de lave, géode de cristal, schiste argileux…) est comme un fragment ou une miniature du contexte (poreux, stratifié, éclaté…). A travers son dessin progressivement agrandi, la matière extraite devient un environnement, où est donnée à revivre une perte des repères, constitutive.
L’ancrage est donc impulsé par une impossibilité d’ancrage, face à des paysages de l’immensité et de la perdition d’échelle. Le lent processus de travail, en différé et en intérieur, intègre et reformule cette expérience.
Dans l’après-coup, le travail se poursuit : au plus loin, il mature jusqu’à être au plus près. Ainsi un dessin produit à partir d’un contexte, peut donner lieu à une suite d’installations se déployant en plusieurs lieux et sur plusieurs années, indéfiniment.
La suite Stratum est issue d’une résidence en Suisse en 2018 : le dessin figure une pierre de schiste, si friable qu’elle se délitait d’un mur et faisait s’effondrer du même coup la représentation d’une solidité architecturale. Plus d’un an après, j’appris dans l’heure suivant mon arrivée à Saint-Lô, que cette ville était bâtie sur une colline de schiste, et bâtie avec cette pierre locale, qui résista en partie aux bombardements ou fut réemployée sous le béton de la reconstruction. De fragile et fragilisant l’architecture dans la première expérience, le schiste manifestait une force constructive dans ce second lieu. Le dessin de la pierre de schiste, produit en Suisse, fut alors remis en jeu, dans une installation qui substitua au feuilletage de papier, un agencement de plans architecturés en PVC.
Depuis quelques temps, l’attention s’élargissait déjà du local au transversal. Observer et penser ce qui a lieu non seulement dans une résidence mais entre les résidences, et ce qui se poursuit, même souterrainement, d’une expérience de lieu à une autre : de l’in situ, localisé, à une transversalité des contextes, intégrant des continuités.
Quelques mois après la résidence à Saint-Lô, la version suivante de Stratum au FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur consista à mettre en strates l’ensemble des résidences traversées. Les modules en PVC étaient taillés de manière à faire référence à tous ces lieux, constituant une sorte de terrain de jeu, d’archives réagençables, avec pour prospective que ce chantier soit amplifié de nouvelles parties produites lors des résidences à venir. De là, le dispositif évolutif Stratum, stratification d’espaces et de temps, suivant une modalité déployant celle de la pierre de schiste initiale, composée de strates pouvant se détacher ou se rassembler.
L’élaboration in situ de tes grands ensembles peut évoquer la performance, bien qu’elle soit pratiquée hors spectateur, est-ce un des éléments importants de ton processus créatif ? Peux-tu le décrire ?
Les installations ne sont pas planifiées en amont dans leur agencement ; leur mise en plan impliquerait une rationalisation de l’espace, tandis que le processus empirique et erratique intègre la perte de repères conceptuels pour donner lieu au corps et au non-rationnel. En filigrane, est toujours active l’expérience initiale de dessaisissement dans des paysages hors échelle, sans plus aucun repère orthogonal : au lieu de verticales et d’horizontales, des inclinaisons, imbrications complexes, creusements vers des fonds inaccessibles.
Aussi, suite à l’expérience du corps dessaisi dans le paysage qu’il arpente, c’est le même corps qui se saisit des modules (telles des montagnes…) pour les mettre en place, de manière à perturber l’espace. L’espace est à ce moment en création, comme peut l’être un processus de dessin par assemblage.
Des vidéos restituent ce processus à la fois erratique mais incarné. Là encore, le corps travaille sous le dessin. Il génère la transformation d’espace, qui tend à devenir scénique, sans théâtre : un espace où le corps est en acte et a lieu, ou a eu lieu (lorsque les installations ne sont pas pénétrables par les corps du public).
Dans le cas d’installations en papier, la vidéo qui documente ce montage, restitue la part bricolée, précaire, sous l’effet spectaculaire et minutieux. De bric et de broc, en écho à une résidence au Brésil, le labeur, avec ses fragilités et son insistance, se dévoile et peut être mis en regard de l’installation, la vidéo étant donnée à voir dans un second temps, telle une déconstruction.
Cette dimension performative, sans être performance publique, donne également à sentir que ces installations incarnées sont des lieux où j’habite, comme un mollusque sécrète sa coquille, une araignée sa toile sensible, ou d’autres leurs nids, cocons, terriers.
Tu as récemment opté – à la place du papier – pour un matériau – le PVC – qui donne plus de pérennité à tes installations. La fragilité du papier ne te manque-t-elle pas ?
Le PVC a aussi sa fragilité. Il est très souple et peut se courber comme du papier mais à plus grande échelle. Aussi, le PVC permet de poursuivre le feuilletage obtenu avec le papier mais à une dimension architecturale. Son aspect rigide dans les installations ne tient qu’à l’enchâssement de deux plans fendus. Le souple devient rigide (comme dans le processus de la céramique), mais le rigide peut redevenir souple. Si un module venait à chuter, tous les autres se ploieraient aussi : un risque traverse cet espace incertain, solide-fragile, stable-instable. L’ensemble démonté se stocke à plat, sur très peu d’épaisseur, pour se redéployer autrement dans l’espace suivant : le dispositif est ouvert et mobile, dans une tension avec la référence architecturale, d’une architecture souple et instable, qui s’érige au risque de son effondrement. Le papier en feuilletage évoquait des images plus matiéristes, entre strates rocheuses, épiderme vivant, invasion végétale… Le PVC met en tension matière et forme. Et techniquement, il permet au dessin de se détacher de la contrainte de l’appui de supports rigides (planches, etc. sur lesquelles le papier était fixé) contre les murs, pour émerger de toutes parts dans l’espace et le bouleverser dans sa totalité. Le vide que laissaient les installations de papier au centre de l’espace est désormais pleinement traversé de formes dynamiques, tels d’autres murs en construction libre. Au niveau du processus de recherche, l’exploration du papier atteint cette sensation d’en avoir épuisé les possibles, pour évoluer vers le PVC qui tend actuellement à évoluer encore vers le métal – dont la finesse évoque celle du papier plié, tout en permettant des installations pérennes en extérieur, dialoguant avec un environnement architecturé.
Que dirais-tu de l’articulation entre les grandes installations (Stratum…) et les séries de céramiques, porcelaine et faïence, de petites dimensions ?
Les installations procèdent par rétrécissement et agrandissement d’un dessin, jusqu’à l’infime du point ou la démesure de la surface noire. Ce processus a sa source dans l’expérience vécue en contexte de résidence : une analogie apparait après-coup entre la matière prélevée puis dessinée et l’environnement dans sa globalité. Lors de la résidence en Suisse, la pierre de schiste composée de strates condensait l’expérience de la marche sur des glaciers comme autant de strates crevassées, fendues, fragiles ; ainsi que la connaissance de failles locales au niveau des plaques tectoniques, susceptibles de produire des secousses sismiques à cette période.
Aussi, entre installation enveloppante et petites pièces qui se manient aisément, cette tension à l’œuvre dans le processus se rejoue au sein de l’exposition où elles coexistent. A la fois un étirement des échelles et leur équivalence ou renversement. Si les installations consistent à déployer le dessin en volume, le travail en céramique est étrangement recherche du graphique : les deux médiums se cherchent transversalement dans l’autre. Mais dans ces bascules, des modalités se poursuivent. C’est le travail de strates dans Stratum qui amena à une stratification des céramiques – Fêlures (la gravure contre soi) – ; et c’est le creusement de cette modalité en céramique qui fait retour par une complexification des strates dans les installations. La main ou le corps passent de l’un à l’autre et assurent une forme de continuité du geste entre deux médiums, échelles, spatialités.
Pourquoi ce choix délibéré du noir et blanc, pour les installations comme pour les céramiques ou les éléments, par exemple, constitutifs de l’ensemble Atemoia 5 ?
Pourquoi attendre de la couleur ? Le noir et blanc à grande échelle est irruption d’un monde en rupture avec celui que nous connaissons, coloré, que nous observons à partir d’un corps qui est également couleur.
En réalité, sous ce noir et blanc invasif, vit le rouge, la vivacité de la chair ou l’ébullition du magma. Cela est manifeste dans la série GLOC, faïence rouge émaillée en noir et blanc, ou dans Bavures (le rouge sous le dessin). Les périodes précédentes faisaient apparaître la dominante du rouge, avec en parallèle une pratique de dessin noir et blanc. Mon travail actuel en fait la synthèse : le noir et blanc n’est que dans une tension avec une matière vitale que le dessin cherche à cerner, et dont il ressort vibrant ; il est sa mise à distance et son impossibilité à la contenir.
Ce que je cherche à faire jaillir ou émerger est un monde de flux, qui procède de la traversée affirmée du geste dans l’espace. Le tracé du dessin en est la trace et génère une perception dynamisée. Dès lors, la couleur n’y a pas sa nécessité, elle dévierait l’attention de ce mouvement dont l’incertain trouble ; ce trouble qui nous emporte dans un on-ne-sait-où, qui nous dessaisit tout en résonnant avec nos flux internes. Bleues, ces lignes dynamiques appelleraient de manière univoque des images sous-marines ou aériennes ; vertes, elles deviendraient herbe ou feuillage ; rouges, chair ou feu ; brunes, terre ou pelage… Tandis que le noir et blanc maintient l’interprétation dans l’incertain et l’indéfini, grouillement d’images multiples qui se contredisent, s’enlacent ou se continuent, sans qu’une seule puisse s’en extraire nettement. Le flux à l’œuvre est transversal, il traverse indistinctement l’humain, l’animal, le végétal, le vivant et le géologique, l’environnement terrestre, sous-terrain et cosmique, l’activité physique, sensorielle et psychique… La coprésence du noir et du blanc qui se font apparaître l’un par l’autre est à l’image d’un monde bâti de contradictions, de renversements, d’identités ou convergences des contraires.
Le noir est aussi celui de l’écriture, et la ligne-flux est écriture impossible. La plupart de mes dessins portent dans leurs stries la présence de mots raturés qui participent d’une même recherche à transcrire une expérience de l’incernable ou innommable.
Par le noir et blanc et le geste de percussion, l’approche de la céramique est aussi graphique voire scripturale : encore une fois, une tension entre le tracé noir et une matière informe, qu’il cherche à mettre à distance et qui l’anime, le traverse. Présentant à la fois une matérialité profuse et une surface graphique, ces céramiques énoncent pleinement cette tension – tandis qu’elle n’est que successive dans le processus menant aux installations (l’extraction d’une matière, puis son dessin). Entre installations et petites pièces, l’identité du noir et blanc fait dialoguer l’immense et l’infime, l’expansion et la concentration.
Enfin, le contraste noir et blanc est maximal et produit l’effet d’une présence hallucinatoire, puisant notamment dans l’expérience de l’art optique.
Marc Pottier, « Le dessin sans limite d’Anaïs Lelièvre s’élève du Poush, premier gratte-ciel d’ateliers d’artistes », Singulars, 11 août 2020.
Ne parlez pas de « limite » à Anaïs Lelièvre. L’artiste née en 1982 ne sait même pas ce que ce mot veut dire ! D’autant qu’elle fut l’une des premières à investir le Poush, le premier gratte-ciel d’ateliers d’artistes où elle peut compter sur cet incubateur pertinent pour déployer son travail. Elle confie à Singulars les ressorts de ses dessins qui par le jeu de la multiplication numérique débordent tout cadre.
Sortir du cadre et tutoyer les nuages
Comment définir un travail qui n’a pas de limite, qui commence dans un lieu et se termine dans d’autres comme Stratum (de Marseille à Paris) ? De la technique millénaire du dessin, Anaïs Lelièvre fait « autre chose », pas toujours simple à nommer : des sculptures dessinées, des explosions de collages en noir et blanc, des fragments de matière minérale ou végétale ? Tout son travail concourt à dépasser les limites du cadre, et sortir des architectures. De ses traces petit format, par un jeu de multiplication numérique l’artiste réussit à générer un environnement immersif, sans limite ! Sans nul doute, que son atelier installé au sein de Poush, le premier incubateur d’artistes temporaire niché dans un « IGH » (Immeuble de Grande Hauteur) va lui donner encore plus de hauteur !
Manifesto entreprise de coaching culturel, vient d’ouvrir mars 2020 un lieu novateur dédié à la création contemporaine : Poush, un incubateur d’artistes.
Dans un IGH (Immeuble de Grande Hauteur) construit dans les années 1970 porte Pouchet à Clichy, c’est bien une nouvelle ‘Ruche’ qui se constitue cette fois dans les nuages. Avec Anaïs Lelièvre, ils sont déjà une quarantaine à s’installer sur trois étages, avec quelques belles personnalités à suivre (selon nous) : Grégory Chatonsky, Pierre Clément, Paul Créange, Angelica Mesiti, Marie-Luce Nadal.
Un « dessin-source » qui se déploie
« Le principe est qu’au départ de chaque installation ou chaque suite d’installation, il y a un dessin, que je nomme “dessin-source” ou “dessin-matrice”. » Anaïs Lelièvre détaille son process de création. Ce dessin est numérisé et progressivement rétréci et agrandi, jusqu’à tendre à l’infime d’un point ou à ce que la ligne devienne surface. Le tout est imprimé par photocopieuse.
« Un dessin est ainsi une réserve, qui se déploie en une diversité de textures, puis en une diversité d’espaces, car un dessin-source peut générer plusieurs installations, chaque fois différente. Désormais, je travaille sur PVC imprimé de la même manière et non plus sur papier. » nous révèle-t-elle.
Des tracés sismiques
L’artiste continue de nous livrer un peu ses secrets : « Le dessin est sans cesse ce dessein qui rate. En cela il semble gravure mais n’en est pas. C’est dans ce rapport, qui se décale du dessous au-dessus, de la profondeur à la surface, du tout près au très loin, que ça vibre et que ça vit. Cherchant à cerner autrement ce qui s’y joue, des mots griffonnés et raturés, recouverts ou recouvrant, se débordent et se distordent, ouvrant à une lecture non linéaire, ponctuée et rebondissante de ses manques. Et cette tentative de perforation et d’énonciation qui devient lignes, tracés sismiques, est ce qui fait que le dessin persiste actif, réactivant sans cesse, dans l’espace du regard, son processus d’émergence.
Guillaume Monsaingeon
Commissaire de l’exposition Des marches, démarches, FRAC PACA, Marseille, 2020.
Etalés sur deux années, les multiples projets développés dans le cadre de Des marches, démarches ont permis à certains artistes de prolonger et d’enrichir leurs pratiques. Anaïs Lelièvre a ainsi présenté au centre d’art Fernand Léger à Port-de-Bouc l’exposition intitulée Chantiers. Son enquête investit aujourd’hui le plateau expérimental comme une sorte de prolongement également nourri de ses résidences à Cahors, en Suisse, à Loupian et en Islande.
A chaque fois, paysage et géologie conduisent l’artiste à des explorations en volume et en dessin. L’originalité de son approche tient à la rencontre entre marche, glanage et collecte d’objets naturels comme d’encombrants qui fusionnent pour devenir architecture immersive.
Le visiteur est invité à marcher sur les pas de l’artiste ; ses dessins sont devenus installation, ses trouvailles structure, ses promenades fragmentation. Accumulation, synthèse, ellipse, expérience en cours constituent un libre condensé de marches en tous sens.
Pauline Lisowski, journal de l’exposition Y croître, CACLB, Centre d’art contemporain du Luxembourg belge, Buzenol, Belgique, 2019.
Installation Atemoia 4.
Anaïs Lelièvre travaille entre minutie et lâcher-prise, observation fine des formes de la nature et processus d’altération de l’image par la photocopie. À partir d’un dessin démultiplié d’un fragment, d’une matière qu’elle rétrécit et agrandit grâce à l’outil numérique, elle crée un nouveau motif dans l’espace. Le visiteur y plonge son regard, son corps, et se perd dans ce foisonnement de textures et de lignes. L’artiste occupe et transforme le volume dans sa totalité, elle invite à y pénétrer.
Son installation combine à la fois concentration et déploiement, ouverture et fermeture. Elle suggère le cycle de la respiration, la sensation de croissance, un processus de construction à la fois incertain et d’une grande richesse. Face à cette œuvre, surgissent et s’entremêlent des sensations d’envahissement, de prolifération, de puissance et de légèreté.
Céline Ghisleri, « Hors des chantiers battus », Ventilo, n° 428, 2019, p. 20.
Exposition personnelle CHANTIERS/Coquilles, Centre d’arts Fernand Léger, Port-de-Bouc.
Installation monumentale d’Anaïs Lelièvre à Port-de-Bouc et petites œuvres dissimulées dans la ville où le projet Des marches, démarches initié par le FRAC PACA a conduit ses pas, l’exposition Chantiers/Coquilles n’aurait pas pu trouver contexte plus à propos que le Centre d’arts plastiques Fernand Léger…
[…] Anaïs Lelièvre parcourt le monde au gré de projets artistiques qui l’amènent à penser qu’elle en est devenue nomade… Ce nomadisme prendrait presque part à son travail comme sujet et comme dispositif, qui revient au final à rassembler en une même œuvre commune, en constante évolution, toutes celles réalisées au cours d’années de travail chronologiquement et géographiquement disparates… Il s’agit, comme les titres de ses expositions l’indiquent, d’un gigantesque chantier artistique qui s’agglomère à l’image des concrétions qui sont le point de départ du chantier développé lors de sa résidence à Port-de-Bouc. C’est ce qu’on appelle dans le jargon de l’art contemporain un work in progress, littéralement une œuvre en train de se faire, une notion qui explore la question de la temporalité avec un commencement et un achèvement incertain. Les artistes n’ont eu de cesse de questionner cette présence de l’inachevé, à propos duquel Maurice Blanchot dit « que l’objet chantier ne manque jamais puisque le manque en est sa marque. » Si l’on connaît bien les images de Pierre Huygues ou les photos de Bustamante, c’est sans doute à Fernand Léger que nous devons les représentations les plus célèbres et les plus joyeuses du chantier… Chantiers/Coquilles ne fut donc pas qu’une étape pour Anaïs Lelièvre mais une pierre à l’édifice de cette immense et passionnante mise en œuvre développée également à Cahors et à Loupian, et plus largement dans les multiples sites où elle intervient et interviendra en résidence.
On ne saurait qualifier simplement le travail d’Anaïs Lelièvre, qui se meut à la fois dans le dessin et la sculpture, un savant syncrétisme relevant des spécificités des deux médiums. Si dans les nouvelles voies empruntées par le dessin depuis une décennie, on parle de dessin dans l’espace qui s’affranchit de la feuille pour se répandre dans la concrétude des lieux le contenant, ce n’est pas tout à fait le cas des dessins de l’artiste qui se reproduisent et se démultiplient mais demeurent intimement liés au papier utilisé, à la fois comme support du trait mais également comme matériau de construction et de recouvrement… Ce travail nous amène de l’infiniment petit à l’infiniment grand, d’installations monumentales, au sein desquelles le visiteur ressent l’étrange sensation de pénétrer l’intérieur du dessin lui-même, à de minutieuses et fragiles petites sculptures comme les céramiques noires et blanches Coquilles (le trait qui ne saisit rien) ou l’ensemble de pierres Stratus. Les œuvres d’Anaïs Lelièvre traitent de ces oppositions qui font le monde, du dispersement de la matière réunie en un tout, à l’image des concrétions de coquillages observées sur un chantier de fouilles sous-marines de Port-de-Bouc, dont l’œuvre Coquille (le langage impossible) raconte implicitement le souvenir, « de la composition et du délitement, de la forme et de l’informe, de l’ambivalence entre devenir et ruine, projet et aboutissement, précarité des équilibres… » Autant de questions qui ont finalement à voir avec celle du couple matière/forme émis par Aristote qui taraude tous les artistes depuis plus de vingt-et-un siècles…
Les environnements d’Anaïs Lelièvre sont comme des cocons matriciels, entre espaces minéraux et biomorphismes, dans lesquels la précarité des équilibres se pose. Si ces espaces représentent une œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique, ils évoquent aussi la pauvreté d’un matériau, l’abnégation de l’artiste à la machine et, dans le cas de l’installation à Port-de-Bouc, ils n’évincent pas la question de l’Anthropocène puisque les volumes recouverts de photocopies sont formés par du mobilier abandonné et récupéré par l’artiste. D’ailleurs, la présence de l’artiste se poursuit dans les rues de Port-de-Bouc où elle a disséminé des pierres que les habitants découvriront au hasard d’une balade, réunis dans une quête similaire et œuvrant tous à la construction d’un propos commun.
Philippe Piguet, « Anaïs Lelièvre, à l’origine », Anaïs Lelièvre, Chantiers (prémices), Arles, Analogues, Semaine 20.19, 2019.
Parcours d’expositions : Chantiers/Coquilles, Centre d’art Fernand Léger, Port-de-Bouc ; Chantiers/Pinnaculum, Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, Cahors Juin Jardins ; Chantiers/Stratum, Musée de site archéologique gallo-romain et espace o25rjj, Loupian.
« Le monde est symétrique et les objets du monde sont symétriques, mais les pierres ne le sont pas », dit Roger Caillois au cours d’une conversation filmée. Et le philosophe d’ajouter : « Une pierre, même en morceaux, est entière d’un point de vue chimique ; dans chaque morceau, il y a toutes les qualités permanentes de l’espèce minérale. » Du local au global, et inversement, on ne peut mieux exprimer le rapport d’étroitesse infinie qui existe entre l’atome et le cosmos. Des pierres, considérées comme figures modèles d’une forme de vivant doublée d’une qualité esthétique absolue, Roger Caillois nous a invité à prendre toute la mesure. Tant pour ce qu’elles exercent depuis toujours une fascination sur l’homme que pour ce qu’elles suscitent en chacun de nous tout un monde de sentiments et d’images.
Le rapport qu’Anaïs Lelièvre entretient à la marche et l’intérêt qu’elle s’est découverte pour les pierres lors d’une résidence en Islande participent à situer sa démarche à l’aune d’une réflexion duelle : la place de notre corps dans l’espace et la prise de conscience des changements d’état de la nature. A ce titre, l’une de ses pièces les plus marquantes semble bien être cette série de 109 éléments, intitulée Stratus (2018), faite à partir de pierres de tailles variables, récoltées au glacier de Ferpècle, en Suisse, portant tout à la fois la brisure de leur chute et la courbure de l’érosion. Celle-ci procède du marouflage d’impressions numériques, au motif réduit du dessin d’une pierre en schiste argileux lui ayant servi de modèle, sur tout un lot de pierres stratifiées en gneiss. La façon qu’elle a de recouvrir celles-ci en prenant soin d’épouser toutes leurs aspérités aboutit à la création d’objets quasi cloniques issus d’un autre monde. Il y va là d’une problématique récurrente chez l’artiste qui en appelle aux notions conjuguées de mémoire, de multiple, d’éclatement, d’enveloppe et de stratification, lesquelles fondent ontologiquement ses recherches.
Dans son rapport aux lieux où elle est amenée à intervenir, l’art d’Anaïs Lelièvre relève d’une observation affinée des données contextuelles avec lesquelles elle doit composer. Requis par la nécessité qui est en elle d’y faire écho, il lui faut s’en imprégner, les vivre du dedans, en faire l’expérience, pour inventer chaque fois une forme qui participera à les évoquer. Dans ce processus, la prise en charge qu’elle peut y faire d’un élément matriciel qui condense en lui la totalité mémorielle du site où elle opère est déterminante. Ici, telle pierre ; là, telle graine ; là encore, tel coquillage. La nature, chez elle, n’est pas le sujet de l’œuvre mais le vecteur par lequel elle cherche à faire transiter le vivant. Le travail d’Anaïs Lelièvre repose sur des processus de déplacements et une réflexion sur la morphogenèse. « Si j’étais juste sur des formes que je pourrais nommer nature, il y aurait quelque chose de l’ordre d’une fermeture », dit-elle. Or, elle cherche à suivre le mouvement, celui des germes d’une pomme de terre, de la structure de l’atemoia, de l’éclatement d’une géode ou de la fracture d’une patelle. Aussi le principe d’enchaînement, de concaténation d’une situation à l’autre, gouverne sa démarche et conduit l’artiste à penser chaque fois une forme de développement nouvelle.
D’un lieu à l’autre, le mode de l’invasion qui caractérise les installations qu’elle réalise détermine dès lors de nouveaux espaces dans lesquels le regardeur est invité sinon à pénétrer, du moins à se confronter. A mettre en quelque sorte son corps en jeu. A se laisser déborder par l’expérience proposée en remettant en question ses habitudes perceptives. Fortes d’une dimension d’énigme, les œuvres d’Anaïs Lelièvre exercent une irrésistible attraction tant physique que mentale dans un rapport d’inquiétude certaine. Quelque chose y est en effet d’un mouvement en cours dont on ne peut dire s’il s’agit d’un commencement ou d’une fin, voire d’une construction ou d’un effondrement. Son champ d’action multiplie les cas de figures en situation de passage, de transformation et son art s’inscrit volontiers à l’ordre d’un entre-deux, dans un simultané entre apparition et disparition, entre solidité et fragilité, entre éphémère et durée.
Dans son rapport matière/dessin qui architecture l’esthétique d’Anaïs Lelièvre, alors que ses premières œuvres distinguaient nettement chacun de ces deux registres, une forme de porosité s’est opérée à l’épreuve du temps au cœur de sa démarche pour cerner les contours d’une synthèse. Que le concept de chantier la préoccupe nouvellement n’est sans doute pas innocent du sens profond que porte ce mot. Il est le lieu rassemblé d’une déposition et d’une édification, celui d’une industrie, d’une fabrique, un « atelier extérieur » comme on en parlait au XVIIIe. Anaïs Lelièvre est familière de ce type d’espace pour ce qu’il est en transit, dans le flux d’une énergie vitale. Le dessin qui est non seulement son médium de prédilection mais le vecteur sensible et matériel par lequel elle s’exprime tient justement à cette qualité primordiale d’être à la naissance de la forme. En toute proximité de la pensée, à l’instant de sa métamorphose. Là même où siège l’œuvre de l’artiste, en un lieu d’origine.
Laure Lamarre-Flores, Anaïs Lelièvre, Chantiers (prémices), Arles, Analogues, Semaine 20.19, 2019.
Parcours d’expositions : Chantiers/Coquilles, Centre d’art Fernand Léger, Port-de-Bouc ; Chantiers/Pinnaculum, Cathédrale Saint-Etienne de Cahors, Cahors Juin Jardins ; Chantiers/Stratum, Musée de site archéologique gallo-romain et espace o25rjj, Loupian.
De Port-de-Bouc à Loupian en passant par Cahors, Anaïs Lelièvre décline, par jeu d’éclatements et de rassemblements propres à son nomadisme, les différentes étapes de son chantier. Ce dernier est à comprendre dans la définition qu’en donne « la Poétique du chantier » de la revue Ligeia, soit un espace-temps de travail ouvert à tous les possibles, « un théâtre de création ». Architectural, historique, spatial ou psychique, il fait se rencontrer des réalités diverses d’une archéologie à la fois antique et contemporaine au cœur d’un parcours interrégional. Anaïs y concrétise plusieurs années de recherche sur le dessin autour de la question de la composition et du délitement, de la forme et de l’informe, de l’ambivalence entre devenir et ruine, projet et aboutissement. Réflexions et productions s’agencent par strates successives auxquelles fait écho le format d’expositions choisi. Eloignés mais imbriqués les uns aux autres, ces lieux sont les réceptacles de pièces qui apparaissent, se complètent, stagnent ou disparaissent dans des installations intrinsèquement liées à un processus de construction. Ils sont la projection à la fois physique et mentale de la mécanique créatrice de l’Artiste : un seul et même chantier de pensée et d’ouvrage.
Alexandre Colliex, « Belles feuilles pour vrais collectionneurs », Diptyk, n° 48, avril-mai 2019, p. 98-99.
Salon Drawing now 2019, Paris.
L’installation proliférante en 3D présentée par la galerie de la Ferronnerie était l’une des attractions de Drawing Now. Artiste marseillaise de 37 ans douée du don d’ubiquité, Anaïs Lelièvre nourrit sa pratique très singulière des multiples résidences internationales qui l’ont déjà retenue : Islande, Roumanie, Chine, Brésil et Suisse. Elle donne au dessin l’ampleur d’une installation in situ. Le point de départ de chaque œuvre est un dessin au stylo sur une feuille de format A4 auquel l’artiste fait ensuite subir une série de duplications par photocopie digitale, d’agrandissements, de rétrécissements. La superposition des plans, à partir du nucléus d’un unique dessin, donne à l’œuvre une ampleur vertigineuse. La graphie se propage dans l’espace tel une excroissance minérale. Réalisée lors d’une récente résidence à Sion, l’installation Stratum (Sion) prend pour point de départ un dessin de schiste argileux. Selon le support choisi, l’œuvre peut même être présentée en extérieur de manière pérenne. À l’heure de l’outil numérique, le dessin à l’encre semble ici capable de conquérir de nouveaux territoires.
Entretien avec Frédérique Le Graverend, « Le même et le différent », revue Area, n° 35, 2019, p. 49-53.
Anaïs Lelièvre s’est d’abord engagée dans un double parcours universitaire, étudiant Arts plastiques et Esthétique et science de l’art avec un pan théorique lié à son attrait pour le langage. Puis elle a intégré les Beaux-arts de Rueil-Malmaison et ceux de Rouen.
Vous utilisez souvent les mots dans votre travail…
De manière récurrente dans l’œuvre, mais parfois aussi autour de l’œuvre, quelque chose qui vient se formaliser comme un accompagnement.
Le langage verbal dans mon travail dit une tension avec la matière. Je pars souvent d’une matière qui est une réalité insaisissable sous mes yeux. Je cherche à l’appréhender par le dessin, la ligne tentant de cerner cette présence mais devenant rature, car elle n’y parvient pas. Dans cette ligne se trouvent aussi des mots qui cherchent à nommer, mais cette matière est de l’ordre de l’innommable. Le langage est une forme qui est mise en tension avec une matérialité qui lui échappe mais qui est aussi son moteur.
Dessin et écriture sont là totalement liés comme dans la culture chinoise. Dans Le Geste et la parole, André Leroi-Gourhan traite des origines du graphisme et il remonte aux gestes de percussion qui sont liés aux rituels. Dans les dessins, je percute aussi la surface de la feuille, raison pour laquelle je l’envisage comme de l’écriture. Lorsque j’agrandis ces dessins à l’extrême dans Photoshop, on perçoit des formes très proches d’une écriture. Mes dessins tentent de dessiner des matières, comme le langage sert à l’origine à nommer, à définir la réalité qu’on a sous les yeux. Pour moi, c’est la même tension.
N’y-a-t-il pas contraste entre la fragilité du papier et le poids des pierres ?
Bien sûr, mais de manière contradictoire car le papier en quantité devient très pesant et la pierre a aussi sa fragilité. La pierre continue d’évoluer même si elle nous semble inerte. On a l’habitude de scinder le minéral et le vivant ; pourtant de nombreuses études scientifiques pointent leurs relations. La pierre évolue, mais à une échelle que nous ne pouvons pas appréhender car elle est très loin de celle de notre corps.
Lors d’une résidence à la Ferme-Asile à Sion en Suisse l’été dernier, j’ai travaillé à partir d’une pierre très friable, un schiste d’origine argileuse, plus fragile encore que du papier. J’ai pu l’arracher d’un mur à la main. A peine la touche-t-on qu’elle s’effrite, tombe en poussière et prend alors l’aspect de papier en cendre.
C’est cette contradiction que l’on retrouve dans la série Stratus.
Lors de cette résidence, en parallèle de l’installation Stratum, j’ai produit la série Stratus à partir des photocopies numériques du même dessin de ce schiste argileux. Ces reproductions sur papier sont marouflées, morceau par morceau, sur des pierres de gneiss, plus solides, mais brisées et dont les strates pourraient aussi se déliter. Ainsi enveloppées, les pierres semblent légères, nuageuses. C’est le papier qui donne cette sensation d’allègement. Le dessin ne cherche pas un modelé qui alourdit ; le volume est rendu par un graphisme linéaire et vibratile, par une multiplication des tracés. C’est peut-être la gestualité qui ravive le dessin. Les strates de son errance.
En fait j’utilise beaucoup de papier et comme je mène une vie de nomade de résidence en résidence, je transporte des valises remplies de papier, très lourdes à porter.
Vous avez participé à de nombreuses résidences. Est-ce parce que vous aimez travailler in situ ?
Ma création se nourrit du rapport au contexte et de l’ailleurs. Les résidences les plus marquantes ont été en Islande, au Brésil et en Suisse, avec des moments où j’étais en perdition totale de repères dans des paysages inhabituels. Le moment marquant de l’été dernier fut la marche sur un glacier en Suisse, l’instant où le sol se mit à craquer. Dans un milieu urbain, on a l’habitude d’éprouver un sol stable, les murs et les sols sont des espaces de délimitation, de sécurisation. Mais sur le glacier, le sol est friable. J’ai ramassé une petite pierre dans laquelle j’ai trouvé de manière réduite cette friabilité de l’espace.
Mon travail nécessite des allers-retours entre l’atelier et l’extérieur, de partir à la rencontre d’un monde qui met en branle mes repères et de rentrer à l’intérieur pour formaliser autrement dans l’espace ce qui s’est joué à l’extérieur.
Vous vous définiriez plutôt comme une artiste de résidence que comme une artiste d’atelier…
Je n’ai pas d’atelier fixe. En ce moment je dispose de plusieurs ateliers possibles provisoires. C’est la sortie hors des espaces construits par l’habitude qui anime mon travail. Dans l’atelier, on a ses repères spatiaux, ses outils, intégrés par le corps, dans une forme de continuité, voire de linéarité dans le temps. J’ai besoin du stimulus de la rencontre d’espaces extérieurs qui ont une force de dépassement : les volcans d’Islande, les glaciers de Suisse ont été des chocs qui ont à la fois percuté et impulsé à nouveau, accéléré ou densifié le processus de création. Ces entrechoquements coexistent avec un fil esthétique manifeste, une durée sous-jacente, une maturation très lente. Le rapport aux contextes de résidence n’est pas littéralement politique, social ou écologique, mais relève de l’expérience et de l’existence. À la fois un ancrage local comme impulsion, et une traversée qui l’excède, vers une dimension transverse.
Comme cette résidence dans l’ancien domaine Vilmorin à Verrières-le-Buisson en 2018 ?
Au départ, ce n’était pas exactement une résidence, mais une demande d’installation en extérieur, mais j’ai fini par créer les conditions d’une résidence. J’ai demandé un lieu de production sur site pour pouvoir produire par rapport à ce qui se jouait dans l’échelle et l’architecture.
Il s’agit de l’ancien domaine des Vilmorin. La vue microscopique de grain de blé fait écho à leur histoire et à l’ancien herbier, très feuilleté, qui s’effrite, conservé dans ce même domaine, dans un bâtiment à proximité de l’installation.
Vous citez la formule de François Jullien de l‘“entre-formes”. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
J’ai découvert la pensée de François Jullien à la suite d’un voyage en Chine et son écriture m’a longtemps suivie. J’apprécie la plasticité de sa parole. Les concepts ne sont pas perçus de manière scindée par des définitions d’héritage classique. Il interroge par exemple la manière dont on pourrait nommer l’état de l’eau entre le liquide et la glace. Il remodèle les concepts par une alliance de ce qui est contradictoire. C’est une dimension plastique de transformation, de vitalité.
J’évoquai la mobilité, le déplacement d’un endroit à l’autre, le choc du changement d’atelier. Paradoxalement, je m’intéresse tout autant au processus de maturation sous-jacent et à la manière dont d’une résidence à une autre un fil esthétique me fait avancer progressivement.
En Islande j’ai travaillé à partir de pierres de lave, dont la porosité garde trace de l’ébullition dynamique des volcans et le travail s’est poursuivi longtemps après le retour en France. Suite à la résidence en Suisse, j’ai repris l’installation Poros créée à partir du dessin d’une pierre de lave, mais en y ajoutant la stratification issue de la recherche sur la pierre de schiste.
Je peux produire en quantité mais le processus d’évolution est très progressif.
Aujourd’hui comment ce processus se poursuit-il ?
Je suis en résidence à Massy et Palaiseau où j’ai fait une rencontre bouleversante, celle du quartier Atlantis qui est entièrement en chantier : l’expérience d’un état en devenir, une existence transitoire, à grande échelle. Cette coïncidence permet de poursuivre mes recherches sur les processus de transformation d’espace, en allant davantage vers la construction, le passage de la matière à la forme. J’ai obtenu de visiter un chantier, d’en étudier les formes, de récupérer des matériaux. C’est un moment très fort qui va marquer durablement la suite.
Je suis aussi en résidence au Centre d’arts Fernand Léger de Port-de-Bouc où je m’intéresse aux chantiers navals qui ont marqué l’histoire de la ville. Il y a aussi un chantier de fouilles archéologiques sous-marines qui a permis d’extraire des fragments amphores antiques avec des concrétions de coquillages brisés. Ces coquilles minérales, secrétées par les organismes, construites de l’intérieur comme l’énonce Bachelard, permettent d’aborder d’une autre manière le rapport à l’habitat et à l’habiter.
Quel lien existe-t-il pour vous entre chantier de construction et chantier archéologique ?
Un chantier de construction produit aussi beaucoup de débris, de ruines… je récupère des matériaux, des planches abîmées, qui ont servi à couler le béton. En y pénétrant, son aspect peut aussi être celui d’une friche : des fils pendent, on marche dans l’eau grise.
Inversement, l’archéologue se projette pour combler les vides, pallier aux manques autour des ruines. C’est un chantier de construction qui s’établit autour d’un site archéologique. Le même, mais différent.
Ces choses, je les formule surtout après coup.
Vous jouez sur le microscopique, macroscopique, passez du petit dessin à l’infiniment grand.
C’est la même chose que lorsque je ramasse un fragment de pierre dans lequel je retrouve le contexte des glaciers qui fondent, des failles tectoniques. C’est un jeu d’échelle assez trouble.
Je pars de matières brutes qui ont une très longue histoire. Dans le “dessin” à la surface des pierres, on peut lire un processus temporel très ancien, le lire et le projeter mentalement. Le médium numérique permet de restituer cela à l’échelle d’un grand espace pour une installation. Je ne dessine pas dans l’espace avec un stylo mais en assemblant les photocopies. Il y a une amplitude du geste dans l’espace, qui implique aussi le corps.
C’est la reproduction d’un même motif, grâce à la répétition numérique et à la variation d’échelle, qui me permet d’envahir un grand espace et de créer des variations à partir du même dessin.
Le numérique permet ce processus de répétition à l’identique qui n’est pas possible à la main, car on est toujours dans la variation. Le numérique me permet de découvrir des possibilités qui se trouvent en latence dans le petit dessin de départ. Je deviens spectatrice de ces nouveaux dessins qui se découvrent pendant la mise en espace.
Ce suspense de la découverte est le stimulant qui me permet de remplir l’espace et de tenir dans cette durée. En avançant dans l’agrandissement, c’est une structure arachnéenne qui émerge, et d’autres images mentales se succèdent ou se superposent, jusqu’à produire une sensation de submersion.
En entrant dans l’installation, plusieurs visiteurs ont fait part de leur impression d’être sous l’eau et d’y perdre leurs repères.
Stéphanie Le Follic-Hadida, Catalogue d’exposition Terrain Vague, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil, 2018.
Installation Poros 2.
Entre le dessin, la sculpture et l’écriture, l’installation Poros 2 manifeste une topographie énigmatique composée de passages, de continuités et de ruptures. Poros 2 livre un univers hybride à situer entre le minéral et le vivant, le pesant et le volatile, le végétal et le géologique.
Anaïs Lelièvre part d’un dessin originel diversement réalisé au crayon ou au stylo dont elle se sert comme matrice pour le développement de la future installation in situ. Tour à tour réduit ou agrandi par photocopie, le dessin est multiplié autant que nécessaire. L’installation repose sur ce principe de reproduction d’un élément unique. Elle intègre dans son processus de fabrication le rythme structurel du cumul (en strates multiples) ou de la dispersion (isolement de détails) et parvient ainsi à induire une infinie variété d’impressions et le sentiment paradoxal d’une pluralité. L’installation prend appui sur la spatialité dévolue (sol, mur, plafond) et vit au rythme de cette palpitation.
Aurélie Romanacce, « La caverne du langage ou le dessin comme territoire chez Anaïs Lelièvre », 2018.
Le dessin chez Anaïs Lelièvre se fait multiple, obsessionnel, langage agrandi d’un phonème répété, il balbutie, bégaie, sous les élans répétés de la photocopieuse pour atteindre l’immensément grand ou l’infiniment petit. Monade en bataille, le dessin se déploie, craque, se diffracte pour mieux se saisir des anfractuosités d’une pierre volcanique en Islande, d’un fruit exotique et d’une géode cristalline au Brésil, d’une roche sédimentaire à Sospel ou d’une argile pétrifiée en Suisse. Le dessin se fait boussole détraquée d’un inconscient affolé qui tantôt affleure, tantôt s’éloigne, sous les strates des impacts du Rotring sur la feuille immaculée, assauts d’une pointe élancée sur le mur pour faire surgir la lumière à partir de l’obscurité. Noircir pour mieux révéler, la pratique du dessin chez Anaïs Lelièvre traque l’incision du trait à partir du motif pour mieux s’en imprégner, au point de vouloir faire corps avec lui et se dissoudre dans la matière.
La vie nomade de l’artiste en résidence autour du monde, de l’Islande à la Chine, en passant par le Brésil, la Roumanie ou la Suisse, la conduit à troquer ses racines pour une simple valise. L’œuvre se fait modulable et transportable, se détache de la surface pour devenir environnement habitable. Le dessin devient topos, et épouse in situ les architectures de carton dans l’installation Cargneule (Sospel), les socles en bois dans Cristal (Recife) etle mobilier dans Stratum. Il envahit l’espace, excroissance à la recherche d’un ancrage pour s’arrimer le temps d’une escale dans le lieu qui lui est offert. A l’encontre d’une approche formaliste, Anaïs Lelièvre glisse des indices au spectateur attentif qui ne craindrait pas de tomber dans l’abîme pour tenter d’en trouver la sortie. Des mots raturés, balafrés, noyés par le dessin, tentent d’apprivoiser cet espace insaisissable que le dessin s’éreinte à faire surgir. Un épuisement sublimé par les volutes tortueuses d’un baroque assoupi que l’artiste vient réveiller par ses architectures complexes au retentissement organique sur les pupilles dessillées du spectateur.
Le dessin s’il est langage, lumière et volume, se fait aussi matière et céramique. Terre imitant la pierre, les sculptures se mêlent aux fresques dans l’installation Poros et redoublent par leur présence, la dimension tactile de la main de l’artiste. Si aucun oiseau n’ira se poser sur les pierres de ces installations, contrairement à la fable de Zeuxis, la perception de l’espace ne s’en trouve pas moins aspirée par les vortex vertigineux de ces collages en noir et blanc. En écho assourdi aux Clocs, cycle de performances itinérant de l’artiste sur le surgissement du corps comme organisme primaire dans l’espace public, les dessins d’Anaïs Lelièvre engagent le corps du spectateur dans la caverne du langage. L’indicible se fait palpable et le mystère de la naissance, faille spatio-temporelle dans l’univers organique, expulse la conscience du spectateur dans un spasme existentiel.
Joël-Claude Meffre, « Forêt de pinacles : une poétique de l’ensemencement ».
Installation Pinnaculum, 2018, Musée des Augustins, Toulouse, Cahors Juin Jardins.
En ce lieu des Augustins, le cloître fut toujours ouvert à l’ensemencement, la dissémination, la filiation, la prolifération. S’y sont tissés, s’y tissent et se combinent des liens lentement densifiés à l’abri de ces murs de briques rouges. Ils accueillent, préservent et enregistrent ce qui s’y trame, s’y projette, s’y cristallise, d’échanges et d’accomplissement de tout processus créatif.
Parmi les semaisons, les croissances, les sillages d’insectes et les pas des hommes répétés dans les allées et venues du temps, il y a cette scène d’efflorescence d’architectures en pinacles implantés dans le noir terreau des possibles, au jardin, sous le carré du ciel. Ces pinacles en prolifération, apparaissent en traces pures, en translation, en différance, comme modèles, échos à ces hauts pinnacula (pinacles) de briques qui ornent en contrefort les toitures du cloître.
Ces architectures peuplent et trament en dissémination l’espace du jardin, tels les arbres d’une forêt symbolique où l’on déambule en silence (comme lorsque Baudelaire invite chacun à passer à “travers des forêts de symboles”). Selon les jeux nomades de l’artiste Anaïs Lelièvre, elles viennent à dessein inséminer la sérénité des lieux. Elles sont présence à être, maisons, cristaux, arbres, pignons, prothèses, champignons : tout ce qui s’identifie au pouvoir de la phusis, à la poussée générative.
Chaque face de chaque pinacle porte en impression des treillis de racines en racinages. Archi-écritures de traces inscrites. Tracés monochromes, graphies ayant fixé les trajets des sèves, orientant l’œil de la pensée vers un langage en involution du sol mêlé d’air et d’interstices vibratiles.
L’œuvre œuvrante d’Anaïs Lelièvre est une action à la fois d’irruption et d’intégration-déplacement. Elle s’inscrit dans une continuité : celle entre lieu, espace, histoire, mémoire, mimesis. Elle est source au-delà d’elle-même en ressourcement constant. Elle est force de dévoilement, démêlant/emmêlant les faisceaux de ses propres tensions créatrices et imaginatives.
L’œuvre engagée dans le cloître relève d’une poétique de l’ensemencement polymorphe, notamment par le fait que les structures en volumes de tailles différentes sont en filiation avec d’autres sortes de volumes déployés, implantés en d’autres lieux par l’artiste. De l’une à l’autre, ces structures rêvées se nourrissent d’un même processus créatif, mettant en jeu mutations, analogies biomorphiques (minérales, végétales, organiques). S’y allient écriture cosmographique et occupation mutante de l’espace/temps.
Claudine Roméo, à propos des sculptures-performances CLOC, en particulier la CLOC d’ombres, co-créée avec Akira Inumaru, incarnée par Baptiste Conte, 2014, Espace Architecture Gestion, Paris.
Que de CLOCS, que de CLOC !
Il y avait les différentes et multiples images des clocs, il y avait les mots, les mots sur les clocs.
Du rouge, du rouge, du rouge, et puis du blanc, une fois, deux fois. Le blanc une fois, j’y étais, une fois (L’autre n’est encore que dans l’image, la mariée, je la respirerai un jour, prochainement.)
Qui disait : “la rose est sans pourquoi” ?
Analyser ne sert à rien : la psychanalyse même passe sous silence l’objet, en absente la forme.
Ou si elle regarde et décrit la forme, elle est à la recherche du pourquoi. Le pourquoi explique et justifie. Qu’est-ce qui reste quand on a tout enlevé ? - la culture.
CLOC, CLOC, CLOC, qu’est-ce qui reste d’une chose vivante, complexe, quand on a tout enlevé ? - sa présence même.
Enlevez tous les pourquoi-comment, - aussi les comment ? - et je vous dirai tout. Je dirai tout, seulement en respirant, et en même temps en retenant mon souffle. (Contradiction dans les termes ? mais justement, on y est.)
Mais sans mots. Le comment est moins grave que le pourquoi, mais quand même on s’en passera aussi.
Et même je ne proclame pas trop simplement : “j’aime”. J’aime peut être très grave aussi.
CLOC est sans appel.
C’est cela qui me saisit lorsque, enfin, j’en vois une en vrai, en chair et en os et qui bouge.
Pourtant en enlevant la chair et l’os.
Provisoirement car une CLOC n’est pas un objet d’art, pas un ob-jet du tout. Une CLOC ne peut être simplement « jetée devant » nous , dans un pro-jet démonstratif ou même monstratif.
Par contre, je ne la vois pas rougir à être qualifiée de chose.
La chose en soi, dit Descartes, le parti-pris des choses dit Francis Ponge. Les mots et les choses dit un autre. Et “je suis une chose étendue” reprend Descartes. Chose étendue et chose “qui pense”, dit encore Descartes. Chose habitée de pensée.
Ces choses dont je n’avais vu que des images, je les voyais “indéfinies” ? des indéfinies qui pensent, ou à penser, et aussi sans mot ? Oui ?
Mais en quoi consiste une CLOC ? Montage, montagne de tissus rouges divers, corps méandreux et poches, ventricules, appendices, diverticules, des plus petites aux plus grandes. Des formes molles, textiles, mais on voit, oui on voit qu’il ne s’agit pas de tissus, la banalité même, mais d’en faire toute une montagne, des montagnes, en montage serré et cousu : avec pas n’importe quoi, des vêtements, et des vrais vêtements qui revêtent déjà, qui ont revêtu des gens. On en devine les parties du corps, poches aux genoux et au coude, usure à la poitrine et aux poignets, les CLOCS sont des assemblages et montages serrés de vêtements, comme des vrais patchworks, mais en volume, et dont les éléments sont déjà élaborés. Pour le patchwork ordinaire, les tissus sont préparés en carrés, de même format, et viennent rarement de vêtements, sauf quand, traditionnellement, on recueillait les morceaux de tissus encore bons sur les vieux habits, pour en faire des carrés.
Bien sûr pas avec de simples tissus ; articulées entre elles plutôt qu’accumulées. Et ici, le faux patchwork, car en volume, c’est du work in progress, modifiable à tout instant, par un ajout de la couseuse. Anaïs en couseuse intrépide, et qui n’a pas fini d’en (faire) voir, de ce travail : aiguille avec le fil élastique pour la souplesse du bouger dedans, poinçons pour piquer les vêtements épais ou en cuir, des heures et des heures “tire, tire l’aiguille, ma fille !” Elle ne s’en prive pas de coudre et recoudre, elle ne nous en prive pas de ces coutures à semaine, à la petite semaine, mais où trouve-t-elle le temps ?…. tout à la main !
Donc, formes informes ou difformes ? Non, choses au-delà de la forme. Dans la mythologie grecque, un territoire consacré existe, au-delà de toute mesure : c‘est la Khôra. La Khôra, c’est Platon qui la désigne dans le Timée. En poète qui déteste les poètes et veut les chasser de la cité (“ils ne sont ni chefs d’Etat ni généraux d’armée”), Platon est ravi comme d’hab’ de pousser à fond sa propre contradiction. Poète sans le vouloir, il prend cette institution mythologique et poétique de la Khôra, et en fait un poème de philosophie. Il garde bien le contenu mythologique. La Khôra, c’est l’a-forme : vaste lieu (topos comme dit Aristote) lieu non-ieu aussi indéfini qu’immense, lieu au-delà du firmament et de l’underground, dans les deux sens.
C’est là qu’on comprend que dans les deux sens ou non-sens du lieu, se tient aussi le sens ou non-sens du temps : Platon parle de la Khôra, lieu d’où nous venons, avant la naissance, et où nous retournons, après la mort. A sa suite, Derrida. Il écrit un petit essai sur la Khôra de Platon et en tire toutes les implications.
Si je crois pouvoir dire que CLOC est Khôra, et que toutes les CLOCS en viennent et y retournent.
C’est que l’implication de ce temps intemporel est gravé par le mouvement si lent d’Akira. Je n’ai pas vu d’autre performance d’Anaïs avec une CLOC. Mais je savais déjà que s’il y a performance, et pas seulement exposition d’une chose, c’est qu’elle a aussi besoin de temps.
Akira arrive, accompagné d’une Khôra bruissante, chair et os revenus. A l’intérieur du vêtement tentaculaire et protéiforme, la Khôra cette fois est matrice habitée. Le geste de reptation a lieu. Rythme aléatoire, gesticulation lente, je devine pourtant que dans d’autres scènes, et avec les CLOCS rouges, cela doit être parfois sacrément chaud et trépignant, joliment envoyé et jubilant.
La jubilation nous atteint, ici aussi, mais dans la durée de cette Khôra blanche et bruissant comme du papier de soie. Une CLOC ici pas faite de vêtements, mais cousue de fils blancs, on dirait. Mais bien sûr vêtement elle-même. Ni même cousu par Anaïs. Carapace de légèreté mousseuse au papier de soie blanc découpé par brûlure. Les ailes de papier blanc, laiteux et translucide. Akira a tiré des bords, étalé ces pétales. Et les bords, eux sont frisés de brûlures ? Peu d’artistes ont utilisé le feu comme outil et comme élément premier. Yves Klein le fait. Pas sur les bords, c’est bien le milieu qui l’intéresse. Chez lui, la flamme est outil, élément premier et contenu fixe. Je parle des becs de gaz à la flamme allumée. Ces brûleurs de cuisinière, allumés, performance fixe au contenu de lumière, vivent tous les vendredi soir sur le toit du Musée à Nice.
Ici, pour Akira et son montage de papier, la flamme, éteinte, laisse une trace comme ourlet délicat, noir/brun. Le dessin du contour, qui identifie chaque page de papier, page, ou plume ou écaille ou feuille de brume ou de givre fixés en lame ténue, pour cet instant-là. Le temps de cette CLOC en stances de poème froid/brûlant comme la glace, voilà la cape de lumière d’Akira, l’habit de lumière du danseur complice du dedans. Du dehors, la poète danseuse couseuse un instant, caméra à l’œil, filme ce rite/rythme/radieux/rieur pour nous en cadeau et aussi pour après.
J’avais en tête des images de CLOC, toutes rouges. Or, or….
J’ai vu un jour, donc, cette chose, comme une lionne superbe et généreuse. Je dis lionne à cause de la crinière. J’ai vu un jour une CLOC vivante, j’ai vu. Une CLOC, une chose habitée. Ce n’était pas n’importe quelle CLOC, une CLOC blanche, coopérée avec cet artiste japonais, Akira.
Akira s’avance vêtu d’une tranquillité absolue. La tranquillité incarnée. Alors que derrière lui traine la CLOC vivante, mise en cloque visuelle pour moi, pour la première fois. Vivante devant moi. La performance avec Akira. Traine, mais comme une traine, sans trainer, en glissant. La cloque incarnée qu’il emmène avec lui, et qui pourtant a l’air de le pousser en avant, mais sans forcer. Doutant de la matérialité de cette chose, de cette avancée à trois, j’entends le froufrou du papier. J’effleure de mes pieds le même sol que cet être vivant qui respire et palpite, léger au sol mais qui se pose bien là.
Ce “calme impressionnant” comme on peut dire, où le regard et la respiration sont comme “suspendus” est suivi, si proche de cette mouvance qui frissonne à peine, dans un léger froufrou de papier.
Claudine Roméo, à propos de l’installation Flottement cellulaire, 2010, Parc des Buttes Chaumont, Paris.
Anaïs,
Je suis en haut du Belvédère. Dispositif que l’artiste - qui est toujours également architecte - aurait pu lui-même élaborer. A l’intérieur de la vue s’étale “une transe calme”, une zone de turbulence sereine, un état physique de prière.
Bouleversée et traversée :
La sensation première, pour moi qui regarde : quand ça traverse, les images se resserrent, quand ça bouleverse, c’est l’expansion.
Cette coïncidence de motions (d’émotions) s’instaure dès que l’artiste pré-voit l’œuvre.
Alors, le travail perpétré de l’artiste, une fois instauré comme œuvre, est continué une fois le travail matériellement accompli.
Ce mouvement très particulier est rythme à deux temps, comme on disait, c’est la palpitation sacrée qu’Aristote appelle l’Âme du monde.
Tu contribues à créer/recréer cette fonction éternelle et fixe, concentrée intensivement et expansivement.
La surprise, le cadeau, est que cet état de calme olympien, c’est le cas de le dire, est communiqué au sujet regardeur, avant même qu’il ait saisi de quoi il s’agit !
Il est pris dedans “sans concept” comme dit Kant, toute réflexion est rendue possible ensuite, par la pression qu’exerce l’impression.
Il y a l’éclat même des images nacrées de ta langue. Elles se démultiplient entre immenses et minuscules. Et cette voie lactée rose issue et parlée de ta bouche est une voix rose dans un souffle de bulles.
L’œuvre ne rayonne que par la qualité directe, explicite, de la matière rose nacrée sur fond de voile d’eau verte : la présence au monde pensée, de l’artiste, est immédiatement incarnée avec et dans le tissu même des choses, et dans une intimité violente et tendre avec lui : au même titre que les petites filles qui viennent avec leurs bulles et que l’oiseau se sent chez lui, solidement sur les images rouges, et que le canard ou la tortue se frayent une voie d’eau entre ces obstacles envahissants et protecteurs….
Aucune vision conceptuelle sèche : la pensée est immédiatement couleur moirée de la peau, épaisseur flottée de l’image, bord précis qui fait un rond dans l’eau, jeu de l’eau entre-deux avec le reflet du ciel, et la silhouette des arbres bordant ce reflet. Solidité impressionnante des continents rouges moirés, qui pourtant flottent - autre espèce de nénuphars, croient les gens qui passent.
Quand on est près du lac, on est à peine au-dessus, on voit les formes, un peu épaisses, et comme parallèles dans un étagement, on les voit comme de profil. Et c’est dans cette posture que des images de nébuleuses, et de corps interstellaires, sont aperçues quand on arrive d’ailleurs. Avec, au fil de cette mer verte, ou de ce ciel d’orage tranquille, parfois gris/bleu/vert, un mouvement parallèle immobile.
On arrive d’ailleurs, de la vie ordinaire, qui parait moins réelle que ces planètes roses qui existent et insistent. C’est pour cela que cette vision comme dans “On a marché sur la lune” s’impose, et ramène des foules d’images lovées dans la mémoire - ou dans la matière même du cerveau.
L’artiste trouve moins “beau” le spectacle. Certes. En première vision, avant d’avoir eu l’audace et l’héroïsme (je parle de mon cas personnel !!) d’aller jusqu’en haut du Belvédère, en arrivant en bas, je quitte la “vie”, pour trouver une réalité vivante, bien plus réelle.
Elle n’a rien d’élitiste ou de froid : l’éclatante joie - de vivre - incarnée, est reçue, je pense, immédiatement.
“Incarnée”, le seul mot exact, il s’agit bien de peau et de chair. Chair et Ame du monde, où est la différence ?
Je saisis aussi du vrai philosophique, puisque s’entend, avec incarnation, matérialisme, de celui qui, bien sûr, ne saurait être que dialectique… mais je ne veux pas faire trop plaisir à certains (moi-même !) en avançant sur ce terrain : qui pourtant me fait penser. Me fait comprendre ce que serait une vraie culture populaire, culture comme on dit cultiver son jardin : ce qui fait comprendre que le rêve (d’avenir) ne peut et ne doit être que du réel, de la réalité, de la réalisation. Si je peux, grâce à toi, Anaïs, réhabiliter cette parole.
Donc, déjà vue du bord du lac, l’œuvre est immédiatement perceptible par les plus humbles, je pense, enfants ou adultes dits “incultes” : dont le sens de la vie n’est pas encore émoussé.
Car, ne pas perdre ce sens, l’avoir entretenu en maintenant - sans doute par d’autres pratiques que l’art, par d’autres intimités avec le réel - ce sens ou ce goût de la vie, que des gens n’ont pas “perdu”, c’est ce que tu appelles précisément le Flottement cellulaire.
Flottement cellulaire : une vision de notre corps, et issue de lui, dans sa présence poreuse au monde, il n’y a pas d’étanchéité entre les images roses et ce qui les entoure justement parce que le contour et la limite en est très précise, et non pas “malgré”. Cette limite, ou même délimitation dessinée des mille et un - encore plus ! - contours, tant de fois répétée, donne cette image de nébuleuse, où c’est l’ensemble, la galaxie, qui est flottante.
Le grand corps du Monde impressionne par sa palpitation immense et minuscule - détaillée dans les détails des plus petites images. Comme des perles ou des bulles au fin contour précis, comme un découpage, dont l’ensemble regardé à une certaine distance et de haut, du belvédère, est vibration - je cherchais le mot - de tant de précises/précieuses pépites.
Flottement, au sens où tu l’entend, qui serait plutôt donc une palpitation. De même que pour les gens dits “incultes”, il y a, au moins, quand ils ne l’ont pas perdue, la palpitation du monde sentie au même titre - ou en même temps - que la palpitation du cœur et des cellules. Car bien sûr, on l’a vu, les images - ou les cellules, ne flottent pas sur l’eau, mais - symboliquement et matériellement - sur des zones de pur éther, de firmament, l’air raréfié de transparence nacrée, ou la vase où tu t’enfonces, t’enracines dans la vase, avec les bottes de pêcheur, dans l’eau verte.
P.S. Les psychanalystes parlent d’une attention flottante, ou d’une écoute flottante. Ils se laissent (cf. Winnicott, Anzieu, Freud lui-même etc.) bercer par la parole du patient pendant la séance. Et quand quelque chose, du son, ou de la “musique”, dépasse - changement de rythme, de hauteur de ton, etc. - alors, l’attention précise revient, et ce qui “dépasse” est automatiquement signifiant.
Je devrai faire ici une comparaison très précise avec la physique corpusculaire d’Epicure.
En ce sens, on considérerait en même temps la parole de l’analysant : chapelet ou collier de “cellules”, de “bulles” - comme dans la B.D. Et l’arrêt-sur-image ou l’arrêt-sur-son, interviendrait quand, dans les images sur l’eau, l’oiseau, la tortue, ou les petites filles arrivent (débarquent) et font des bulles : ce qui intervient du dehors, mais comme pré-pensé par l’artiste. On n’est plus seulement dans le regard, de l’artiste et de son spectateur, mais dans le faire. Et on peut concevoir, alors, cet unisson entre toi, Anaïs, et le monde, comme Acte (encore Aristote !) commun.
Donc, oui, l’artiste se met, quand il est “en travail” (comme on dit salle de travail, où on accouche), dans un flottement, il est à lui-même dans ces moments-là, le contenant et le contenu de son propre flottement cellulaire.
Si on veut donc mettre côte à côte l’artiste et le psychanalyste c’est par un rapport (une homologie ou structure commune) très précis qu’ils entretiennent l’un et l’autre avec leur propre corps et leur propre entour… et pour le psychanalyste, ce serait plutôt le “corps constitué” patient/psychanalyste, ou analysant/psychanalyste, qu’il faudrait considérer. L’artiste, serait alors, si on veut le mettre en couple, en face de celui de la séance d’analyse, monde/artiste.
Mais, pour être précis, à tel moment donné, et pas tout le temps, sinon le rapport de flottement cellulaire, en commun entre l’artiste et le psychanalyste, cette “comparaison”, perd de sa rigueur, et devient un peu molle ou approximative.
Je reprendrai plus tard la “comparaison” avec la Physique d’Epicure, parce que ça s’impose à moi, ça n’est pas du superflu. Car je fais un parallèle, sinon une comparaison, entre la situation (ou séance) d’analyse, et la situation des corpuscules et de leur chute parallèle, dans sa description de l’espace, quand se fait un accrochage entre eux - au sens d’accident, ça peut être, par exemple, la naissance d’une planète.
Ce point délimité, est désigné comme échantillon du monde, des eaux et du ciel, du plat et de l’escarpé, de la verticale et de l’horizontale : entre belvédère et pelouse, familiarité avec l’air et amitié charnelle avec la terre.
Ces dimensions ou territoires, décrivent toutes les compétences de l’espace, force d’attraction subie par les plaques de liège sous chaque image, rapport au centre de la terre et transparence au sein de l’eau, navigation d’horizons entre le ciel - reflété - et l’eau.
Que serait cet éparpillement d’images de langues, cette précipitation de papilles, s’il n’y avait, en dessous, et au-dessus, des forces pour les faire affleurer, pour qu’elles se tiennent et qu’elles se posent ?
L’artiste ne se prévaut pas de la quantité de travail et de présence. Mais sa ténacité se voit.
De la quantité et qualité de temps; dans cette qualité et quantité d’espace, qu’elle a mis en tension. L’artiste ne fonctionne ni au mérite ni au sacrifice.
Mais on te voit embrasser les points cardinaux, à la croisée desquels tu t’es fait violence. Mise en tension, en danger, en travail de produire la vision lumineuse. L’échancrure de clarté (dans l’obscurité - symbolique - de l’univers).
La générosité, c’est : “générer”. Cela passe par le moulage des poids de béton pour chaque image, le piétinement dans la vase, l’eau jusqu’à mi-corps, et pendant des heures d’épuisement.
Fixer plus de mille fois l’image à son fil à plomb, assurant la solidité et l’équilibre. Le belvédère comme bout de sein sucé par la voûte céleste ainsi animée, et les papilles de la langue goûtant goulûment l’atmosphère ainsi maternelle.
D’où, encore cette intimité filiale familiale, érotique, entre toi et la Physis.